
Le Surréalisme, même n° 4, printemps 1958
| SOMMAIRE | |
| Monique Watteau | La mort du singe-soleil |
| Vincent Bounoure | Préface à un traité des matrices |
| José Pierre | Heinrich von Kleist, ou les rêves accomplis |
| Hans Bellmer | Le Père |
| Robert Benayoun | Le mot et l'image |
| Lancelot Lengyel | La force créatrice des moyens plastiques |
| Jean-François Revel | La métamorphose du silence |
| Theodor Spoerri | L'armoire d'Adolf Wölfli |
| Divers | Une enquête sur le strip-tease |
| Illustrations de | Hans Bellmer, Adrien Dax, Pierre Molinier, Max Walter Svanberg, Monique Watteau, Adolf Wölfli |
P.2
La mort du singe-soleil
Un grand singe d'une espèce inconnue, tenu pour un dieu par les Indiens Motilones, a été capturé aux confins de la Colombie et du Venezuela par une expédition scientifique. Un des membres de celle-ci, la zoologiste Amanda Vernet, est à ce point saisie par la personnalité extraordinaire de ce singe — sa manière de sainteté, son dévouement à la cause de tous les animaux persécutés, et les faits miraculeux qu'il semble susciter sur son passage — qu'elle le fait évader du zoo qui le retient captif et le ramène dans sa forêt natale. Là l'étrange couple mènera une vie idyllique au sein d'une nature transfigurée.
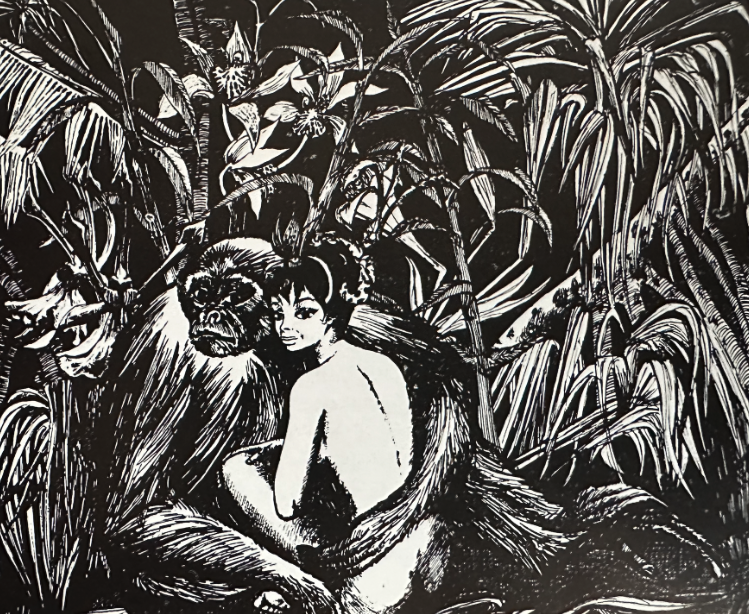
Jusqu'au jour où Poutt-Etit, comme Amanda l'appelle, s'interpose héroïquement entre un groupe de chasseurs de fourrure et les singes laineux qu'ils sont occupés à massacrer. Ainsi s'achève dans une fusillade le destin du rédempteur inhumain. Mais son sacrifice restera-t-il vain pour ces damnés de la création que les plus miséricordieux d'entre nous appellent nos frères inférieurs? Il faut pour y répondre interpréter les signes éternels.
Tous les fusils crachèrent ensemble, sans que Poutt-Etit parût atteint.
Amanda sentit son cœur se soulever, et une idée confuse l'envahit au point de lui faire pousser un cri à nouveau, un étrange cri d'espoir. Poutt-Etit devait être invulnérable : il ne pouvait pas être blessé par des balles stupides.
Pendant une interminable minute, il resta debout, puis, dans la poussière de moisissure et de terreau soulevée par sa charge effrénée, il s'écroula d'un bloc comme une statue de pierre.
Mais il n'était pas de pierre. Tout petit soudain, ramassé sur lui-même comme un fœtus, chaque muscle de son corps tremblait de douleur et de révolte. Ses mains et ses pieds se contractaient, tandis que des balles rageuses le trouaient encore de toutes parts.
Amanda regardait, muette et sans forces.
Chaque fois que la chair serrée et ferme sursautait sous le choc d'une balle, qui s'y enfonçait avec un bruit mou, elle avait un hoquet et vomissait sans se détourner, ni même se pencher, les yeux fixés sur le corps de celui qui mourrait tout seul, dans un cercle de terre coupé à même la masse verte de sa forêt.
Les singes survivants avaient disparu. On n'entendait plus tout à coup que les sifflements des flèches motilones, venues de nulle part, puis les cris des chasseurs qui tombaient et couraient dans tous les sens comme de la volaille épouvantée.
Mais Amanda ne les voyait pas. Pas plus qu'elle ne les entendit fuir, en s'interpellant avec des voix éraillées, poursuivis par les Indiens diaboliquement silencieux. Elle entendit seulement, dans le silence qui retombait sur elle, la course légère d'un vieux sajou, qui courait vers la masse inerte de Poutt-Etit. Elle quitta la couronne ombreuse des arbres et marcha sur la terre spongieuse jonchée de débris et de petits corps ensanglantés.
Il lui sembla que le chemin jusqu'au mort durait des siècles, bien que le sajou l'eût parcouru, lui, en quelques secondes.
Elle ne pouvait plus soulever les pieds: ils collaient à la terre comme s'ils pesaient des tonnes. Amanda ne contrôlait d'ailleurs plus ses réflexes, car ses orteils vinrent heurter le pelage souillé du cadavre sur qui elle buta. Puis, elle se laissa choir à ses côtés, le cerveau paralysé.
" Poutt-Etit, pouit, pouit... " Le cri désolé du sajou, qui tâtait du bout des lèvres la masse informe du grand singe était comme un écho affaibli des cris du mort. Le poil gonflé d'émotion, la voix rauque, le petit singe inconnu paraissait stupéfait et horrifié.
— Oui, petit, il est mort, dit doucement Amanda. Mais cela n'arrêta pas les cris du capucin, qui restait là, à tâter les poils ternis par la saleté, reniflant le sang qui les maculait. — Poutt-Etit... mon amour, mon petit singe, dit Amanda. Ses anges avaient fui, les Motilones s'acharnaient à le venger, les lagothriches pour qui il venait de mourir soignaient leurs plaies quelque part dans le secret des frondaisons. Il n'y avait, dans cet espace vide, à quelques mètres du groupe d'arbres décharnés, dans le silence qui retombait avec la poussière sur le sol, que le petit sajou qui ne pouvait croire à la mort, et Amanda, la main posée sur une plaie qui saignait encore un peu entre ses doigts. Elle n'osait pas toucher le crâne aux poils courts, comme de fins cheveux coupés en brosse. Elle s'interdisait un geste qui eút déclenché en elle un désespoir étouffant. Mais Poutt-Etit n'était pas mort. Le petit sajou l'avait peut-être deviné. Peut-être était-il effrayé à l'idée de ne pouvoir arrêter cette vie qui fuyait par tant de petits trous rouges. La tête du Singe-Soleil se souleva imperceptiblement, et Amanda sentit une joie soudaine, une joie affreuse lui serrer la gorge. Affreuse, car Poutt-Etit, vivant, devait souffrir d'une manière intolérable. Elle prit la tête du grand singe dans ses mains. Elle était lourde, et consentante. Elle reposait dans les petites mains d'Amanda avec résignation. Puis les paupières noires se dessoudèrent, et des yeux fixes comme deux trous d'ombre s'ouvrirent sur le visage incliné de la jeune femme. Ses traits étaient tracés dans de la pierre noire, et ses yeux sans regard étaient ceux d'un mort. Pourtant, il fit un dernier effort. Un effort qui retroussa hideusement ses babines souillées de bave, pour retirer la tête des paumes douces de son amie. Il avait honte de son agonie. Cette lueur encore vivante en lui avait honte d'infliger à son amour le spectacle de la souffrance et de la faiblesse. Alors, il enfouit son visage dans la terre boueuse, pour qu'elle ne le vît pas mourir. Elle ne sur jamais à quelle seconde il avait tout à fait cessé de vivre. Au loin s'annonçait un orage dont les craquements faisaient gronder la terre, sous sa croûte de boue à demi séchée.Amanda ne pouvait résister plus longtemps à l'envie obsédante de toucher la fourrure courte de la tête du grand singe. Sous les yeux tristes du vieux sajou, qui tenait entre ses mains et ses pieds la grande main inerte du Dieu mort, elle posa le bout des doigts sur le crâne oblong. Et aussitôt, tout au fond d'elle-même, une petite voix se mit à pleurer. Cette voix, c'était la sienne quand elle était petite fille. En fait, avait-elle jamais cessé de l'être ? La petite Amanda, prisonnière d'un cercle de cadavres aimés, tournait, tournait dans les entrailles de la jeune femme, en poussant des petits cris affolés. Tant d'animaux qu'elle avait aimés étaient morts par la faute des humains! Jamais elle n'avait pu les garder longtemps. Une plainte étranglée lui perçait les oreilles. Mais il n'y avait personne auprès d'elle, personne que le petit sajou qui ne disait rien. C'était toujours la petite fille folle de chagrin qui frappait du poing pour sortir d'elle, et la faire hurler de démence. " Poutt-Etit incomparable, mon petit singe... mon prince aux bras chargés d'orchidées... ". Quelques heures plus tôt, elle avait eu des pensées qui lui revenaient maintenant, aux cris suraigus de la petite Amanda " Que ferais-je sans toi, Poutt-Etit? Où trouverais-je un rire si tu ne dansais pas pour moi de folles sara- bandes à l'heure où je suis mélancolique? Oue ferais-je si, à l'instant précis où je me sens seule tu ne venais pas me serrer dans tes bras, toi qui sens toujours à quelle seconde on a besoin de toi ? Qui lécherait le sel de mes larmes quand je pleure, Poutt-Etit, aussi tendrement que toi? ... Un tourbillon de feuilles et de brindilles rompues les enveloppa dans une brusque rafale. Et les grandes orgues de la forêt des pluies se mirent à rugir. Les arbres frissonnaient, se tordaient. Les cheveux d'Amanda, secoués par la tempête, claquaient au vent comme le voile noir d'un grand deuil. Un manteau de cendres tombait sur la forêt, étouffant dans ses plis épais les ors qu'y avait jetés la lumière. Le tonnerre, très haut au-dessus des arbres, dans la masse enchevêtrée des épais nuages plombés, éclatant avec toute la violence d'une fureur démoniaque, pour s'achever dans des gémissements languides à en mour. Et de larges gouttes se murent à tomber sur le morne visage d'Amanda, y faisant ruisseler les larmes de la forêt vierge. L'averse novait déjà ses cheveux quand elle s'aperçut que la pluie collait le pelage poussiéreux du mort, et amenuisait encore, d'une manière pathétique, sa silhouette recroquevillée. Il était trop lourd pour qu'elle pût l'emporter seule, à l'abri de la tempête. D'ailleurs, elle ne savait même pas où se trouvait la maison motilone. Sans Poutt-Etit, les chemins de la selve se ressemblaient tous et ne menaient plus nulle part. Elle était trempée jusqu'aux os quand elle trouva une seule, une dérisoire solution : elle se coucha sur le cadavre trempé, se fit la plus large, la plus vaste possible, pour protéger des eaux tristes ce qui restait du Singe de Soleil. La pluie ruisselait sur son dos nu, glaçait ses épaules, suintait peu à peu du sol, et formait un anneau boueux autour des deux corps embrassés. Les doigts enfoncés dans la fourrure poissée, le visage écrasé contre la tête noire détournée vers l'humus, Amanda sentait le cadavre se raidir sous elle, et la tiédeur s'enfuir des muscles figés. Poutt-Etit s'éloignait d'elle, inexorablement. Un abîme coulait entre eux, qui s'élargissait comme un fleuve en crue. Le ciel avait des cris de soie déchirée de bas en haut, mais Amanda ne frissonnait même pas d'instinct au choc assourdissant des coups de tonnerre. Inerte et froide, sous la pluie diluvienne, elle pleurait, bouche ouverte, les dents contre les poils rouges dont elle connaissait si bien le goût musqué, et qui prenaient déjà la saveur terreuse de l'humus. Poutt-Etit, mort martyr.
★
Toutes les eaux du ciel s'écroulaient sur la terre. Les Indiens, dans leurs ponchos collés par les torrents célestes, trébuchaient dans le vert intense à qui la foudre donnait un éclat démoniaque, et que la pluie faisait luire. Le monde semblait tout entier pris dans une immense émeraude, et ballotté sur des étendues infinies de flots en révolte. L'eau brutale dégringolait à travers les voûtes de feuilles jusqu'aux silhouettes minuscules qui se traînaient, épuisées, dans la nuit malefique des sous-bois. La troupe de Motilones suivait les rares chemins qui n'étaient encore qu'à demi inondés. Les uns derrière les autres, précédés par le Piache, ils marchaient en silence dans la colère et les grondements de l'averse tropicale. Deux hommes portaient le brancard où, sur un lit de fleurs rouges, la forme ruisselante du Dieu mort gisait, lamentable, sous le déluge impitoyable qui noyait toutes choses. Amanda, engourdie par la fatigue au point d'être insensible aux innombrables blessures que lui infligeait la forêt, serrait dans ses bras raidis le bébé lagothriche qu'elle avait recueilli sur le cadavre de sa mère, et adopté. Depuis l'aube, elle marchait avec les Indiens partis enterrer Poutt-Etit, suivant un rite funéraie exceptionnel. D'abord, ils n'avaient pas cru possible la mort du Dieu-Soleil, puis ils avaient dû l'admettre, et leur désarroi, leur incompréhension les avaient rendus muets, des heures durant, comme hébétés par une évidence aussi folle. Le Piache avait avoué son embarras: il fallait enterrer le Seigneur Rouge, mais les cérémonies habituelles lui étaient inapplicables car la maison du mort y joue un rôle important, et le grand singe n'avait pas de maison. D'ailleurs, il n'était pas un Indien, mais un Dieu. Le Piache connaissait un endroit convenable pour y creuser la tombe du Dieu, et il avait décidé brusque- ment le départ de la troupe, sans donner de raisons. Les femmes avaient préparé le brancard, et cueilli des fleurs sui lesquelles Poutt-Etit avait été étendu, la mâchoire tombant sur la poitrine dans une sorte de cri muet, les mains crispées, l'œil pathétique, à demi révulsé. Et les Indiens étaient partis au long d'une piste à peine visible sans prendre garde à la pluie qui tombait avec rage et se mêlait aux larmes. Au fracas de l'orage, aux cris d'agonie des arbres foudroyés, se fondaient les chants et les pleurs continus des habitants de la selve. C'était comme un gazouillement confus sur fond de grandes orgues, et jamais roi n'eut pareille messe de mort.
Amanda n'avait pas compris jadis que sa mère passât tant d'heures à entretenir la tombe familiale et à méditer auprès. Elle avait toujours pensé qu'elle accepterait pour sa part d'être dévorée par les vautours et que ses os soient éparpillés. Mais pour Poutt-Etit, c'était différent. Il lui fallait un lit d'orchidées, du soleil sur sa tombe, et des plantes qui pousseraient un jour dans ses yeux, pour qu'il pût venir revoir le monde à travers la peau fine de leurs corolles. Aussi, quand le Piache arrêta le cortège harassé, Amanda considéra-t-elle le paysage avec stupéfaction. C'était, au bord d'une étendue noyée, obscure, d'où montait l'odeur intense de putréfaction des feuilles et des trones minés par les eaux, une langue de terre préservée de l'inondation. Il n'y poussait qu'un seul gigantesque sapopema, dont les racines aériennes formaient une grotte, une sorte de temple en forme de tiare, fait de cent racines tordues, tressées, enchevêtrées ou seulement serrées les unes contre les autres, murailles sculptées et baroques, où jouait la lumière. Dans le vaste creux voûté de ces racines d'où parfois tombait, par un imperceptible interstice, un fin rayon crépusculaire, régnait un parfum exquis de bois fraîchement taillé, et de jeune sève, qu'exaltait l'humidité. La terre détrempée avait une coloration rouge virant au violet, et quand, sur un ordre du Piache, deux des Motilones se mirent à la creuser, ils y firent des blessures sombres et boueuses, d'un gris violacé très doux. Alentour, dans la mélancolie désolante des marais, tombait le crépuscule bleu et vert. Toutes les plantes qui en se tordant jaillissaient des eaux, étaient couvertes de parasites chevelus qui retombaient en guirlandes, en draperies velues, jusqu'à la surface glauque encombrée des débris squelettiques d'arbres morts et de nénuphars, où elles traînaient comme de longues chevelures d'Ophélies, parmi les fleurs. La pluie avait cessé d'un seul coup, laissant la place à un silence angoissant, où claquait parfois un bref cri d'oiseau, ou le long hululement d'un singe hurleur, très loin, au delà des immenses étendues marécageuses. Les Indiens chantaient, poussaient des cris terrifiants qui ressemblaient à s'y méprendre à des pleurs de sajou, puis reprenaient un chant plus calme, monocorde, violemment scandé, et qui courait sur les eaux. Amanda ne voyait rien que la grisaille gluante de la boue creusée par les mains précises des Indiens, et le corps recroquevillé, amaigri par la pluie qui avait collé sa fourrure, de celui qui avait donné un sens à sa vie, une irrésistible impulsion à son destin. Il n'était plus qu'un pitoyable cadavre de bête qu'il fallait enterrer au plus vite, pour qu'il rejoigne cette pourriture d'ou renaît la selve. "Qui lécherait le sel de mes larmes, Poutt-Etit, aussi tendrement que toi? Qui léchera mes larmes?" Son visage fatigué et sali par la longue marche, où les pleurs laissaient des traces blanches, se distinguait à peine dans la pénombre du sapopema. Mais le bébé lagothriche qu'elle tenait dans les bras vit luire quelque chose, et se hissa jusqu'à la joue de sa mère adoptive, pour la lécher. Ce fut comme un signal. Amanda sentit son cœur broyé, fendu, et des digues en elle se rompirent. Elle se laissa tomber sur l'amas de boue fraîchement grattée, et se mit à sangloter comme un enfant désespéré. Elle vit disparaître sous la terre la dernière touffe de poils rouge et or, puis la main noire, crispée encore sur une poignée d'humus qu'il avait raclé pour mourir. Puis il n'y eut plus que de la terre boueuse, et la nuit qui tombait sur l'âme vide d'Amanda, et la fatigue écœurante des Motilones. Il n'était pas question pour eux de retourner à leur point de départ avant le lendemain. Aussi s'accroupirent-ils pour fumer autour de la tombe du Singe de Soleil, où le Piache avait jeté des monceaux de fleurs trempées, dont le parfum cireux emplissait la grotte, et alourdissait encore la tête douloureuse d'Amanda. Les yeux fixés sur les étendues clapotantes des marais, elle n'avait même plus la force de lutter contre le sommeil qui la gagnait. Elle se coucha, la joue appuyée à la terre qui couvrait Poutt-Etit et, les bras serrés autour du bébé lagothriche, elle s'endormit. Voyait-elle à travers ses cils ou rêvait-elle? Dans la nuit où les voix des Indiens murmuraient des chants bas et rauques, où des moisissures phosphorescentes tapissaient les racines du sapopema, d'autres lueurs venaient de palpiter, loin sur la laque noire et indécise des eaux. Amanda sombra à nouveau dans l'inconscience totale, puis les voix des Indiens se réveillèrent autour d'elle, et des flammes bleues s'élancèrent, frissonnantes, courant comme des phalènes sur le velours noir de la nuit, pour s'éteindre et renaître plus près, avec une incroyable vivacité. C'étaient de petites flammes d'un bleu violent et morbide, frémissantes, qui paraissaient se rapprocher du sapopema et des formes lasses des hommes qu'Amanda devinait dans la nuit, le visage tourné vers la forêt inondée. Puis il y eut une brusque flammèche tout près, si près d'Amanda qu'elle la vit un instant courir sur elle, sur sa peau. Elle se dressa d'un bond, vit qu'elle ne rêvait pas, qu'elle était debout, hébétée, parmi les Indiens impassibles sur qui couraient les feux follets. Le bébé lagothriche ne s'était pas réveillé. Amanda, les yeux écarquillés, vit s'enfuir les flammes qui les avaient effleurés, dans la nuit pleine de clapotis. Elle resserra ses bras sur la petite forme laineuse du singe et se recoucha, saisie du sentiment de sa solitude totale, et à jamais irréparable. Mais en même temps, elle était envahie par une morne sérénité, et le détachement du condamné à mort qui sait que la limite de ses jours, même lointaine, est marquée, et que rien ne le sauvera plus. Et que, par conséquent, il pourra employer le temps qui lui reste comme personne n'oserait le faire. Puisqu'il n'a rien à perdre.
Monique WATTEAU (extrait de L'ANGE A FOURRURE)
Préface à un traité des matrices
Où va le désir humain? Qu'il aille au plus loin pour être comblé. Tout l'imaginaire n'est pas de trop. il faut la cime du vent, et d'un même élan sur la crête la rougeur du pavot qui donne la vue. Or, très provisoirement, dérisoirement, l'esprit ne s'attachant qu'à l'algèbre immédiate des possibles, il n'y a pour compter ici que les limites étroites où s'efforce à le contenir la nature des choses (1). Frontières abominées, mais bornes exactes d'un rapport au monde, dont il ne semble pas que l'analyse parvienne à saisir la nature, dans une décomposition qui n'est que trop portée à calquer les procédés mathématiques. Ainsi en va-t-il de notre espoir : nous ne pèserons ni sur le monde, ni sur l'esprit, l'un n'ayant d'autre nature que son rapport à l'autre. Mais notre chance serait qu'il fût possible de modifier cette relation, de la transvaluer en cette hiérogamie, hors laquelle il ne peut y avoir pour nous qu'apparence, et dont Hegel parait bien avoir signalé l'attente quand racontant les voyages de l'esprit en quête de l'universel, il montra que la conscience devenant pour elle-même, conscience du monde, dissout toutes limites dans leur intériorisation. Mais cette infusion de l'univers dans l'esprit, qui sans doute ne trouvera son achèvement que dans la conscience universelle, n'entraîne immédiatement que la négativité absolue, ou terreur (2). Tel est ce temps de la destruction qu'il semble bien une escale nécessaire, matin noir de la passion et de la négativité universelles, où le souci de compréhension et les inventaires glacent les forces les plus vives, « nuit obscure» qui n'est pas sans évoquer les expresses réserves des doctrines traditionnelles touchant l'acquisition des pouvoirs, et paraît justifier pour une part les multiples enceintes dont les alchimistes se sont plus à défendre la conquête d'une incalculable puissance. Tout pouvoir ? qu'importe, mais toute connaissance est donnée à qui s'assimile la substance multiple des êtres et des choses, dans la plénitude d'une sagesse qui ne se refuse rien. Entre les contacts que l'esprit peut se connaître avec le monde, une fois pour toutes saluons le professeur de philosophie qui désigna le désir pour le ressort unique de la conscience comme de son objet même. « L'objet du désir immédiat est quelque chose de vivant » écrit- il en tête de la Phénoménologie (3): C'est dire que la relation dont il s'agit, dont l'accomplissement est présenté comme une connaissance. ne cesse d'être au long du processus pour les entités en présence une possession. Ce n'est pas peu préjuger des métamorphoses qui s'ensuivent. La connaissance la plus générale est la modalité intellectuelle de la pleine puissance en exercice sur « quelque chose de vivant ». Il n'est pas niable que l'on assiste aujourd'hui à une extension du désir humain, quitte à qualifier cette extension, et le désir dont il s'agit. La compréhension, premier fruit de la culture qui devait signaler, selon Hegel, la première acquisition de l'esprit sur la voie de son accomplissement, paraît l'exclusif partage de quelques-uns. pressés d'accorder les tranches du réel à l'instant révélées, et dont il faut bien dire que la lanterne, dans les pans d'ombre qui se découvrent, est on ne peut plus vacillante, et dans l'extrême hésitation. Mais à l'incertitude qu'est propre à susciter sur le plan de l'esprit l'acquisition humaine s'ajoute ce qu'a jour après jour de plus pesant le climat qu'engendre cette autre extension, où le désir s'exténue aux pieds d'un panthéon de poupées molles environnées de la fumée propitia- toire de carburants frelatés. Cette pléthore d'hypostases dérisoires, autant qu'il est possible avariées se trouve dans le processus économique délibérément proposée comme séduction pour imposer un masque, ou au moins un chiffre au réel, tel qu'il peut encore se manifester au désir. L'immédiate nécessité, pas plus aujourd'hui que jamais, n'est contraire à la nécessité spirituelle, mais délibérément orchestrée, à l'infini multipliée, aggravée de corollaires sans nombre dont la vie commune ne peut se passer (4), elle s'accroît de tout l'inavouable pour détourner l'esprit de la voie, pour encombrer ce besogneux après-guerre, où le désir - loin de le rencontrer ou de le construire - ne sait plus s'assigner son orient, si peu qu'il en ait loisir. Dans de telles circonstances, il serait surprenant que les manifestations intellectuelles de ce temps ne fussent pas gravement marquées de stérilité, qu'elles pussent s'inscrire aisément en dehors des limites où s'établit l'exercice quotidien, ou qu'elles témoignent, au mieux, d'autre goût que celui d'en sortir. Le sort fait à la pensée qui cherche à se manifester est simple corollaire de la situation faite au désir. L'une et l'autre, sommés de démission, s'émiettent ou se spécialisent, le siècle trouvant profit à canaliser les torrents dans ses égouts. Dans cette situation, le paradoxe mainte fois, mais sottement relevé, est que l'artifice demeurant exclusivement de l'ordre de l'utilité pratique, c'est-à-dire étranger à l'enjeu naturel, ne parvienne aucunement à reconstituer un univers sur les ruines de la nature. La réaction vieillarde et malpropre qui consiste à regretter les chandelles néglige cette vérité d'expérience : on ne rompt pas un pacte. Le pouvoir que nous nous sommes arrogé, ou que l'on nous a mis dans les mains, ne restera pourtant que menaçant, du moment qu'il ne s'est encore donné que pour le prix dérisoire d'un esclavage, auquel n'échappent pas ceux-là mêmes qui ont rôle de veilleur. Qu'ils aillent donc avec le siècle, et s'écrasent aux grilles (5). « Viendront d'autres horribles travailleurs. » Au bout du siècle les porteurs d'aube nous attendent, derrière les confins, l'au-delà du possible est tout paré déjà de beaux éclairs. C'est maintenant à la poésie qu'est confié cet espoir, il faut en convenir jour après jour assez frêle pour autoriser des sorties désespérées, mais qui reste pour l'esprit la seule raison de continuer à jouer. Elle seule sait encore les maîtres-mots; elle seule est dépositaire de cette parole perdue, véritable sujet de l'art, selon Bernard le Trévisan (6), mais matière d'un art de connivence, capable de l'ultime réforme, de la dernière révolution, celle qui emporte toutes les autres après les avoir préparées et accomplies. L'alchimie (7) envisageant cet aspect de la destinée humaine ne manque pas de s'insérer dans le vaste courant qui s'assigne pour premier objet la régénération de l'homme. Régénération qui paraît, dans le contexte chrétien de l'alchimie occidentale, répondre à la doctrine du péché originel, mais qui est bien, il est aisé de s'en assurer, de nature foncièrement différente, puisque non religieuse en son essence. Elle est le projet fondé non point sur le néant d'une nature mythique, mais sur sa dignité réelle et originelle, sur les pouvoirs premiers de la pensée, sur l'attente de leur restauration. Tenant de sa technique propre une vue très particulière de cet enjeu, l'alchimie se construit à partir d'une exacte corrélation des divers plans de travail, par quoi s'opère simultanément la régénération du macrocosme et du microcosme, de l'homme dans son simulacre métallique (8) et vraisemblablement de l'univers dans la matière humaine. Il faut bien reconnaître, si cette correspondance constitue le centre même et le noeud de la doctrine, sans doute l'une des clefs majeures de l'œuvre, qu'elle en est aussi le point le plus obscur, dont le dévoilement parait réservé à l'Adepte et le distingue du souffleur, eût-il accompli de nombreuses transmutations. Tous les auteurs s'accordent sur l'imperfection radicale de la nature, sa lenteur, son impuissance à réaliser une incorruptibilité immédiate. Ainsi l'Art se justifie, et peut-être l'intervention humaine qui est sa vraie raison. Dans le poème qui s'accorde ces prétextes s'accomplit la connivence. Pourtant, en l'un des renversements dont ils sont coutumiers, les mêmes auteurs déclarent que la nature est seule à connaître ses voies, que seule elle est parfaite en ses opérations. Voilà l'hermétisme présenté comme une philosophie naturelle, comme une connaissance particulièrement aiguë des cycles de la nature, de leurs moyens et des agents de leur renouvellement (9). Cette oscillation, bien loin d'être fortuite, ou parmi d'autres, de constituer simplement un piège tendu sous les pas du chercheur, correspond à l'ambiguïté essentielle des opérations alchimiques, ou de la situation de l'artiste face à la nature. Dans ce débat qui survit aux siècles et ne cesse en Occident de s'aggraver, l'alchimie, qui tantôt conseille de suivre et tantôt d'aider la nature, parait détenir une solution strictement originale, à la mesure des exigences réelles de l'esprit. Aux antipodes des entreprises confusionnelles, qui d'ailleurs trouvent preneur à tout prix, elle se fonde sur un savoir précis dont les règles d'action sont intégralement communicables. C'est ce savoir qui constitue les principes artificiels de l'Art (10), lesquels ne sont jamais traités que sous le voile de l'allégorie, précisément en raison de leur extrême simplicité Or, il advient, si tant est que les maîtres soient sincères en leurs descriptions, qu'ils déclarent ignorer le moyen des opérations qu'ils constatent, le mode d'action des esprits sur les corps ou les poids respectifs des agents (11) qu'ils mettent en œuvre. S'ils se réfèrent ici au secret de la Nature, c'est que dans la mesure où elle reste inconnaissable elle est irremplaçable, et qu'elle est en effet irremplaçable du moment que l'Artiste se propose d'en actualiser la forme incorruptible (12) . Tandis que l'histoire de la culture occidentale peut passer pour une suite de querelles ou s'illustre le dualisme de la Nature et de l'Art, à celui-ci l'alchimie oppose un évolutionnisme de la matière, qui, ramenant l'Artiste au sein des processus naturels, lui confère une efficacité analogue à celle des esprits sur les corps (13). Telle est cette innocence première, inscrite en toute chose, et particulièrement dans la pierre des Philosophes, qui lui promet l'accomplissement par l'art. A l'infinie perfectibilité de l'innocence répond l'admirable efficacité des agents qui lui sont destinés, dans un contexte mythologique qui veut que toute semence ait une matrice qui lui est propre. L'harmonie primitive évoque un autre de ces secrets, celui qui se dérobe dans les oscillations infinies des auteurs entre ce qui doit rester tu parce que communicable, et ce qui ne peut être que soupçonné parce que définitivement inconnu. Pour qu'à travers le labyrinthe de textes comme à plaisir embrouillés, nous en venions à découvrir après la part qui revient au feu naturel, caché dans la portion la plus pure de la substance métallique, et celle qui revient au feu contre-nature, qui est celui de l'art, qu'une troisième part, comme au troisième principe de nature, revient à l'incommunicable (14), il semble bien qu'un mode spécial d'appréhension soit exigé de nous. Serait-ce trop dire ? Si l'identification du sel harmoniac des Sages est bien la porte de l'œuvre, constituant l'alchimie comme une discipline autonome, il semble qu'à tout prendre la cabale (15) reste le meilleur style d'enseignement, le seul propre à déterminer chez le lecteur attentif le chaos du commencement (16). Il s'en faut bien que le langage soit pour l'Adepte un corollaire, un mémoire de travaux répondant au goût commun de publier. Quand il s'agit de résultats, l'histoire de l'alchimie témoigne d'une préférence ordinaire pour les épreuves matérielles. Pas davantage il ne peut s'agir de ce regard charitable vers les égarés de la recherche, qu'allèguent fréquemment les auteurs - moins encore de recettes voilées, d'une technique secrète ou de textes chiffrés. Le voile, le chiffre qui préservent le secret n'ont egard qu'au travail opératoire, à l'obtention de la Pierre Physique, à ses vertus observables. En alchimie traditionnelle, il est vrai que ces résultats sont essentiels puisqu'ils constituent l'une des faces de l'œuvre. Mais cet enjeu reste d'ordre symbolique, c'est-à- dire nécessaire et non suffisant (17) opérant ou stérile à son revers selon qu'en certaine phase de l'œuvre s'est ou non trouvé mobilisé le potentiel humain qui met en relation naturelle l'Acier des Sages et leur Aimant. A côté du discours, et en marge, à côté de la cohérence verbale qui rendrait compte de la part matérielle de l'Œuvre, de ce que serait l'Alchimie si elle n'était que spagyrie, mais tout aussi loin du cryptogramme où de l'ombre artificiellement serait jetée sur une lumière de même nature, l'alchimie recourt à un mode d'intellection qui sans exclure le précédent, et l'amenant à sa pointe la plus vive, refuse de tenir pour irrévocable la dualité de l'ombre et de la lumière. S'il n'y avait que la recette, et le secret qui la voile, convenons que depuis longtemps nous n'y songerions pas plus qu'à un mauvais rébus. La dualité d'elle-même se serait éteinte un jour de concours Lépine. Mais l'opérateur étant en cause, l'alchimie s'inscrit en faux contre cette dualité et semble bien de très haut la dépasser dans une vue symbolique dont la cohérence se fonde non point sur des critères rationnels dont l'existence resterait purement médiate, mais sur les analogies immédiates et les chaînes d'images que l'Œuvre noue dans l'Etoile du Nord. Ces directions privilégiées, ces clivages de l'univers, on ne voit pas que leur auscultation se soit jamais pourvue d'un meilleur instrument que la pensée symbolique, comme en poésie électivement usitée en alchimie dès que le texte se propose plutôt que l'exposé des résultats, de transmettre dans leur aspect authenti- quement révélatoire les éclairs qui entre la chose, le mot et l'image, signalent la cohésion d'un instant de toute puissance. Ainsi voyons-nous la littérature alchimique s'étager sur de multiples plans; en dehors de textes purement spagyriques, pour les précieuses indications qui s'y ren- contrent utilisées quoique avec précaution par l'investigateur de science, les innombrables traités traditionnellement reconnus pour alchimiques, se présentent comme des manifestations du jeu éternel entre ce qui doit être voilé d'allégorie, et ce qui, hétérogène à toute sorte de langage, ne nous par- vient que reflété et peut-être obscurci par la matière verbale. Mais de processus qui à nos yeux paraissent si distincts, l'alchimie justement prétend abolir la différence, en s'établissant dans une continuité parfaite qui instaure un univers harmonique comprenant tout le ciel autour du microcosme avec l'opérateur et son langage. Et tel est cet état de correspondance — dont il faut bien convenir que l'univocité n'est pas la première qualité — que le langage symbolique ne se trouve ici pour qui l'utilise ni moins ni plus symbolique que tout langage, mais qu'il est immédiatement adapté par les multiples ressources de sa grammaire, à ces jeux, à cette danse, à ce tourbillon où l'oreille se prend avec délire pour se convaincre enfin que l'essentiel du message est aussi bien que l'Adeptat incommunicable. Pas davantage en alchimie qu'en poésie la communication ne se tient pour satisfaite du champ de la pensée discursive. et l'intelligence que les auteurs prennent d'eux- mêmes, en désespoir de parler, ne paraît pas étrangère à cet Art de Musique, qui désignant la science hermétique proprement dite, n'est pas moins propre à qualifier la littérature qui nous en reste.
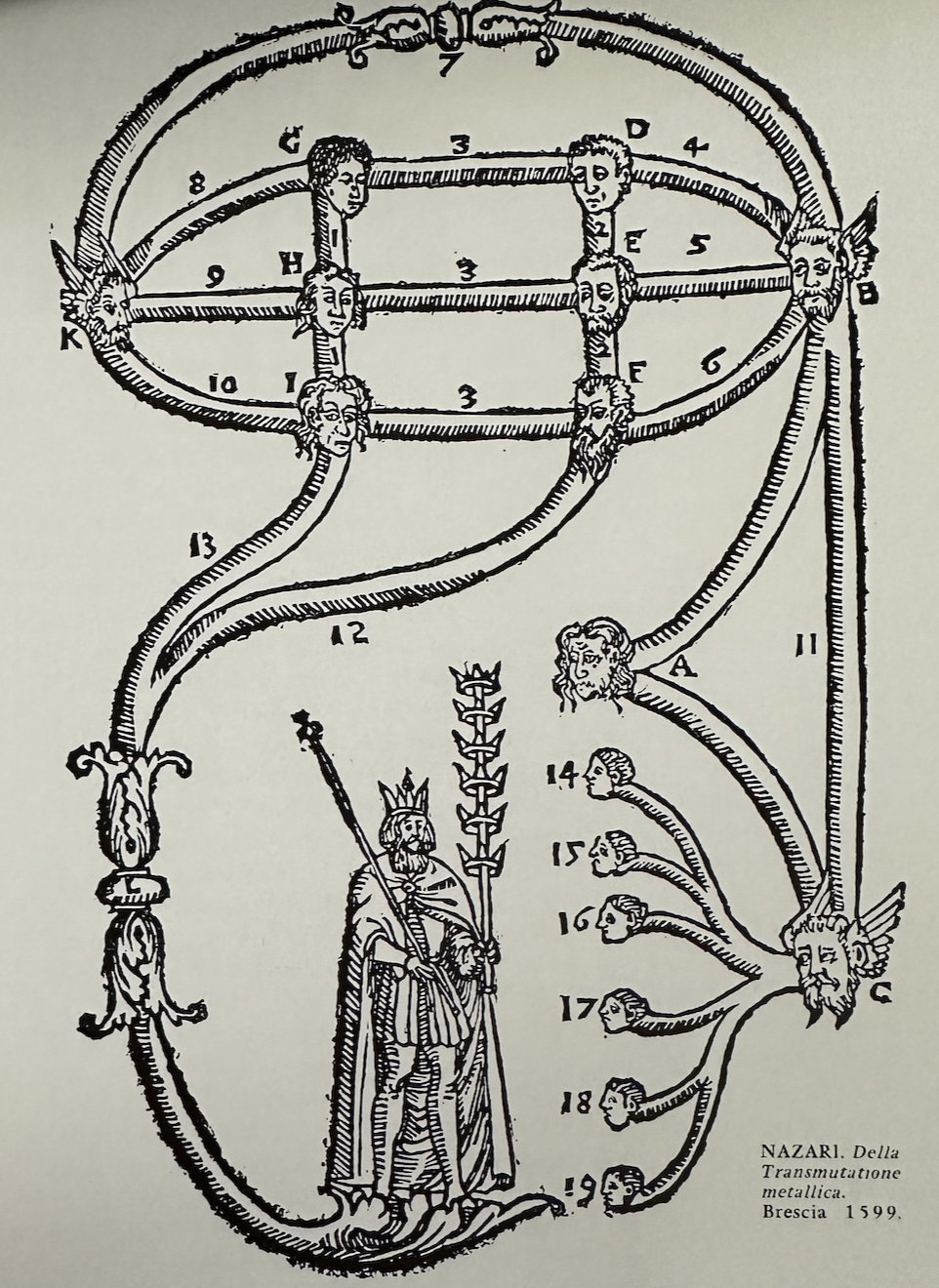
Leurs livres, les signes de l'art qu'ils ont laissés, parfois laissent entendre cette explication chuchotée qu'ils se donnaient à eux- mêmes; et c'est non pas la pensée qui eût pu vulgairement se trouver vingt travestis de rechange, mais sans doute la musique de l'art qui s'achève après sa forme et sa puissance parfaites, dans ce soupir où l'Adepte enfin savoure les fruits de son œuvre. Or, par la structure du langage alchimique, si nous croyons pouvoir inférer quelque chose des opérations mêmes, c'est que le langage ici est efficace, homogène à l'expérience, et que d'abord il nous comble, et nous attache nous tentant de ces recherches qui le prennent pour support. La multiplicité des plans symboliques nous introduit à cette grande perplexité, précédemment identifée avec le Chaos de l'Art. L'initiation a ici pour premier objet le secret du langage. Mais ce secret n'est autre que celui de l'œuvre, puisque la matière du langage répond à sa structure formelle. L'artifice de la parole reprend celui de l'œuvre et le prolonge jusqu'à nous. Au détour du chemin, il faut bien que nous en venions à découvrir la clef tréflée d'or dont parlent les contes, la petite clef dont nous persistons à tout ignorer sinon qu'elle est unique, et qu'elle seule ouvre à la fois et tout ensemble les secrets cabinets de la nature, la voie de l'Adeptat, et l'intelligence de la langue des Oiseaux. En son Histoire comique des Etats et Empires du Soleil 18, Cyrano de Bergerac rapporte que dans une fondrière un petit homme tout nu le harangua durant quelques grosses heures en un langage qu'il n'avait jamais perçu, mais qu'il entendait mieux qu'aucun qu'il eût appris. Cette langue universelle serait-elle la clef même, ou plutôt ce qui nous tient quittes de toute recherche : la langue dont « le premier homme de ce monde s'était indubitablement servi (...) parce que chaque nom qu'il avait imposé à chaque chose déclarait son essence ». Quant à cette intelligibilité souveraine, Socrate dans le Phèdre n'était pas plus explicite lorsqu'il discourait à propos du chêne de Dodone, et c'est peu dire qu'il inaugurait les dogmatismes ultérieurs, puisque n'est pas mentionnée la tradition selon laquelle l'une des colombes de Thèbes s'envola vers Dodone pour y être changée en chêne. Que Socrate se borne à célébrer le chêne comme rendant des oracles véritables, voici que le langage augural se réduit à l'utilité d'un rapport, tout égard dû à la vérité des choses et à leur essence. Médium, mais déchu de sa qualité d'esprit, il n'est pas autre que le moyen d'expression et de témoignage dépourvu d'efficace, adapté à la vie d'agrément, aux travaux d'inventaire et aux besognes policières. Rien que la vérité, toute la vérité pourvu qu'on ne change pas la vie. Ecoutons pourtant : à l'oreille de la Reine Candace la huppe encore murmure. Est-il question du ciel ? Les éclairs sont-ils éteints ? Dans l'instant s'éveille ce chant dont il est dit : « Dans la Musique, ce Vrai ne se rencontre jamais, que l'âme aussitôt soulevée ne s'y porte aveuglément. Nous ne le voyons pas, mais nous sentons que Nature le voit (19). » Ayons gré à Cyrano de Bergerac, que les confidents de la Science avouent pour un des leurs, de ce beau fixe pour déplorer que si tôt soit expédiée, et nous soit jetée dans les jambes une connivence qui prétend pourvoir l'esprit de toute l'efficience désirable dès que s'établit la relation avec l'essence. Si le recours à l'essence nous paraît décevant, il faut bien que l'objet se soit graduellement sous nos yeux ségrégé pour réaliser sa spécificité individuelle aux dépens de ses relations harmoniques. C'est pourquoi reste à conclure ce que veut sans doute nous faire entendre Cyrano, que l'essence ne peut être efficacement nommée ni dans l'individu, ni dans sa généralité abstraite, mais dans son histoire et ses rapports dynamiques. Pour préciser les implications du débat, Corneille Agrippa que l'on sait fort étranger à tout dogmatisme abstrait signale que « les paroles sont un moyen très propre entre celui qui parle et celui qui entend, portant avec elles non seulement le concept mais la vertu de celui qui parle, qui passe par une certaine énergie dans ceux qui les entendent et qui les reçoivent, souvent d'une telle force qu'elles ne changent pas seulement ceux qui les écoutent, mais d'autres corps et des choses inanimées (20)». On ne saurait mieux exalter la valeur des images : mais n'est-ce pas entre elles qu'elles communiquent. Si le Phénix a trait à la palingénésie métallique, comme idéalement adéquate aux vertus de l'or potable, voilà que son envol dans ce ciel d'élégance conduit au berceau de la langue des oiseaux. Il est improbable que les Egyptiens aient vu dans le langage beaucoup moins que le seul recours contre la mort, puisque ce qui ne nous parvient que sous la cendre des « paroles de puissance » les assurait au passage des jours sombres. L'entremise de Nature y suffit dès que sont formulés les mots à quoi elle est tenue de se rendre. Esprit ou souffle, la parole dans son histoire légendaire est bien cette efficacité souveraine, désignée comme la verge de l'Ancien des Anciens (21) par la Kabbale juive et identifiée avec sa langue. La parole jetée comme un pont entre l'époux et l'épouse évoque des parades primordiales, des jeux suprêmement phosphorescents dans le ciel très pur d'avant les conceptions, le jeu de séduction des miroirs ondulant d'un même jet de dé. Dans les vibrations amorties que quelques-uns se sont trouvés en mesure de nous transmettre de ces actes, saluons les jolies constellations formées de victorieuses voyelles et d'ombres repoussées par amour, non pas du tout « froides d'oubli et de désuétude » si le « compte total (22)» depuis longtemps formé est ce à quoi, ce jour ne peut que nous destiner l'inutilité du langage comme récit et l'impossibilité du langage comme efficacité. A la rigueur de cette sorte de menaçant silence il s'en faut que le siècle dans quelques-unes de ses manifestations les plus voyantes sache opposer une égale rigueur. Le langage que l'on écoute est celui qu'on ne sait plus entendre : du monde primitif. de la nature pure l'on espère bien nous livrer la traduction qui à défaut de constituer une clef préfère jeter sur les conditions précises de notre parole un voile d'érudition prétendue. Quel que soit l'intérêt qu'il est loisible de prendre à la connaissance des peuples dits primitifs. Quelque créance que méritent quelquefois des études élaborées sous le couvert de la science, il n'est pas sans portée d'en noter l'actualité ni de joindre au dossier, outre tels reportages, leur vogue même bien trop commune pour que ses motivations n'aient pas la généralité et l'efficace des besoins en question (23). Dans un livre consacré aux peuples mélanésiens (24), l'ancien missionnaire Maurice Leenhardt, entre nombre de vues de grand intérêt quoique fréquemment un peu tremblées, nous livre les conclusions suivantes : I. « La langue ne contient aucun terme pour traduire avec précision le verbe mourir. On ne meurt pas. » La mort est simplement la fin des activités dans le clan et l'accession au domaine des ancêtres qui le gouvernent. 2. « Moins est différenciée la notion de cadavre et de dieu, moins est différencié l'espace où se tiennent les vivants et les défunts.» 3. Pour le Mélanésien « le temps (étant) ramené à une qualité (il est) impossible de le voir ramené à une mesure géométrique. Le Mélanésien, ignorant de son corps, incapable de classer objectivement, (est) incapable d'avoir une histoire, et toujours en proie à un sentiment d'identité avec le monde qui l'empêche d'être soi- même. » 4. Le même vocable sert à désigner toute modalité d'expression, la parole et l'acte jouant sur ce plan dans une parfaite équivalence avec les intentions qui président à ces modalités ou avec les résultats qui s'ensuivent. Ce paradis naturel qui paraît beaucoup moins refléter l'objectivité comme on serait en droit d'attendre que contribuer à l'élaboration d'un mythe, dans ses complaisances envers un Immédiat perdu dévoile bien plutôt son lieu de confection, ce moment intellectuel, sa date, l'effondrement des dieux, le désir oisif et l'appétit de participation. Il faut entendre ou nous en sommes, faute de pouvoirs immédiats ou de l'adéquation propice de ces pouvoirs à une matière historique. Tout se passe comme si l'homme d'occident mal guéri de sa mère cherchait par tous les moyens à reconstituer dès sa naissance une continuité dont la rupture ne cesse d'être ressentie douloureusement. Au cours de cette adolescence au long de laquelle les religions dites révélées ont été investies de cette fonction, le devenir de l'esprit n'a pu que se constituer dans ce contexte, et sous le regard même des prêtres évidemment intéressés à rendre impossible la justification de l'être séparé. Même chez un mystique comme Eckhart, la relation de l'âme à Dieu et leur interpénétration sont explicitement chargées de cette justification qui s'étale et s'épand d'ailleurs à partir de l'individu sur la diversité changeante. C'est toujours avec la même implication majeure, visant à racheter l'individu d'être né, comme s'il avait à être justifié de si peu que ce fût, que l'aspect panthéiste de la doctrine se trouve souligné chez François d'Assise ou chez les çoufis qui reflètent d'un peu moins loin la vie primitive telle que nous l'imaginons. La vue religieuse des choses fut construite dans l'ennui des cloîtres, il était encore plus précieux d'y trouver la justifiante compagnie d'un dieu qu'une consolation, et c'était en même temps la consolation d'être né. Quand les dieux eurent été déconsidérés, dans l'époque même où l'occident pouvait renouer avec la vie primitive, dans ce qu'avaient suffi a en révéler les grands voyages, l'on tenta de retrouver la justification qui s'effondrait dans une communication immédiate avec la vie naturelle. Révolution considérable qui a conduit aux plus authentiques trouvailles du romantisme puisque la justification résultait non plus de la communication avec un père irrité, mais de l'indifférenciation de l'immanence. Au sacré de tremblement, Rousseau comme Lévy-Bruhl substituent le mythe d'une vie primitive où l'individu participe non moins à la vie du clan qu'à celle de la nature, l'une et l'autre immémorialement définies par leur harmonie même (25). Une description psychologique (26) ne paraît pas en épuiser le sens : retenons qu'elle en marque à la fois le caractère névrotique et réactionnaire. Tandis que les quelques « primitifs » aujourd'hui préservés détiennent, il va de soi, une conception de l'univers qu'ont éteinte en nous les âges de fer, une apothéose de l'indistinct s'est édifiée pour tirer de la connaissance de ces peuples, non le parti nécessaire dans l'état présent des civilisations, mais un parti tranquillisant qui s'inscrit pour les corroborer dans des dogmatismes périmés, et spécule consciemment sur de très pauvres fringales que l'occident s'est donné pour mythes (27). Des démarches aussi délibérément confusionnelles, d'ailleurs insidieusement, reçoivent réplique de leur objet même; ce que les « primitifs » nous montrent d'incontestable, (disons faute d'appellation plus exacte, des œuvres d'art), n'a rien pour évoquer un paradis chrétien ni quelque naturisme de bazar. Ces derniers du moins nous montrent-ils la culpabilité et le besoin de justification, à plaisir projetés sur les sociétés primitives, comme les modalités essentielles du religieux, tares d'un univers cloisonné où les conditions d'oppression intellectuelle et économique survivent à la conception du monde qu'elles avaient suscitée pour se rendre socialement possibles. Or de ces nouveaux mondes nous avons mieux à attendre qu'une leçon de nudisme, ne serait-ce qu'à la faveur de l'inlassable générosité d'une nature toujours prête à se servir à soi-même d'ornement, si peu que l'homme y mette la main. Pour avouer cette ombre portée par le dualisme ambiant sur les produits de la pensée, l'esprit d'autant moins se satisfera d'une régression dépourvue de toute valeur dialectique, et que l'on tient à lui donner pour la clef des contradictions de l'heure, encore qu'elle vise tout au plus à restaurer un subjectivisme d'autre part fort ébranlé par le discrédit des « grandes religions ». Si l'activité poétique était pour Hoelderlin la plus innocente de toutes (28), elle est non pas celle qui innocente, mais qui témoigne aujourd'hui de l'innocence première. Comment dès lors trouverait-elle son compte aux leurres de prétendues justifications ou aux refuges d'une érudition dont le mieux qu'elle puisse attendre serait qu'en fussent éclairés les termes d'une opposition qu'elle s'attache vitalement à résoudre ? La vie vraie, disons la survie de ce que chacun peut avoir de son existence tenté de placer dans une lumière cendrée de toute cohésion, sans doute est-ce à ce prix : hommes d'affût dans la fugacité des chances, aux lisières des lunaisons à venir; les palétuviers ont beau jeu de s'étaler sur les berges; au pont du diable il manque encore une arche, la poésie en est réduite à calculer ses élans. Mais entre jour et nuit, le seul vol rêvé est celui de la parade ancienne dont les alchimistes nous signalent la très possible permanence. Du soleil à la lune hermétique, au-dessus d'un torrent vif, il n'est pas d'ombre qui subsiste pour qui jette le pont en forme de trait d'union (29), troisième principe matériel, cause efficiente de toute alliance s'il conduit à l'obtention du Rebis. Telles conjonctions en ce qu'elles ont d'inattendu et pour l'artiste de comblant au possible, que serait la pensée poétique si elle ne s'en trouvait aussitôt alertée et hantée, puisque son exercice est d'en tenter indéfiniment la fixation. En ce point sur l'arche scellée à la clef des voyelles peintes, c'est là que se répète le chant de la création comme il nous parvient dans le Zohar, celui du père et de la mère de l'œuvre; et que les paroles de séduction gantent nos gestes à l'aventure, c'est que la matière de l'œuvre, au témoignage des maîtres, est la plus commune qui soit, la plus lointaine, la plus avilie, destinée au frisson avec violence dans « l'air noir et beau ». Mais il n'y a pas d'opération sans artisan secret. Il n'est rien dans ces bois qui n'aille à la fascination pourvu que l'étincelle imaginaire lance le pont des belles rencontres (30). Serait-ce qu'on oublie de le passer, à cause des crispations anciennes, de vaines recherches ? A la pensée positive dont la tyrannie et l'intolérable prétention chaque jour s'assurent sans valable compensation, la pensée symbolique ne peut que s'opposer avec scandale. En deçà d'une hypothétique connaissance absolue proposée par les diverses sagesses, il n'est de connaissance que symbolique, mais d'autant plus loin de son objet qu'elle se veut plus positive; tandis que l'épistémologie se résigne, avec de nobles accents de regret, à la qualité métaphorique des concepts, c'est leur efficacité seule que l'on voit concourir à l'édification des structures sociales (31). Il est à craindre que la reconnaissance comme unique critère objectif d'une quelconque efficacité, comme l'attrait des pouvoirs (32) ne soit en ce sens fatale à une perspective symbolique que tout invite à croire inefficace tant qu'elle ne sera que symbolique. autrement dit justiciable d'une interprétation. La pensée symbolique restera intraduisible à la mesure de la cohésion qu'elle aura obtenue entre son objet (supposé) et sa matière. Il s'agit bien de noces chymiques, puisque visiblement, les images ne sont pas faites pour rester dans les livres, à peine pour y passer entre tel et tel œil, revivifiées de chaque écho dans les œuvres successifs. A la nuit rêvons d'avoir trouvé sous des ramures parentes une main nue de morte coupée la veille par amour. Que s'agirait-il d'en consigner les gestes, enveloppés déjà de suspicion ? Tandis que tous les possibles à voir éclore s'inscrivent dans l'instant d'une désappropriation, le seul à valoir le va-tout. Les doigts d'os aux ongles d'obsidienne ouvrent la voie de la puissance : alors la grande trouvaille est celle du Réel, dont la structure coïncide bien avec celle de l'esprit dès qu'à celui-ci l'usage de la parole a montré que l'identité relevée par Hegel sur le plan rationnel doit s'entendre comme analogie sur le plan imaginaire (33). Dans ces ombres, lieu des éclairs, il n'est aucun besoin des innocences antédiluviennes puisque s'y établissent à toute volée les seules puissances qui en justifiaient le mythe. Au monde il n'est de lieu qui ne soit point d'union et de fermeture, renouvellement d'un cercle. Mais s'il survient en des épisodes que l'on ait à se situer par rapport à Hegel, force est bien de convenir que c'est aussi pour filer sous le vent d'un dogmatisme qui paraît sur le plan sensible, s'accommoder beaucoup mieux de fermetures que de résolutions ouvertes. Or la vraie gnose est attente (34). L'équivalence des mouvements d'abstraction et de particularisation ne donne à voir sa face de merveille que dans un objet tangible et actuel, situé dans un instant qui est l'annonce d'une paix après l'histoire. Cet étrange a parte dénonce explicitement, s'il est besoin, la misère d'une poésie de place publique, où l'extrême particularité des objets ne va qu'en se diluant à mesure que le subjectivisme, ou l'abstractivisme s'en empare. C'est tout au contraire à travers les futaies qu'il faut maintenant s'aventurer, avec la chevèche connaisseuse d'étoiles, vers la Polaire (35) sur laquelle Philalèthe conseille de régler notre route. Cette griffe ésotérique nous prévient que les objets ne sont rien que des signes et que la fonction des signes est de s'assembler en objets. Traité comme une horlogerie délicate, le poème si l'on y prend garde ne révèlera rien de moins fermé que tel objet, celui par exemple qui l'aurait suscité. Mais à l'objet même, comme à la délectation morose à quoi conduit inévitablement l'analyse de rapports d'extériorité qu'on se contenterait de subir, le poème oppose d'abord le cri du mystère percé. Avec des signes d'objet, les éclairs font un contre-objet — objet selon la surnature, ou la préhistoire, si l'on veut — produit contradictoire qui est l'accomplissement de la parole comme copule. Dans le pôle est le cœur du Mercure (36). L'accomplissement dont le poème témoigne pour la parole, tient aux diffractions multipliées qui la dispersent pour la renouer enfin en aurore boréale. Dans ces vibrillons de lumière, quoique en plein ciel des Philosophes, notre aiguille ne laisse pas de s'affoler, parmi les champs tournants et les girandoles, que viennent se vriller les jolies bulles du désir. Magnétiquement attirées par l'Etoile, comme l'âme de Gérard dans Aurélia, au passage elles affirment que leur accomplissement est investi d'une valeur éthique qui exige l'irréversibilité (37). Tant que l'on n'aura pas fait plein jour sur les valences multiples (38) qui font la vie des images, la poésie ne sera que le supplice élu par quelques-uns pour y chanter. Aujourd'hui si les poètes font leur le mot d'ordre de Lautréamont : la poésie doit être faite par tous, non par un, leur exercice se situant à l'extrême pointe de la possibilité individuelle, le produit de cette activité ne peut se concevoir, semble-t-il, que comme initiatique, au même degré que les livres d'alchimie abandonnés à notre perplexité. Sans doute les victoires humaines restent-elles des plus voilées. Dans celles qu'il nous est bonnement laissé d'avoir, la bourrasque toutes lampes soufflées nous accorde à la pensée que le concert de la nature et de l'art, a conduit quelques êtres jusqu'au terme prochain de l'espèce. Toutefois, si l'on veut encore s'étonner que les Adeptes se soient livrés à des exercices littéraires (39) et que nous les tenions pour poétiques, c'est que la poésie y reconnaît ses visées. Au jeu des matières, répond dans le poème celui des images : les produits de l'œuvre hermétique n'étant qu'exceptionnellement utilisés à des fins initiatiques, ce rôle reste dévolu aux textes qui conservent en outre des traces éclatantes de leur origine. En sorte que l'œuvre poétique constituant sa propre manifestation, beaucoup plus que des manuels d'initiation laisse après lui l'objet même, révélatoire cacheté de cire rouge. Au juste fléau qui balancerait l'esprit avec le réel, on a vu qu'il convient de substituer une image toute différente, celle par exemple qui à l'esprit ferait combler l'entre-deux des images ou des matières. On lui reconnaît alors des domaines où trouvent leur jeu les diverses complexions, comme l'historicité des individus. L'œuvre, son produit passe pour le diagramme des champs décelés puis électivement empruntés dans le cours de l'opération. Or l'alchimie se livre à l'étude de champs précis, aux frontières strictement définies; elle procède au fractionnement canonique d'une seule variété minéralogique et se soumet à l'intervention d'influences dont le repérage n'est si délicat qu'à cause de leur unicité. En ce sens l'alchimie est une science, et le symbolisme qui s'y associe est traditionnel. Tout à l'inverse, l'extrême liberté de la démarche poétique ne reconnaît aucune frontière à ses domaines et n'est aucunement traditionnelle. Que dans la rédaction de leurs traités, les Adeptes aient dû se construire un langage propre, la cohérence de celui-ci n'est fondée que sur la possibilité de son interprétation dans le cadre traditionnel (40). Entre les textes alchimiques, et la poésie qui ne symbolisera qu'elle-même, ou ne sera pas (41), les rencontres sont par écho : la vraie rencontre est entre les œuvres réels. L'œuvre hermétique y apparaît comme cas particulier d'une poétique générale. Perdue, éperdue de s'être laissé couler si loin, jusqu'en ces ombres où les lucioles éveillent le feu, par delà des raisons dérisoires, d'ailleurs fatales ou stériles, la poésie maintenant doit opérer dans les sous-œuvre jusqu'à la toute puissance du désir.
Vincent BOUNOURE 11 août 1957.
- « La physique spirituelle a toujours été ma science de prédilection », dit Arnim (Les Héritiers du Majoral). Science ancienne, au possible abandonnée, laquelle pourtant aurait à tâche de nous apprendre, après Freud, après la Gestalttheorie, les sources et les chimies du désir. L'inventaire des faits devrait, semble-t-il, n'être tenté que pour se prolonger dans cette dynamique intérieure, dont la puissance d'éclairement ne peut qu'à peine se soupçonner, mais, dans son ordre, ne resterait pas au-dessous de celle, par exemple de la thermodynamique au cours du siècle dernier. Que si l'on aborde aujourd'hui tel domaine, on en est vite, faute de travaux précis, réduit à des analogies énergétiques qui demeurent bien entendu infiniment vacillantes, et douteuses. La plus exploitée à cet égard est l'analogie électrostatique. propre à figurer la chiennerie commune. Et s'il s'agit bien en effet d'énergie, il est urgent de faire entendre que c'est par égard pour l'étincelle. Mais au lieu de s'évanouir, elle luit toujours - idéalement et comme attente — sur le faîte de l'esprit.
- Phénoménologie, VI, Bc (trad. J. Hyppolite, Aubier 1939-51, t. II, p. 130 et sq.). Mais le cycle suivant ramène dans une position homologue qui prépare l'accession de l'esprit au savoir absolu.
- Phénoménologie, IV, 2 (op. cit. t. I, p. 145 et sq.).
- Ce poudroiement moderne, comment refuser de s'y rendre, d'en aimer la mobilité même, et l'impalpable étincelle? Rien d'autre en ce siècle ne s'est trouvé créé pour qu'il nous reconnaisse, pour que nous en venions à l'avouer. L'heure où les villes sont miraculeuses encore quelquefois sonne, répétée dans la belle verroterie, dans des luxes pailletés de nuit. Pourtant la loi de l'épicerie, qui est la seule, ne s'accomplit que dans une désagrégation du désir dont ici, à six heures, nous lisons la face étoilée.
- Cf. Le Surmâle. Roman moderne. Passim.
- « Afin donc que ce très grand Secret, qui est la Pierre, à laquelle on n'ajoute rien d'étrange, ne se perde pas à l'avenir, j'ai résolu d'en écrire quelque chose de certain et de véritable, ayant vu cette bénite Pierre, et l'ayant tenue, dont Dieu m'est témoin, et j'en confie le Secret à toute Ame sacrée, sous peine de périr, si elle le révèle aux Méchants. C'est pourquoi les Philosophes ont appelé ce Secret la Parole Délaissée, ou tue en cet Art. » Bernard le Trévisan : La Parole Délaissée, in Cl. d'Ygé, Nouvelle Assemblée des Philosophes Chymiques.
- Les conjectures suivantes, purement profanes, s'exposent à rester très en degà de l'intelligence d'une science qui s'est toujours donnée pour sacrée.
- De cette assimilation, mais avec échanges, on trouve de nombreux exemples dans les textes de caractère symbolique. Depuis l'exégèse de Fulcanelli, on sait que l'introduction du Livre des Figures hiéroglyphiques, présentée sous les couleurs les plus ordinaires par Nicolas Flamel comme un récit de ses aventures de voyage, traite sous ce voile des aventures et transformations successives de la matière. Cet artifice est usité dans de très nombreux textes anciens ou modernes. Comme c'est ici le cas, le récit est fréquemment à la première personne, établissant nettement la correspondance symbolique du sujet et de l'objet. On trouvera des atilisations particulièrement brillantes de ce procédé dans le Songe Vert du Trévisan les Noces chymiques de J.V. Andreae, l'Hermès dévoilé de Cyliani. En d'autres textes entre les modifications de la matière et celles de l'alchimiste, celui-ci introduit des plans symboliques intermé- diaires, dont les transformations sont alors seules décrites dans le langage propre à ces mythologies de référence. Une vue symbolique de cette ampleur n'est pas sans jeter une mbre de discrédit sur les métaphysiques descriptives, purement dualistes, qui se proposent laborieusement l'étude successive du sujet et de l'obiet. Rappelons enfin le témoignage de René Alleau (Aspects de l'Alchimie traditionnelle, Ed. de Minuit, 1953, p. 34) : « A aucun moment les métamorphoses intérieures de l'obser- vateur semblent n'avoir été conçues indépendamment des mutations du système observé. Non seulement l'ascèse alchimique proclame l'unité de la matière, mais elle témoigne de l'union de la matière et de la conscience comme de la souveraine puissance de l'« esprit délivré ».
- C'est cet aspect de l'alchimie traditionnelle, qui d'autre part se rencontrant historiquement avec les recherches spagy- riques, a donné lieu aux interprétations matérielles de l'Œuvre.
- « Ces Principes sont les diverses Opérations dont l'Artiste se sert pour faire le Magistère », dit Geber pour ouvrir les fragments de sa Somme qui leur sont consacrés (chap. 39 à 54 de la première partie, cf. Bibl. des Philo- sophes Chimiques, Paris 1741, t. I). Tous les alchimistes de formation scolastique entrent à ce sujet dans des détails d'un luxe inextricable.
- Cf. Fulcanelli, Les Demeures Philosophales, Paris 1930, p. 304-305.
- « Si vous préparez comme il faut votre artifice à la Nature, et que vous preniez bien garde que tout ce qui doil se faire dans le Magistère soit bien disposé, il est san: doute qu'il recevra sa perfection par la Nature, sous une position qui lui sera convenable, sans qu'il soit nécessaire que vous observiez cette position. » (Geber, op. cit., Pre. mière partie, chap. 11.)
- « C'est la nature, à laquelle par notre artifice nou préparons la matière, et lui disposons les voies; parce qu d'elle-même elle agit toujours immanquablement, et nous n sommes que ses Ministres dans les opérations que nous lu faisons faire par notre Art. » (Geber, op. cit. ibid.) Cette vue n'est pas sans évoquer le rôle que le matéria lisme dialectique assigne au héros dans l'histoire. L'interven tion de l'Artiste dans le processus concret du microcosme comme celle du poète dans la société bourgeoise, se prêt volontiers à la description donnée par Trotsky de l'action d Lénine au sein du développement historique (Histoire d la Révolution Russe, t. II, p. 157-158). La Dialectique Ar Nature se développe ici sous les espèces de l'Individu et d l'Histoire, et ne trouve à se résoudre qu'en « considéra l'individualité comme un anneau de la chaîne historique : Retenons cette chaîne dont parle Trotsky, comme l'analogi de la Chaîne dorée d'Homère. « Or, quoique ces tro (principes), dit Salomon Trismosin dans la Toison d'C (Paris, 1613), ne proviennent que dune seule racine, ont-ils néanmoins differentes et indifferentes opérations, noms desquels sont infinis, selon les couleurs qui app raissent, et si le tout revient à un, savoir à cette fina rougeur, se servant comme de chaînons attachés si artistement les uns aux autres, qu'on n'y peut reconnaître aucul fin absolue, mais l'une finissant son action ordinaire, l'aut la recommence, parce que prima forma destructa introducit iterum alia, dit à ce propos Raymond (Lulle), lequ l'appelle encore en son Testament Calena deaurata, qui est société du visible avec l'invisible, et qui lie ensemble tc les quatre Eléments. C'est la belle chaîne dorée. Que j'ai circulant décorée. dit la Complainte de Nature. A raison de quoi Jean Meung en son Roman de la Rose, l'appelle paillarde, pal qu'elle se conjoint indifféremment à toutes les formes unes après les autres. » (p. 192-193.)
- Inutile de souligner une homologie déjà relevée entre le troisième terme dialectique, et ce qui en alchimie prend le nom de sel dans la trinité des feux.
- La cabale hermétique, ou phonétique a été définie par Fulcanelli (Les Demeures Philosophales, op. cit. p. 33 et sq., p. 310 et sq.), comme un langage phonétique usant de la grammaire des rébus et des armes parlantes. Il ajoute de façon révélatrice que la cabale est aussi la bride qui sert au chevalier à guider sa monture.
- Telle est du moins l'opinion qu'exprime René Alleau dans son beau livre : Aspects de l'Alchimie traditionnelle Editions de Minuit, 1953), cf. p. 118 : « Les alchimistes, respectueux des règles de l'obédience philosophique, ont voilé le nom vulgaire de leur « sujet» ou de la « matière première » sous un symbolisme extrêmement complexe, non sans de pertinentes raisons, dont l'une des plus importantes dut être que le néophyte se trouvât dans l'obligation logique de réformer son entendement « profane » par ses seuls efforts personnels, en se pliant à une série d'exercices mentaux dominés par la cohérence interne et surrationnelle des symboles. » En ce sens assez proches des maîtres du Zen, les Adeptes ont un grand bonheur dans un genre d'assez sombre mystification : « Ceux-là s'abusent fort, écrit Nicolas de Grosparmy (cité par Fulcanelli, Les Demeures Philoso- phales, op. cit. p. 48), qui cuident que nous n'ayons fait nos livres que pour eux; mais nous les avons faits pour en jeter hors tous ceux qui ne se sont point de notre secte. » Le secret philosophique trouve chez Nicolas Flamel une justification non moins singulière (Les Figures hiérop!y- phiques, cap. VII, in Trois traitez de la Philosophie Natu- relle, etc., le tout traduit par P. Arnauld. Paris. Marette 1612) : « Et vraiment je te dis ici un secret, que tu trou- veras bien rarement écrit, aussi je ne suis point envieux, plût à Dieu que chacun sût faire de l'or à sa volonté, afin que l'on vécût menant paître ses gras troupeaux, sans usure et procès à l'imitation des Saints Patriarches, usant seulement comme les premiers pères, de permutation de chose à chose, pour laquelle avoir il faudrait travailler aussi bien que maintenant. De peur toutefois d'offenser Dieu, et d'être l'ins- trument d'un tel changement, qui peut-être serait mauvais, je n'ai garde de représenter au écrire, où est-ce que nous cachons les clefs qui peuvent ouvrir toutes les portes des secrets de la Nature, et renverser la terre sens dessus dessous, me contentant de montrer des choses qui l'apprendront à toute personne à qui Dieu aura permis de connaître quelle propriété a le signe des Balances quand il est illustré du Soleil et de Mercure au mois d'Octobre. »
- L'accomplissement matériel de la transmutation est possible en deçà de l'Adeptat, et il semble qu'il le soit de diverses manières. Soit par des procédés spagyriques qui aboutissent à des substances nettement spécifiées quant leurs isent C'est le cas des procédés dont Basile Valentin traite assez abondamment, y jetant de la lumière non sans négligent mépris, sous le nom de petits particuliers. Si, selon Fulcanelli, la spagyrie est véritablement l'ancêtre de chimie moderne, elle ne présente aujourd'hui d'autre intérêt que celui, de stricte érudition, d'une histoire des techniques. A quoi parfois, en vertu du contexte s'entremêle la vigne hermétique. Mais en alchimie proprement dite, la formule de l'Œuvre, surprise ou trouvée par hasard, ne pourrait évidemment conduire qu'à la même poudre de projection qu'ont obtenue, utilisée, ou parfois distribuée les Adeptes. Mais la matière n'ayant pas de la sorte été canoniquement préparée, son élaboration ne constituerait aucunement le saut qualitatif qui sépare le souffleur de l'Adepte. Quant à l'ambiguite essentielle entre le plan matériel des manipulations reproductibles et le plan psychique qui lui correspond, il est bon de confronter ces deux textes empruntés l'un et l'autre et l'autre au même ouvrage de Fulcanelli (Les Demeures Philosophales, op. cit.) « De même que la nature donne au cultivateur la terre et le grain, au micro-biologiste l'agar-agar et la spore, de même elle fournit à l'alchimiste le terrain métallique propre et la semence convenable. Si toutes les circonstances favorables à la marche régulière de cette culture spéciale sont rigoureusement observées, la récolte ne pourra qu'être abondante... En résumé, la science alchimique, d'une extrême simplicité dans ses matériaux et dans sa formule, reste cependant la plus ingrate, la plus obscure de toutes, eu égard à la connaissance exacte des conditions requises, des influences exigées. C'est là qu'est son côté mystérieux, et c'est vers la solution de ce problème ardu que convergent les efforts de lous les fils d'Hermès (p. 66). » Toutefois la nature de la récolte parait s'écarter quelque peu de ce qu'il était raisonnable d'attendre d'une science ardue, fût-elle la plus obscure: « Sous l'action du feu élémentaire, l'opération reprise et poursuivie conduit aux grandes réalisations finales représentées (...) par deux roses. Celles-ci, on le sait, marquent le résultat des deux magistères, petit et grand, Médecine blanche et Pierre rouge, dont la fleur de Lys (...) consacre la vérité absolue. C'est le signe de la parfaite connaissance, l'emblème de la Sagesse, la couronne du philosophe, le sceau de la Science et de la Foi unies à la double puissance, spirituelle et temporelle, de la Chevalerie (p. 161). » Il est vrai que ces influences soulignées par Fulcanelli, et qui sont les esprits hermétiques, pourraient être prises pour des modifications d'ordre mental. Il n'en est rien si l'on en croit le même auteur qui affirme que « les esprits sont des influences réelles, quoique physiquement presque immaté- rielles ou impondérables. Ils agissent d'une manière mysté- rieuse, inexplicable, inconnaissable mais efficace, sur les substances soumises à leur action et préparées pour les rece- voir. Le rayonnement lunaire est l'un de ces esprits hermé- tiques (ibid. p. 52) ». Paroles de physicien, dont le ton se dément sitôt que les esprits ont pénétré la matière philoso- phale : « Prosternez-vous, mages de l'Orient, et vous, doc- teurs de la loi; courbez le front, princes souverains des Perses, des Arabes et de l'Inde! Regardez, adorez et taisez- vous, car vous ne sauriez comprendre. C'est là l'Œuvre divin, surnaturel, ineffable dont jamais aucun mortel ne pénétrera le mystère. Au firmament nocturne, silencieux et profond, brille une seule étoile, astre immense, resplen- dissant, composé de toutes les étoiles célestes, votre guide lumineux et le flambeau de l'universelle Sagesse, etc. (ibid. p. 182-183). » Devant la production du mercure philosophique (autre- ment nommé mercure des sages, eau des deux champions, sel de sagesse, quintessence de l'or des sages, graisse du vent mercurial) l'Adepte ne paraît témoigner d'aucun embarras, donnant à croire au contraire que l'artifice singulier, « et du point de vue chimique paradoxal », qu'il utilise est pour lui rationnellement justifé, qu'il s'impose naturellement dès que lui apparaît en toute clarté l'opération à réaliser. Cet artifice, travail de femme et jeu d'enfant, n'est aussi jamais révélé que sous le voile de l'allégorie. Mais il n'en est pas de même de la production du vent, ou premier mercure, matrice du précédent, eau vive, premier dissolvant, menstrue universel, lune des philosophes, obtenu à partir de la matière brute par « réitérée destruction d'icelle, en résolvant et sublimant ». Le mécanisme ici reste inconnaissable, et l'artiste ne peut qu'assister à l'apparition de la lune hermétique, laquelle reste une production de la nature. Cette inconnue, subsistant à l'origine du travail, dans la production du mercure commun, donne une couleur surprenante — quoique significative - à l'affirmation de Fulcanelli (ibid. p. 145) selon laquelle l'artifice inconnu qui permet bien plus tard d'obtenir le mercure des sages « marque le carrefour où la science alchimique s'écarte de la science chimique ».
- Ed. Delahays, Paris 1858, p. 181 et 182.
- Cyrano de Bergerac. Histoire comique... (ibid.).
- Henri Corneille Agrippa. La Philosophie Occulte ou la Magie. Paris, Chacornac 1910-1911, t. I, p. 196.
- Cf. Paul Vulliaud. Traduction intégrale du Siphra di-tzeniutha. Paris, Nourry 1930. La connaissance joue dans l'arbre sephirothique, aussi bien quant au Grand Visage que quant au Petit Visage, un rôle médiateur entre les émanations droites et gauches. Elle constitue le pivot qui autorise entre les différents étages de la construction la circulation vitale.
- Mallarmé : Un coup de dés.
- Du pain azyme aux trouvailles plus modernes de l'épicerie qui va jusqu'à faire payer l'origine particulièrement naturelle des légumes produits sans engrais, la recherche d'une « pureté » antédiluvienne tente également de fuir sans violence les conditions présentes. Les ouvrages de Lotus de Paini sur le totémisme magique, quoique déparés souvent par des allégations peu fiables, insistent à très juste titre sur la nécessité de ces conditions qui ne pourront être réduites qu'après avoir été assumées.
- Do Kamo. La personne et le mythe dans le monde mélanésien. Paris, Gallimard 1947.
- En son Eloge du Maquillage, Baudelaire ne manque pas de souligner que si l'art doit son support à la nature, ce n'est qu'afin de « s'élever au-dessus de la nature pour mieux subjuguer les cœurs et frapper les esprits ». Le Peintre de la Vie Moderne qu'était aussi Baudelaire, en ses affectations de décadence, était sans doute aussi peu intelligible que le primitif dans ses parures de fête.
- Rappelons que Freud, comme la plupart de ses épigones, analystes ou psychologues, fait chez l'enfant succéder une phase d'identification, une phase de choix objectal qui ressortit à l'esprit de possession. En ce sens, le retour à l'identification constitue une régression.
- A cette méconnaissance systématique s'en ajoute une autre, accidentelle quoique fatale, qui interdit à l'ethnographe professionnel d'approcher les ressorts magiques de la vie et des œuvres primitives.
- Cité par Martin Heidegger. Qu'est-ce que la Métaphysique? Paris, Gallimard 1938.
- Voir par exemple la neuvième figure des Elémenta Chemiae de Barchusen (rééd. Lyon, Derain, 1947).
- Au jeu de l'un dans l'autre, la pensée ne se connaît pas d'autre objet (cf. Médium 2 et 3). Elle vise à multiplier en lous sens ses démarches au travers des robes célestes, des « hiérarchies » cosmiques très funestement intellectualisées dès avant la Gnose.
- On s'étonnerait dès lors que celles-ci puissent refléter beaucoup mieux que l'éviction du qualificatif au profit du quantitatif qui caractérise la démarche de l'intelligence abstraite. Les « vertus » seules sont quantifiables. Entre le monde des « essences» tel qu'il a pu être conçu dans la pensée traditionnelle, et le monde des concepts scientifiques, il y a la distance de la poésie à ce dernier. Le concret au mépris de tout jeu, de tout luxe, n'est considéré que dans ses modalités utilitaires, à mesure que cherche à s'y substituer en trompe-l'œil le schéma de ses vertus. Il peut sembler que la science ainsi se voue à un écartelement entre le pragmatisme foncier de ses enjeux et la sécheresse glacée de ses moyens. Il est plus alarmant quoique de stricte conséquence que la même distorsion puisse se discerner dans la rue : l'art abstrait au service de la publicité, etc. La contradiction étant de pure apparence, et le constat de toute évidence, il n'en découle pas généralement une vue tellement claire de la résolution qu'il importe pour le sort de l'esprit de fournir, s'il en va là de beaucoup plus que le sort d'une civilisation (« l'antiquité grecque et romaine») dont on n'a plus à dénombrer les charges.
- La recherche des pouvoirs ressemble fort à celle des particuliers. L'une et l'autre asservissent l'existence à des enjeux limités, la vraie vie étant remise à demain. Cf. Georges Bataille, L'Expérience intérieure. Paris, Gallimard 1943.
- Dans ses Nouvelles conférences sur la psychanalyse (Gallimard, 1936), Freud relève l'analogie entre la structure de l'esprit et la structure cristalline à l'infini clivable selon les plans de la molécule intégrante d'Haüy. Les plans de clivage de l'esprit donnent ainsi une image préalable des félures préférentielles de la maladie mentale, celles-ci, en retour, permettant dans l'examen clinique de conjecturer la structure du cristal intact. C'est bien de clivages de ce genre qu'est préoccupée la pensée symbolique. Des interprétations des plus positives, suggérées par les analogies cybernétiques, mais évidemment restreintes à une fonction précise de la vie de relation ont été récemment avancées. Il va de soi que l'on ne peut ici ni les discuter ni les prendre en considération.
- Aux gnoses anciennes, celle d'aujourd'hui s'oppose en ce que répugnant à tout schématisme abstrait, elle n'éprouve aucune difficulté à tenir pour dépassées des opinions reflétant les sciences de l'époque. Mais, ne souffrant aucun frein à la liberté de ses démarches, elle s'y accorde par un même sens du réel, indéfiniment multiplié dans le plus concret de l'existence par le sens du possible.
- Philalèthe. Introitus apertus ad occlusum Regis Palatium, in Histoire de la Philosophie Hermétique, par Lenglet Dufresnoy, Paris, 1742, t. II, p. 22.
- Philalèthe. Ibid.
- L'irréversibilité poétique, déjà relevée dans Signe ascendant (André Breton, La clé des Champs, Paris, Le Sagittaire 1953), concourt au fondement d'une éthique, on le voit, fort différente de celle des philosophes XVIIIe siècle, mais également éloignée de la morale de Joseph de Maistre, à laquelle Baudelaire se réfère maladroitement dans son Eloge du Maquillage. La nature n'est innocente ou coupable qu'en vertu des matrices où elle est engagée.
- Si l'on tenait à moderniser le parallélisme observable entre les phénomènes de la création poétique et les transformations matérielles de l'œuvre alchimique, on pourrait songer, face à l'attirance dont il s'agit, élective affinité comme a pu la voir Gothe, à souligner les phénomènes électro-magnétiques qui permettant partiellement d'interpréter la structure de l'atome, expriment en effet, outre la gravitation électronique, les valences de la chimie classique, comme les ionisations ou les « transmutations» contemporaines. Malheureusement ce langage a le tort de rendre compte plutôt du contexte catastrophique que de la réalité de l'amour.
- Qu'ils s'y soient pliés témoigne beaucoup moins de leur indulgence ou de leur commisération pour les chercheurs égarés que de la nécessité d'une écriture, qui est ce que nous appelons poésie, dans l'opération de laquelle les mêmes procès sont en cours que dans l'œuvre alchimique. C'est ainsi que pour l'Adepte, la cabale et son exercice est à la fois la clef d'une lecture des textes, et le moyen dune invention qui met en œuvre les mêmes ressorts intellectuels, que ses résultats soient d'ordre opératoire ou poétique.
- A propos du livre de Michel Carrouges (Les Machines Célibataires, Arcanes, 1954) René Alleau a vivement éclairé l'opposition des structures symboliques ouvertes, interprétables au moyen de clefs qui leur sont étrangères, et des structures fermées, dont la cohérence d'ordre interne ne se réfère à aucune table de concordance qui leur soit extérieure, et qui ne sont nullement superposables entre elles (cf. Medium, n° 4, janvier 1955. Des fictions et des jeux.) Un texte alchimique particulier apparaît ainsi comme une structure ouverte, dans la structure fermée que constitue l'ensemble des textes (et de l'œuvre) alchimiques. Il n'y a pas de dictionnaire hermétique.
- Si la poésie était ce pour quoi nous la donne la critique subjectiviste : expression maximale de l'individu, relation d'états intérieurs, déballage sentimental ou idéologique, l'œuvre poétique ramene à une succession d'événements psychologiques occuperait par rapport aux écrits la position exactement homologue de l'œuvre minéral. Selon la qualité du matériel utilisé, on aurait alors un certain nombre de phylums divergents, mais permettant le classement commode des textes : poésie érotique, prolétarienne, ascétique, mystique, de circonstance, etc. L'intention délibérée de publicité qui présiderait alors à la confection des textes en constituerait la valeur initiatique. A ces lettres mortes, en chaque cas, il y aurait lieu d'étudier s'il faut préférer l'érotisme, le stalinisme, l'ascèse, la mystique, ou les circonstances. Il en serait de même dans une alchimie à la Jung, dont les processus se dérouleraient en effusions intérieures, au possible teintées de théosophie et de mysticisme.
Heinrich von Kleist, ou les rêves accomplis
HOMBOURG - Répondez : c'est encore un rêve?
KOTTWITZ - Un rêve que nous faisions tous.
(« Le Prince de Hombourg ».)
Poursuivi jusque dans sa gloire tardive de cette malédiction attachée à son vol noir d'oiseau de foudre, Heinrich von Kleist n'a cessé, dans sa personne comme dans son œuvre, de nous proposer, selon l'expression de Marthe Robert, « le domaine privilégié du malentendu » (1). Ce qui suit n'a pas d'autre ambition que de porter, si peu que ce soit, atteinte à ce mur d'hostilité, de méfiance ou d'incompréhension qui, même dans certaines admirations, dissimule obstinément l'exceptionnelle, la déchirante grandeur d'un poète en qui se joue à peu près tout ce qui nous importe encore. Malentendu entre le poète et son public, certes, mais il semble que Kleist lui-même soit le jouet des forces obscures qui l'inspirent, à tel point que son œuvre par instants déborde ses intentions conscientes, emportée par d'invincibles et souterraines pulsions. Identifier chez lui l'acte poétique à la démarche somnambulique, ce n'est pas assez dire puisque chacune de ses tentatives, littéraires ou non, paraît se retourner contre lui, déjouer ses plans et lui porter durement préjudice. Parler à ce propos d' « actes manqués » (2) ne se justifie cependant que si, à la manière de Freud dans sa « Psychopathologie de la vie quotidienne », on distingue au delà de l'échec apparent — auquel la critique veut trop souvent réduire la douloureuse expérience des poètes — la personnalité profonde qui nous est ainsi restituée. Homme divisé, oui, et cruellement, mais qui, s'il ignore l'étendue exacte en lui de ses pouvoirs cachés, se montre on ne peut plus persuadé de leur valeur et — en 1801 avec son condisciple Zschokke ou en 1807 avec le philosophe von Schubert — attentif à reconnaître dans le somnambulisme, les rêves prémonitoires ou la « distraction » chronique les voies d'accès privilégiées à sa propre vérité intérieure en même temps que les prodromes de ces " extraordinaires rapports avec la beauté et la haute morale » dont il se réclamera à la veille de son suicide.
Déterminés comme leur auteur par des formes pensée et d'action révolutionnaires mais en grande partie inconscientes, les personnages de Kleist ne cesseront de se heurter aux réalités comme les papillons aux lampes allumées qui tout ensemble les attirent et les paralysent. Car ces individus spécifiquement « nocturnes », guidés par une logique absolument étrangère à leur entourage, ne renoncent pas pour autant à la société — celle-ci serait-elle réduite à la personne de l'être aimé — et se trouvent naturellement en butte à l'incompréhension. D'où chez eux un ardent désir de se justifier qui va susciter les nom- breux jugements dont le rôle est capital dans plusieurs pièces: « La cruche cassée », le conseil de guerre du « Prince de Hombourg » et surtout « Catherine de Heilbronn » qui s'ouvre sur le tribunal de la Sainte-Vehme et se dénoue par le « jugement de Dieu ». Tel est aussi le ressort de l'étonnant « Michael Kohlhaas », admirable nouvelle traversée d'un sursaut de révolte d'une violence inouïe, histoire d'un marchand de chevaux possédé d'un tel appétit de justice que, pour obtenir réparation d'un hobereau abusif, il prendra les armes, ravagera une province et n'aura gain de cause enfin qu'au prix de sa tête " Déchirés entre leur nature d'êtres « en marge » et leur volonté de « communication » avec autrui, ces personnages verront leur effort de vivre marqué de ruptures continuelles. L'opposition du désir à la réalité sociale et objective sera signalée par des « chutes » répétées, indices de non-adéquation aux circonstances extérieures, d'insuccès provisoire ou définitif et parfois présages de mort, c'est-à-dire d'incompatibilité absolue du désir et de la vie. Ces chutes, révélatrices de dangereux obstacles invisibles, interviennent par exemple lorsque l'amour ne parvient pas à triompher (Catherine tombant par la fenêtre au départ du comte Wetter), ce qui dans la vie sentimentale du poète, jusqu'à la lumineuse et définitive rencontre d'Adolfine Vogel, se traduit régulièrement par la fuite. C'est au cœur de ce désarroi tragique de Kleist devant l'amour qu'il faut situer la genèse de « La cruche cassée », la plus inattendue de ses œuvres, dont le prétexte dérisoire et le ton grinçant ne font que dissimuler une sorte de négatif des drames, l'agressive et déprimante caricature du séducteur bafoué, le ridicule tragique de l'échec amoureux. L'abjecte personne du juge Adam — qui perd tout lorsque son échec est rendu public par les marques physiques de sa chute — n'est que la charge la plus repoussante de Kleist lui-même, comme s'il espérait par l'ignominie de ce bouc émissaire se délivrer de redoutables interdits. Entre Adam (le juge) et Eve (la jeune fille) ne se pose pas de problème plus brûlant que celui des rapports de l'homme et de la femme. Et l'équivoque habile de l'œuvrette bien connue de Greuze qui porte le même titre que cette comédie nous entraînerait à voir dans la cruche l'image de la femme et de l'amour qu'elle inspire, son bris signifiant pour Kleist la ruine de l'espoir qu'il plaçait en la femme. L'amour, on le sait, n'apparaîtra dans son existence que pour en fixer le terme, mais l'extraordinaire sérénité l'enthousiasme grave des letires adressées à Marie de Kleist. la cousine bien-aimée, plusieurs jours avant le double suicide (4) ne s'expliquent pleinement qu'une fois admise la possession charnelle couronnant enfin, au seuil de la mort, l'amour partagé. A la différence de Goethe creusant sans cesse le fossé qui le sépare de Werther, Kleist accomplit son destin en digne frère de ses héros. La passion dévorante, portée à un tel point d'incandescence qu'elle ne peut que consumer jusqu'à la chair même des amants, telle est « Penthésilée ». Un regard aussi profond, aussi bouleversant que celui de Sade explore ici les abîmes du cœur humain, dans une lumière de moins en moins soutenable au fur et à mesure que se durcit, l'air se raréfiant, le délirant despotisme de l'amour. A la différence de Julien Gracq, " qui ne se sent concerné que d'assez loin par cette œuvre où pour ma part je situe le sommet le plus élevé de la poésie dramatique universelle, il m'est impossible de l'aborder sans me sentir brûlé de cette lave ardente où se conjuguent la plus déchirante tendresse et le plus impétueux désir. De même, je me sens beaucoup moins convaincu que lui de la résonance « spécifiquement germanique » de ce poème où la guerre n'apparaît « joyeuse » que dans la mesure où son élan agressif se confond avec celui de la chair conquérante, car elle n'est autre que la « guerre des sexes », impitoyable et caressante. Celui qui jugea très tôt « odieux l'état militaire (...) au point que peu à peu l'idée (lui) devint intolérable de devoir collaborer à ses tâches », s'il lui fut impossible de donner à ses principales œuvres un autre fond de décor que ces guerres incessantes qui, de Jemmapes où il reçoit à quinze ans à peine le baptême du feu à sa mort en 1811, ne cesseront de projeter sur son existence leur ombre sinistre, obéit à d'autres mobiles que l'exaltation des valeurs militaires qu'on lui prêta rituellement. La guerre, si elle semble le milieu naturel de certains de ses personnages dont quelques-uns la portent avec eux comme la nuée l'orage (Penthésilée, Cunégonde de Thurneck, l'Electeur de Brandebourg), tel un emblème de puissance maléfique, n'est que la dramatisation forcenée de l'existence quotidienne, dont chaque incident prend ainsi une tournure tragique, de même qu'en période d'hostilités la peine de mort se substitue pour les mêmes délits à de moins rigoureuses sanctions. Car ce n'est pas seulement le danger de vivre qui se voit ainsi mis en lumière, mais l'incertitude de la vie, de la mort, de la vérité, comme le prouvent les fausses nouvelles, l'alternative des succès et des revers, qui font de la guerre une sorte de brouillon indéchiffrable du destin des hommes. Au regard de l'incroyable tension qui, dans cette « Penthésilée » dont Kleist déclarait qu'elle contenait « toute la douleur et la splendeur de (son) âme », n'est due qu'à la nudité même de la passion, « La petite Catherine de Heilbronn ou l'épreuve du feu » surgit comme une fraîche oasis dans une atmosphère encore chargée de foudre mais combien plus détendue... Certes, comme l'affirme l'auteur : « Celui qui aime la petite Catherine ne peut trouver Penthésilée tout à fait incompréhensible, elles vont ensemble comme le + et le — de l'algèbre, elles sont une seule et même créature, conçues seulement dans deux ordres de relations opposés », et en effet toutes deux sont totalement gouvernées par leur mission amoureuse, mais l'une, émouvante incarnation de la femme-enfant, se déplace comme en rêve dans le domaine du merveilleux tandis que l'autre, en qui l'instinct amoureux et l'instinct de mort tentent sans cesse de se confondre, mourra victime de son conflit intime. Assez singulièrement, la grâce qui permettra à Catherine de triompher — ainsi qu'au Prince de Hombourg — c'est son état à peu près totalement inconscient mais clairvoyant, alors que Penthésilée est déchirée autant par sa conscience que par son délire. Qu'un seul homme d'ailleurs ait pu donner le jour à deux œuvres aussi éloignées et à peu près également stupéfiantes de beauté dans leur commune obsession « l'amour fou » serait, je pense, une preuve suffisante de génie. J'en viens enfin à l'œuvre suprême et sans doute la plus fertile en malentendus, « Le Prince Frédéric de Hombourg », conçue par Kleist comme un acte patriotique, accueillie d'abord comme une grave insulte à l'armée prussienne pour devenir de nos jours, mais abusivement, l'exaltation de la discipline allemande! L'intention de l'auteur, je ne me reconnais pas le droit de la condamner au moment où l'ignoble crapule d'Ajaccio soumet la Prusse — dont il se vantera d'avoir tiré un milliard! — à une abjecte oppression, cristallisant ainsi sur ce pays les espoirs du nationalisme allemand dont il a provoqué l'éveil. L'appel aux armes ne saurait être la glorification de l'armée dans l'esprit de celui qui écrivait en 1799 : « Les grandes merveilles de la discipline militaire, qui excitent l'admiration de tous les spécialistes, m'inspirèrent le plus profond mépris. »™ Mais venons-en à la pièce elle- même.
Un instant prisonnier de son rêve de gloire et victime du rêve qu'on lui joua : celui de l'amour et de la puissance, le Prince de Hombourg se retrouve brusquement dans sa nudité d'homme éveillé. Chimèras, la gloire, l'amour, la puissance? Non, car de sa plongée souterraine, il ramène un gage concret, palpable : « un gant blanc, un gant de femme ». Donc il n'y a pas de coupure entre le songe et le réel puisque l'immatériel se traduit par le matériel, les créatures irréelles par un objet visible — et le Prince a les meilleures raisons du monde de manifester un trouble dont Kleist montre les retentissements inattendus. Le conflit qui occupe toute la pièce n'est donc pas seulement psychologique (la spontanéité contre la réflexion), social (l'anarchie contre loi), philosophique (« l'esprit contre la raison »), mais opposition continue, systématique du monde « réel » et du monde onirique. Aux yeux de l'Electeur de Brandebourg, le rêve en soi est une faute, car il est la négation de sa loi : « Dans le néant, monsieur le Prince de Hombourg! Oui, dans le néant! » Ce cri menaçant par lequel le Prince se voit repoussé dans son rêve sonne comme une condamnation qui se confirmera: le rêveur, s'il s'oppose à la Loi, est voué à l'anéantissement. Or il est plus habile, plus meurtrier, d'amener le rêveur à se déjuger en lui faisant renier son rêve. Si le rêve est déjà manquement à la Loi, il suffira que l'accusé reconnaisse qu'il a obéi à son rêve pour que lui-même soit convaincu de sa culpabilité. Cette supercherie ne peut réussir que par le biais d'un de ces dangereux sophismes dont l'autorité use aux dépens des naïfs : « la sainte loi de la discipline », ou l'honneur du guerrier. Le Prince, comme Achille, comme Penthésilée, ont transgressé les lois de la guerre et de l'honneur en obéissant à leur rêve, au désir, à l'amour. Mais le plus grand danger qui menace ces êtres nocturnes, c'est d'écouter la voix de la raison: pour avoir voulu, après les reproches de la Grande Prêtresse, faire passer les lois de la guerre avant celles de l'amour, Penthésilée sombrera dans la folie, le crime et la mort. De même, Hombourg se condamne en s'inclinant devant la loi de l'Electeur, en qui il persiste à voir un juge généreux lors même que celui-ci ne lui a extorqué l'aveu de sa culpabilité qu'au prix d'un véritable chantage à l'honneur. Son terrible cri de terreur devant la mort — un an avant l'allégresse tranquille des lettres à Marie de Kleist - était plus lucide : de l'ennemi, on ne peut attendre que la mort. Mais la défaite du Prince est aussi la défaite de son adversaire, car si pour le rêve c'est renoncer à être que d'emprunter les règles du monde éveillé, pour la raison c'est se trahir tout aussi gravement que d'admettre l'existence du rêve au point de s'en faire complice. Sur ce point, l'accusation nettement formulée par Hohenzollern jettera le trouble dans l'esprit de Frédéric-Guillaume : ne se voit-il pas, lui, incarnation de la Loi, coupable d'avoir provoqué la désobéissance, la raison devenant cause et origine de la déraison? Il es! entré dans le rêve du Prince mais cette effraction se retourne contre lui, si bien qu'il ne lui reste plus qu'à reconnaître à ce rêve pleine et entière réalité, car sans lui tiendrait-il vraiment sa victoire? C'est ainsi que l'on atteindra ce dénouement paradoxal où le rêveur exilé de son rêve se verra réintégré dans ce rêve maintenant couronné et consacré par la raison elle- même. Ce triomphe final, en tous points identique à celui de « Catherine d'Heilbronn », est marqué par une dernière chute — chute définitive cette fois dans un monde où le rêve et la réalité enfin se confondent. Ces quelques réflexions, si lourdes et si longues mais si insuffisantes auprès des œuvres fulgurantes sur lesquelles elles ont prétendu s'exercer, 8 qu'elles soient le modeste mais fervent hommage que j'adresse au fantôme d'orage, pour moi toujours présent, de l'un des plus hauts princes de l'esprit.
José PIERRE.
- Marthe Robert, Heinrich von Kleist dramaturge, L'Arche 1955. Si cet ouvrage riche de nombreux et brillants aperçus me fut d'un grand secours, il ne m'a pas été possible de le suivre dans certaines interprétations à résonance chré- tienne de la « faute » et de la « chute » chez Kleist.
- Do.
- Ceux qui voient avant tout en Kleist le représentant de la caste des « junkers » prussiens ont-ils songé que c'est le même qui exalte ici la révolte armée d'un bourgeois contre la féodalité et le pouvoir impérial, indiscutablement plus proche Frondes? des jacqueries ou de 89 que des aristocratiques
- Voir Les Lettres de la Mort : Armel Guerne, Les Roman- tiques Allemands, P. 601. 5. Malgré cette différence d'appréciation, c'est à la traduction de Julien Gracq que je dois — et je me plais à le reconnaître ici — la brutale révélation de « Penthésilée » et du génie de Kleist (José Corti, 1954).
Le Père
....Il est sûr que cette maison, où l'ère du fumier de chèvre et celle de la lampe à incandescence se mêlaient avantageusement, que cette mauvaise maison restait tout de même une sorte de refuge, et que, par son isolement, elle proposait quelque « recueillement ».
Bien sûr qu'il fallait, de temps à autre, jeter les yeux au fond des caisses et des tas de vieilleries, où les déchets des événements s'empilaient et se conservaient au long des annees en couches géologiques, et qu'enfin le soleil cuisant des meilleurs mois de l'été élevait notre existence sur le toit, entre la cheminée et la lucarne du grenier, bien au delà du sentiment de l'habituel.
Mon frère et moi nous n'avions, à la manière des enfants, aucune difficulté particulière à nous rendre fertiles aussi celles des données qui étaient déplaisantes.
Pourtant je ne pense avec joie qu'aux jours qui ne se situaient pas dans l'ombre froide de « celui» qui rendait haineux le rayonnement de nos jeux peut-être hermétiques, de celui dont les pieds aux semelles grossières piétinaient impitoyablement l'es- pace entre les limites peu étroites dévolues aux pouvoirs du père et tout juste admis encore par les usages bourgeois.
Il va de soi que le prétexte de l'éducation, du principe d'obéissance et d'application surveillée, renforçait son attitude. Et il est évident que l'on s'interrogeait vaguement pour savoir à quel point y intervenait l'insuffisance de la classe entière qu'il représentait et qui l'empêchait de présumer que l'abolition du jeu ne soit pas propice à la bonté et au sens de l'équilibre.
Avec notre ouïe d'enfant, aigue, nous pesions chez lui, aussi exactement que possible, impulsion et coulisse, même là où il ne s'agissait pas de nous. On aurait préféré déceler, dans un libre arbitre quelconque, non motivé et qui ne se réclamât pas de l'échantillon - type bon marché, un signe infâme mais à la rigueur hautain : il eût moins désenchanté notre image de la possible grandeur humaine.
Nous apprîmes de bonne heure à nous protéger et, en vérité, plus encore que cela. Ce que nous pensions en claquant des dents, persistait à être jusque dans le sommeil : rébellion, défense, attaque. Lui, dans le plateau de la balance, il avait la lourde graisse du cœur mort, les pleines tripes d'une caste « arrivée »; nous : l'instinct inviolé, la stratégie infaillible de l'enfant intact. Toutes les armes nous étaient bonnes; nous apprenions à feindre le profitable jusqu'à ce qu'il devint scandaleux et le scandaleux jusqu'à la timidité pathétique. Nous savions être tout : caoutchouc, crasse ou verre, fil de fer et cuivre. A vrai dire, nous avions probablement un air plutôt adorable, plus fillette que redoutable comme nous eussions préféré être. Mais, semblait-il, il convenait plus que tout autre chose d'appâter la brute hors de sa position pour la confondre. Nous l'atteignions même avec la petite chanson enfantine lorsque, devant sa présence inopinée, de notre gré elle s'éteignait subitement. Dans la douleur nous avions le ricanement injurieux des tessons de verre; dans un serein pressentiment d'ironie acidulée, dans l'excitation simulée nous vomissions et souillions tout.
La civilisation de la grâce du principe paternel nous avait réveillés opportunément par son baiser. Il était temps. - Nous étudiions la ruse. — Il nous restait toujours une dernière chance. - Nous revenions sans relâche à la charge jusqu'à son premier coup de sang. — Nous étions inattaquables.
Hans BELLMER (1936. Traduit par Robert Valançay).
Le mot et l'image
Le délire verbal: de ce flux régulier ou tumultueux, concentrique à un mot-détente, à une image-mère, le souvenir conserve comme un écho ronfiant, roulements abyssaux d'une conque marine, déjà noyée depuis maintes marées.
Mais cette galopade de la pensée, je n'en ressens jamais l'imminence qu'à partir de certain délié de la plume, d'un mouvement esquissé de la main vers je ne sais quelle arabesque spatiale. La course des mots sur le papier m'est sans doute dictée par une forme euphorique de la graphomanie, un besoin de noircir les surfaces vierges, conditionnée par l'insensée spirale de l'écriture. Certains peuvent pratiquer le langage automatique sur une Rémington ou une Olivetti : pour moi, la lettre-type, comme le caractère d'imprimerie sont le rebrousse-poil de l'imagination. La frappe brutale de la touche, cet acte de violence qui revêt l'écriture d'un sinistre uniforme me paralyse d'avance, et me fait préférer tel illisible gribouillis tracé par une main amicale à une belle phrase en elzévir. Cette répugnance peut être mise sur le compte d'un respect sans doute excessif pour toute marque extérieure de l'individu, l'aspect caractériel de l'écriture étant garant de sa parfaite intégrité. Tout texte non signé m'est trop indifférent pour que je n'accorde pas une immédiate préférence au manuserit qu'à sa copie banale et mécanique.
Dans les exercices calligraphiques, les autographes et dédicaces, c'est bien le mirage du mot écrit, tracé ou griffoné, l'aspect plastique de cette signature involontaire, de ce moulage naturel de la pensée, exempt de pose ou de calcul, qui fascine le sens de l'allusion.
Je vois un peu l'intervention de l'imprimerie comme l'embrigadement du mot, la castration de ses aspirations au renouvellement perpétuel. En imprimant un livre, on cède à des commodités de lecture, au désir de normaliser; de niveler, de réduire la pensée jusque dans son climat photogenique inné. Se situe peut-être entre le trace et l'imprimé ce no man's land qui sépare le sauvage du domestique, le blanc géographique du relevé de latitudes, l'hirsute du mis en plis, le fol du raisonnable, le caprice créole de l'amidon togal. Car enfin, si la pointe Bic séduit les foules, c'est qu'elle pousse au paraphe. J'ai peine à croire que la routine de la lettre typée se soit insinuée sans lendemain dans le déclic des doigts encore épris de belles courbes. Du côté de Peiping ou d'Ispahan, où les ambassades occidentales bourdonnent sous le cliquetis des typewriters, les scribes locaux déploient encore leurs pinceaux et leurs styles, ouvrant au blanc, de droite à gauche ou de bas en haut, les volutes de leurs souples abécédaires.
Un journal imprimé en arabe ressemble à quelque pierre de Rosette, au mouvement sur un échiquier de plusieurs armées d'uniformes en plomb fondu. Je ne fais pas d'exotisme, dix numéros du même journal reproduisent la même sensation de chaos spontané, auprès de laquelle l'ordonnance bêtifiante d'un de nos quotidiens évoque l'écrémage de quelque fromage inouï.
Les calligraphes japonais contemporains, improvisant à la pointe du pinceau sur l'idéogramme « Rleur Eclose », ou tel précepte Zen en caractères Dan, ne tâtonnent pas sur un alphabet mort, mais tendent un fil très nostalgique vers le signe ancestral, tout comme les danseurs de l'Opéra Chinois, dans la danse dite des Rubans, font vivre dans l'espace en flammes de soie rouge, la version cursive du mot « pluie ».
Chez eux, du moins, le mot écrit conserve quelque chose d'essentiellement figuratif, et comme le souvenir d'un âge d'or de l'expression où la forme abstraite de la pensée se controntait sans cesse au kaléidoscope des formes figées en calembours. D'une l'intuition s'associaient encore ère où le tracé de l'intelligence et de au vertige plastique, où régnaient de concert, et le mot et l'image.
Est-il donc si normal qu'un mot, par son contour, sa couleur ou sa corpulence, soit à ce point différent de l'image qu'il évoque ? Le mot « Beauté », à moins d'être composé dans le précieux lacis de la Taille-douce, orné des fioritures alambiquées d'un bee de plume capricieux, ne révèle plus rien de son amande. Imprimé dans le banal Didot bas-de- casse, il revêt le même froc de bure que « quoique » ou « baliverne ».
La représentation mentale qui découle de cet exercice nous est devenue un rictus de la lèvre, un battement de cils. A une cadence vertigineuse, nous appréhendons des centaines de semblables symboles, qu'un mécanisme tout proche de la cybernétique traduit pour nous en noms, verbes et adjectifs. D'où vient alors qu'on puisse se sentir crétinisé par la simple contemplation sur une page imprimée d'un mot quelconque, dès qu'on tente de lancer une échelle de soie entre son âme et son visage ?
Regardez « limbe » ou « écrevisse », palpez du doigt « repère » ou « corridor », flairez « planche » ou « cimeterre », et je vous y parie la détente de mon mollet, vous concrétiserez le hiatus, vite intolérable, qui vous en sépare à jamais. Imaginez-vous, par contraste, la quiétude du petit scribe de Nan-tehang, lorsque pour tracer au pinceau le verbe « se reposer », il dessine l'image très simplifiée d'un homme appuyé à un arbre ?
Dans l'équivoque fondamentale de notre langage, tout objet peut représenter un mot qui lui est étranger: pourquoi « théière » ne s'appliquerait-il pas à une brouette, « nombril » au gros orteil, « tortue » à un cheval ? Nimporte quel objet anamorphique suffit à donner une image satisfaisante d'une qualité abstraite: « tolérance » ou « orgueil ».
Comme l'observait Magritte : « Les mots qui servent à désigner deux objets différents ne montrent pas ce qui peut séparer ces objets l'un de l'autre. » Chat et char ne diffèrent que d'une lettre, en fait, leur dissemblance dépasse les limites infinitésimales d'un signe. Au lieu que le mot «scribe » en égyptien est formé par l'accouplement du verbe écrire, peindre (une palette et un pinceau) avee l'idéogramme Homme assis.
Et je pense à l'instant au chaos permanent de nos écoles où deux méthodes s'affrontent pour un enseignement de la lecture que les pédagogues eux-mêmes reconnaissent pour bancal, dérisoire et vicié. Tumulte vagissant des maternelles où le rite imbécile du B.A., BA déforme les lèvres roses des fillettes à l'âge où la forme parfaite du globe solaire fascine leur perception ludique. Anonnement stupide des syllabaires où le « jujube de dojo » se heurte au « caractère martial de la nation spartiate », et où les pages de bâtons acheminent les cerveaux crédules des joueurs de billes de l'alphabet au mot ou des phrases à la lettre, selon que l'instituteur se satisfait de la méthode alphabétique ou de la globale. D'une part, on implante mécaniquement dans les esprits avides d'Am-stram-gram ou de Papanicaille le système vétuste du code, la voix de la voyelle et le son des consonnes, en jouant sur cette tentation cryptographique qui se défoule chez les boys-scouts dans le morse, les mots-croisés et le langage secret :
A Eton, De Quincey, beau canere, parlait ZYPH.
D'autre part, on assène à l'enfant une vision collective des phrases en le laissant trouver des cailloux blancs qui le mèneront de la soucoupe au sou, puis à la coupe. Découverte ineffable qui lui révélera l'on du ballon ou le tor de torpille, et qui le portera très fatalement à deviner les mots, à les apprendre « par cœur » bien plus qu'à les connaître. Il épèlera bol, mais articulera pot, verra banane en place de cabane, et comme disent les mères, confondra les petits mots, les de, les sur, les dans, ribambelle indisciplinée d'intermédiaires débiles aux bras ballants.
Tenu de déchiffrer comme un officier des services secrets ou de mnémoniser comme le fakir réciteur d'annuaires, chaque moutard éberlué devra ou non s'initier avant tous les mystères au plus abstrait, au plus automatique des mystères. Quand les secrets les plus fluides de la vie élémentale percent avee ses dents l'écorce de plaisir qui chape son ego, quand la teneur de l'air en joie, le mirage païen des allumettes suédoises, la poussée palpipante des verdures et la chaleur vibrante du fou-rire l'absorbent en entier, il lui faut faire passer son intelligence dépaysée au stade du symbole.
Mais qui, de l'œuf ou du poulet vint au monde le premier ? La perception du tout, sait-on vraiment si elle précède chez l'enfant la perception de la partie ? A quinze mois. il reconnaît un cercle d'un triangle : les uns décrètent qu'il est tout près d'identifier la lettre O, les autres qu'il est à même de succomber au charme d'une orange ou de la pleine lune. Il faut attendre trois ans avant qu'il soit à mème d'identifier quatre formes géométriques diférentes: est-il mûr pour l'abécédaire où le Zèbre Zélé fuit l'Ane Arabe de toute la vigueur de ses Sales Sabots ? pour les panneaux-rébus des salles de classe où une silhouette illustrant le mot « homme » se lit selon les cas monsieur, papa, bonhomme?
Convenons de l'impasse : en Amérique, où la méthode analytique crée des générations entières d'attardés, songe déjà, par contemplation béate du banal, à abandonner l'écriture manuelle au profit de la lettre-type : « IS HAND- WRITING OBSOLETE ? » demande le professeur Mattew Epstein, grâce auquel les petits New-Yorkais écriront sur les Valentines I love you en capitales bâton. Pendant que notre science du langage pousse certains éducateurs français à envisager une réforme de l'orthographe, disons de l'ortografe, histoire de résumer vingt siècles d'artifices en un artifice de plus.
Il n'est pas très utile de déplorer la chute d'un gigantesque toast beurré. La longue cuisson du toast dans un four de douze mètres de haut, l'étalage des kilos de beurre, l'intervention des grues pour transporter ce délice de Brobdingnag, le final cataclysme qui cruellement déçut tant d'appétits, cela intéresse peu quiconque se permet, dans la solitude, de rêver à plat plus subtil.
Il m'arrive de regretter, lorsque mon regard erre d'un livre ouvert au mur couvert de toiles, que les civilisations indo-européennes n'aient pas opté pour un système d'ex- pression ou le tout et la partie s'appréhendaient de concert en s'appuyant, pour chatcuiller l'esprit, sur les formes de la nature : les arbres, l'océan, le sable fin, sur ce qui brille, sur ce qui obscurcit. Je me demande alors si une notion hiéroglyphique, idéogrammatique de l'écriture n'est pas plus intimement liée à la fibre de l'homme que la notion de code. Le disque de Thélonious Monk que dévide l'électrophone ne semble pas me contredire.
Dans un entrechat du pinceau chinois où la beauté du trait reflète certaine qualité de l'âme, l'impression moment, et toute une tradition de la pensée, j'admire à l'occasion que trois caractères en forme de pies, de monts et de traces de pas, puissent signifier, sans opération trigonométrique de l'esprit: quel plaisir de se promener dans la montagne !
Et en considérant le passage de l'idéographique au pho- nétique, l'imprimerie dont je ressentais instinetivement la dictature, devient pour moi comme l'acte officiel du divorce entre le mot et l'image, souligne la complète désaffection de toute forme naturelle ouverte de l'expression, et justifie ce que je conçois être toute une série de manifestations occultes de l'image pour retrouver son rôle original.
Partant, j'imagine volontiers, que l'histoire de l'écriture, depuis le drôle Gutenberg, jusqu'au « ballon » des illustres, en passant par les sténographies, les fantaisies typographiques, les calligrammes, les rébus, les alphabets interprêtés, voire l'art du filigrane et les tableaux signalétiques, résumé un vaste effort de retour subconscient à la plastique du mot, le cheminement souterrain d'une alliance, Petrouvailles aussi laborieuses que les amours de deux heros réincarnés, à la manière de Haggard.
Mais c'est aux noces que je pense.
Robert BENAYOUN
La force créatrice des moyens plastiques
« La religion, s'écrie Hegel, que serait-elle sans l'art ! » Mais le sage d'Iéna pense à l'image qui suggère la sainteté avec une éloquence plus convaincante que tout raisonnement. Songeait il à la valeur initiatique des moyens plastiques qui portent l'image et sont eux-mêmes le lieu de la manitestation du Sacré? En effet la force créatrice ne réside pas dans le sujet, car celui-ci est déjà un produit de la conscience, tandis que le pouvoir créateur s'impose péremptoirement par les moyens plastiques mis en œuvre dont on peut dire qu'ils sont dictés par la subconscience - donc émergent d'un réservoir collectif sans âge - spontanément. Le dynamisme primordial des Celtes eut, pour première intuition de l'origine de l'homme, le mouvement qu'il concrétisa, contrairement à la Terre-mère des autres, dans Epon a Déesse- mère chevaline. Le rythme, dont l'emprise totale sur cet art est indéniable, découle bien de cette illumination dynamique fondamentale. Au début de l'évolution de l'art gaulois dans les médailles, le modèle charnel des Grecs fut accepté avec les prototypes. Il n'était encore question que de l'espèce circulante. Les Celtes décidés à frapper monnaie l'imitèrent. Le modelé des premiers types est un excellent travail artisanal, mais pas encore de l'art. Une étincelle heureuse, agissant par induction, déclencha alors une création artistique qui s'est propagée à une vitesse foudroyante. Mettant en cause tout l'enseignement classique, elle s'éloigna de lui dans la direction diamétralement opposée vers le rythme pur. Or, chose curieuse, le sujet, du moins apparemment, restait le même : l'Apollon lauré sur l'avers et le quadrige sur le revers. Toute l'évolution de l'art celtique est donc portée par les moyens plastiques que fut le rythme sans que le sujet même y ait joue un rôle important. Toute originalité et toute sacralité sont comprises dans ce rythme créateur. La forme modelée et le rythme dynamique, lorsqu'ils deviennent les moyens plastiques déterminants d'un art marquent deux concepts opposés ou, plus précisément, ils sont les seuls à exprimer un concept du monde en toute netteté : le modelé s'attache à la matière, le rythme dynamique la dissout.
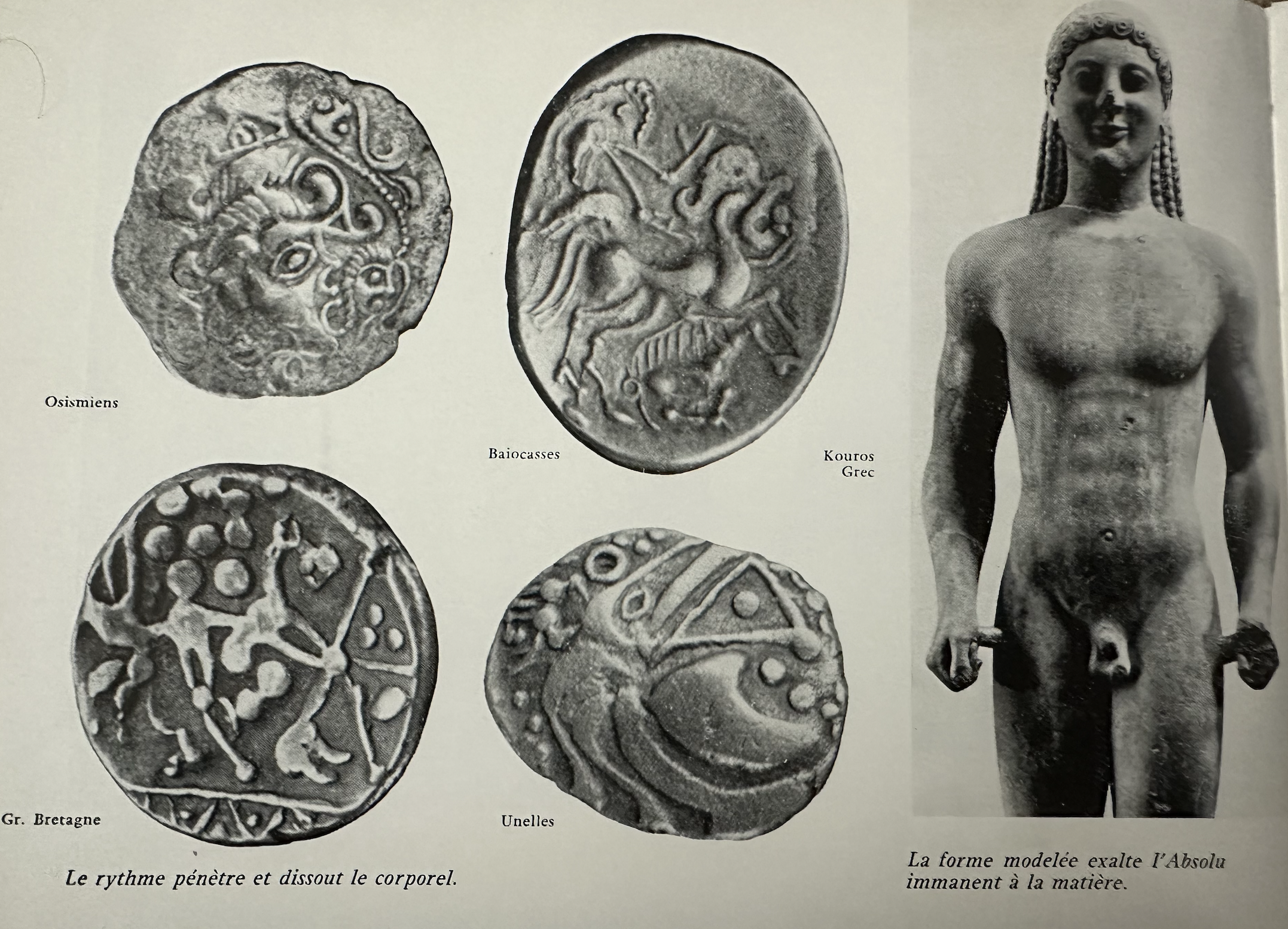
Le caractère sacré des deux procédés réside dans la recherche de l'Absolu. Mais les deux le conçoivent par l'antithèse. Le modelé suppose que l'Absolu est immanent à la matière et s'efforce de rendre celle-ci parfaite; c'est la conception grecque. Le rythme le révèle dans l'Elan divin pour lequel la matière n'est que maya, phénomène temporel, et tâche de rendre cet élan par sa pénétration du corps qu'il disloque; c'est la conception celtique; ou par la dématérialisation en substituant à la chair la lumière dissolvante et le sentiment sublimé, et c'est l'occidentale opposée à la Renaissance italienne. Des deux visions, l'une s'émeut du corporel matériel, l'autre de l'incorporel immatériel. Tout rythme n'est pas forcément dynamique, de même que toute forme n'est pas ipso facto modelée. Le rythme dans les arts mésopotamien, égyptien et grec soutient puissamment les volumes en les organisant. Dans l'art celtique, par contre, la forme est le produit de la solidification des rythmes linéaires après avoir éliminé la cohérence charnelle. Le pouvoir créateur des moyens plastiques ainsi posé, les deux concepts de l'Absolu se révèlent par les trois oppositions suivantes : dynamique-statique, concret-abstrait et immanent- transcendant, antinomies auxquelles les arts répondent sans équivoque. Cependant ces couples ne présentent pas dans les Arts les mêmes évidences qu'en Mécanique ou en Philosophie. Le mouvement en soi ou le repos représentés n'affirment point le caractère statique ou dynamique d'une œuvre. Le quadrige au galop peut aussi bien n'être pas plus dynamique qu'un personnage couché n'être statique. Ce qui en décide c'est l'équilibre assuré ou précaire de leur état. Dans un art statique, le geste figé semble arracher au changement perpétuel un moment d'Eternité. La structure du Discobole de Myron ou celle des scènes agitées des tympani grecs, excellent par la répartition des volumes équilibrés que la pesanteur distribue, ce qui prête stabilité semble alors pouvoir même à un saut suspendu entre deux états successifs. Le sujet représenté semble alors pouvoir maintenir indéfiniment son attitude, de par sa propre volonté. Dans un art dynamique, l'équilibre est précaire, avons-nous dit, et le geste ne dépend pas de la décision des sujets. Ceux-ci subissent un élan agissant de l'extérieur, qui s'empare d'eux et auquel ils obéissent. Dans cet art, une figure au repos maintient un état octroyé, provisoire, avec une suite possible incertaine. L'assemblée des Apôtres sur les portails gothiques est dictée par le rythme de l'architecture, celle de la fresque de la Sainte-Prudence de Rome classique est calquée sur le Sénat romain présidé par l'autorité du Christ. Chaque personnage pris séparément est une sculpture par l'autorité du Christ. peinte. Un des Saints du portail de Chartres, enlevé de son piédestal, perd optiquement son équilibre, de même que, sur une médaille armoricaine, un cheval isolé du rythme environnant, est frustré de son élan. La même discrimination est à faire entre un coloris statique et un coloris dynamique. Le premier consiste en taches saturées à solidité égale, appliquées en localisations équilibrées, comme les statues, les vases et les monuments grecs et égyptiens les préfèrent. Le second fait vibrer la surface par teintes fondues ou par tons d'intensités diverses qui se mélangent dans l'œil du spectateur et excitent son émotivité. La vision du monde dans un art statique célèbre la solidité, la stabilité, le durable, le mesurable. Elle satisfait les exigences sensorielles, sensuelles et tactiles. En accordant la matière et les sens, une telle œuvre est concrète. La révélation dynamique du monde exalte le devenir constant et changeant; elle imprime aux choses un souffle qui éveille sensations et impressions, entrainant le spectateur hors du sujet, vers un sentiment auquel l'œuvre ne servait que de départ. Détaché du support matériel, l'intention vise l'abstrait.
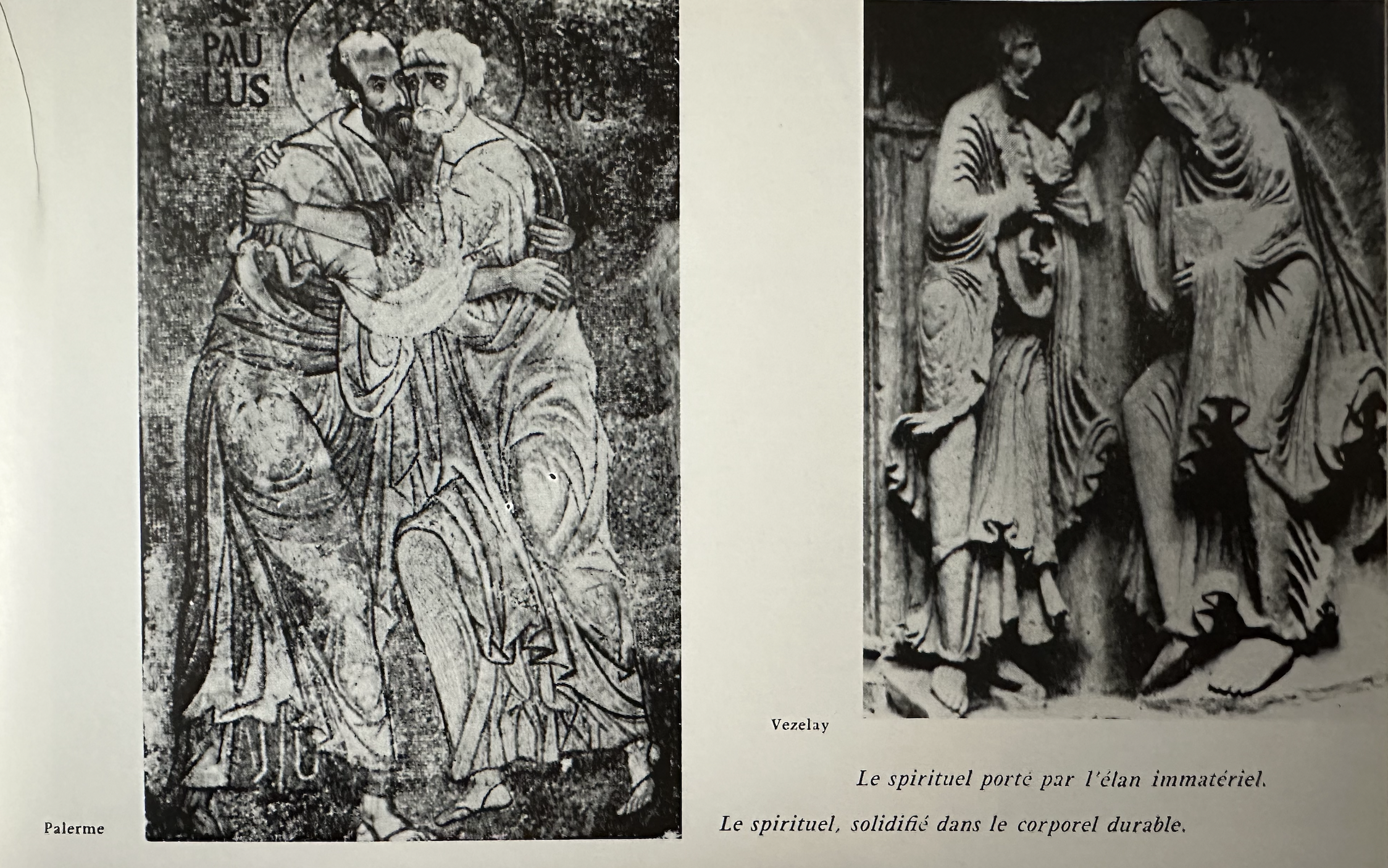
Le rythme celtique essentiellement linéaire dévore le corps; il désarticule la tête, homme et cheval, en particules indépendantes, disséminant leurs éléments jusqu'à ce que le mouvement s'en empare pour les ordonner et réintégrer dans une catégorie autre que celle de l'optique humaine. Ces transfigurations ne sont pas chaotiques, mais constituent une tentative pour deviner la logique de la Création qui imagine les forces muées par l'Etre suprême. Cette recherche est vouée sans aucun doute à la transcendance. Le mouvement imprimé à l'image entraîne avec lui l'espace et celui-ci devient mouvant. Ce phénomène oblige à distinguer entre l'espace concret, discernable sinon mesurable autour de l'objet qu'il entoure, et l'espace abstrait, indéfini et par là infini, chargé d'énergies. L'espace intérieur impondérable d'un édifice, en donnant expression à l'immatériel, est un puissant moyen suggestif de la transcendance. L'espace qui baigne une statue grecque est défini par les trois dimensions : il est concret et statique. Il en est de même dans les bas-reliefs égyptiens où, délimité par les contours précis des figures, il se maintient dans l'équilibre assuré. Dans les images des médailles l'espace est dynamique: il n'entoure pas l'objet, il le pénètre et le dissout. Les contours de l'objet éclatent en fractions dispersées qui se réforment davantage par énergie attractive que par parenté organique. L'espace dynamique se substitue aux objets, se représente donc lui-même. Ainsi est-il permis de dire que l'espace dynamique est abstrait. Ne se heurtant à aucune limite ferme, il se définira comme infini. Comme il ne s'arrête pas, même accidentellement, on le qualifiera d'inachevé. Dans l'art grec, l'amour de la belle matière conduit à l'exaltation du visible concret qui s'identifie à la perfection du monde terrestre devenant le parangon du monde céleste; et cet Olympe est terrestre, concret et statique. Dans l'art celtique, la négation de la matière, en se tournant vers l'invisible immatériel, y reconnaît le Transcendantal. L'appréciation terrestre (immanent) ou transcendantale d'une œuvre n'est pas exempte du goût personnel car rien ne peut empêcher quelqu'un de voir dans l'Aphrodite de Médicis une beaute transcendantale et, dans la Vierge de Memling, une jeune femme bien terrestre, très bourgeoise. Ceci dit, le charnel indique catégoriquement la condition finie de l'existant sous toutes ses modalites. La sublimation du corps, sa beauté et sa perfection sont terrestres. Si cependant, dans la peinture occidentale, le corporel est entraîné par un rythme (composition) ou par la lumière immatérielle plus forte encore par l'effusion d'âme prépondérante, ce rythme, cette lumière et ce sentiment peuvent annihiler le corporel jusqu'à le désavouer. Par le désir d'exprimer l'immatériel, la peinture occidentale peut avoir recours à la matière pour la transfigurer, la réduire à un reflet fugitif ('Impressionnisme) ou y mouler ce qui échappé au sens : l'Impénétrable (le Surréalisme). Il y a cependant une preuve indirecte de l'intention terrestre ou transcendantale d'un art : le nu. Le nu « victorieux » ou naturel, la beauté « en deçà ». La pudeur qui ressent une gêne devant ce témoignage de la perfection humaine peut, certes, résulter négativement d'une insensibilité sensorielle; positivement, elle trahit le transcendantal hostile à la chair. Le Christianisme n'y est pour rien. Le Boticelli de la Primevère et d'autres Italiens de la Renaissance étaient chrétiens; un univers les sépare cependant de l'art occidental où le nu devient, a peu s'en faut, irréel ou au contraire trop humain. Mais jamais il n'est symbole de la pertection spirituelle qu'il atteint parfois dans l'Italie de la meilleure époque. Les termes réalité, spiritualité et absolu ne sont pas en cause dans cette discrimination. Les deux arts se réclament de la réalité, mais tandis que l'un la décèle dans le visible, l'autre la cherche derrière l'apparence. Les deux arts ont pour fin la spiritualité, mais l'un en imprègne la matière, l'autre la prête au mystère. Tous les deux s'efforcent de rendre l'Absolu; les Grecs lui ont érigé le Temple dorien, le monument occidental est fixé dans la pénombre palpitante des voûtes gothiques s'évanouissant en hauteur immesurable — et dans la porte essentiellement ouverte à travers laquelle épient la Science moderne comme le Surréalisme, conjurant chacun avec ses moyens propres, si différents soient-ils, l'extraordinaire Mystère de l'existence mi-manifestée.
Lancelot LENGYEL.
La métamorphose du silence
Quelle curieuse et suspecte unanimité, dans l'invocation et l'approbation de ce slogan : le « musée imaginaire »! De tous côtés l'on entend retentir la louange, cralter la découverte, formuler inlassablement l'Idée. Si un régime autoritaire s'installait en France, il n'aurait aucune peine à imposer le malranisme comme esthétique nationale. Seuls murmureraient, seuls ne murmurent déjà plus que dans l'ombre, de méprisables envieux, une poignée de gens sordides penchés sur de mesquins détails. Car il est universellement entendu que ces objecteurs notent de ridicules erreurs de fait parce que, natures sèches, ils refusent de se laisser pénétrer par le souffle gigantesque et la « génialité » de ces révélations admirables. Mais, même si nous fuyons les contacts déplaisants, si nous rentrons au bercail du «mondial », dans la chaude intimité sans bornes du musée imaginaire, quel sens pouvons-nous découvrir au fond de cette expression ?
Ainsi donc, la civilisation de la carte postale, de la reproduction en couleurs criardes et défigurantes, mettrait immédiatement et sans délai tout le royaume de l'art à notre portée... Grande nouveauté de notre siècle, que la reproduction photographique sans doute. Mais Malraux a-t-il entendu parler de l'existence du livre et des bibliothèques? Sait-il que, depuis des milliers d'années, et sans avoir attendu même l'invention de l'imprimerie, le livre permet, chose étrange, de transporter un texte dans une civilisation différente de celle de son auteur, et cela avec ume fidélité à l'original incroyablement supérieure à celle de la prétendue « reproduction », souvent bien mal nommée ? De la présence à la Bibliothèque Nationale de la quasi-totalité des œuvres écrites par l'homme, conclut-il que toutes ces œuvres sont, depuis qu'il existe des bibliothèques, instantanément et toutes ensemble, comprises par chacun de nous ? Car c'est sur ce postulat que repose l'idée du musée imaginaire.
Il est vrai que, pour Malraux, de simples Morceaux choisis suffisent. Un autre de ses postulats veut, en effet, que voir la photographie d'un détail, agrandie vingt fois, équivale à la connaissance d'une œuvre entière, — à moins qu'il ne s'agisse de la photo d'une fresque immense réduite au format d'un timbre-poste. La méthode des choix et des rapprochements se justifie seulement iorsqu'elle parvient à constituer de véritables anthologies, au sens éminent du terme, c'est-à-dire lorsqu'elle assemble des œuvres qui ont entre elles une parenté authentique, et illumine par là une nouvelle réalité, inaperçue auparavant. Création critique, à laquelle ne saurait se comparer le rapprochement verbal, ou même matériel, d'œuvres tronquées sans liens entre elles, et qui finissent par perdre tout lien fût-ce avec elles-mêmes.
On voit quelle tentante « bibliothèque imaginaire » pourrait nous offrir Malraux, — pour les prochaines fêtes de Noël? ou même, un peu de courage allons! pour la Fête des Mères? - avec douze lignes de Confucius, un demi-vers de Racine, un adjectif de Proust (agrandi), dix-sept mots d'une épopée scandinave, Mignonne allons voir à la chandelle si Rodrigue a to be or not to be, etc. On voit, dis-je, serpenter, se gonfler et se dégonfler les périodes d'attaque de cette imminente (espérons-le) Méta- morphose du Silence : « Dans la Bakhavad-Gita comme dans Le Rouge et le Noir, dans Prévost-Paradol comme dans l'Hermès Trismégiste, chez Homère, Claudel, la Comtesse de Pange et dans telle complainte des indiens du Mato-Grosso, c'est le visage de son propre dépassement que l'homme cherche à cacher sous le masque d'un effondrement conquérant face à toutes les étoiles du ciel, etc., etc., etc. »
Par ce livre il sera démontré que ni l'œuvre littéraire ni l'œuvre d'art ne sont choses difficiles à comprendre. Il est réconfortant de constater qu'à peine il a fait de l'art, par ses raisonnements impératifs, l'héritier et le successeur du sacré, Malraux décrète ce sacré aussitôt vendable, les droits de succession se trouvant couverts par la mise sur le marché d'une série de digests compacts, qui placent l'art de tous les temps, de tous les lieux, sous toutes leurs formes, dans tous leurs détails et pour toujours, à la portée de tout le monde. D'autres croient encore que dans le cours d'une vie nous ne pouvons comprendre que très peu d'œuvres d'art, — par la photo ou autrement (et autrement vaut mieux). Nous ne pouvons être atteints par une œuvre d'art que dans des conditions étroitement déterminées, difficilement réalisées, différentes pour chaque œuvre. Car être atteint par une œuvre requiert un intense et exclusif acte d'imagination. L'art se met à exister pour nous dans les rares moments où nous nous rendons capables d'interroger et de préférer une seule œuvre. Le client du musée imaginaire promène au contraire un œil pâteur sur des millions de clichés incomplets. Le musée de Malraur n'est nud- lement « inimaginable » (pour évoquer le titre de Georges Duthuit), ou, du moins, ce n'est point par excès, par abondance des matières, mais au contraire par défaut, par pauvreté essentielle, par manque d'imagination. Qui parle de tout n'aime rien. Voilà sans doute le seul souvenir que laissera l'ample entreprise de Malraux, - lorsque le temps l'aura réduite à ce qu'elle est, à quelques lieux communs écrasés sous les décombres d'une rhétorique démodée, — le souvenir, dis-je, que le musée imaginaire ne fut, en somme, que le musée des gens sans imagination.
Jean-François REVEL (Mars 1958)
L'armoire d'Adolf Wölfli
De tous les schizophrènes qui attirèrent l'attention par leur peinture, Adolf Wölfli est le plus connu. Avant sa maladie ce Bernois, domestique de ferme, n'était aucunement créateur. Ce n'est qu'après qu'eut éclaté sa psychose qu'il commença à peindre, ainsi qu'à écrire des vers et à composer de la musique qu'il jouait de sa trompette. Ce qui intéresse le psychiatre est que cette production exubérante compensa, comme une sorte d' « équivalent », de graves états d'excitation catatonique, ses peintures constituant un livre d'images psychologique dans lequel se reflète le monde bizarre et fantastique du malade. Sans être de l'« art » (*) , les dessins de Wölfi ont aussi provoqué l'intérêt des artistes : non seulement des peintres ont reçu de Wölfli certaines impulsions mais encore un poète comme Rilke s'est montré impressionné par ses images. Deux armoires décorées par Wölfi étaient restées soustraites jusqu'ici à toute publicité. De la corniche jusqu'au socle, elles sont couvertes de figures et d'ornements. Sur le devant, la composition s'adapte aux panneaux des portes de l'armoire. Les surfaces latérales, par contre, sont divisées librement et de plusieurs manières; elles composent pourtant trois champs, séparés par des parties intermédiaires. Tandis que les ornements encadrants et ces dernières parties sont peints directement sur le bois du meuble, une autre partie des images a été collée sur l'armoire. Les encadrements ne sont symétriques que sur la surface de devant; ils se composent de rubans ornementaux, de « grelots » et de masques typiques prenant chez Wölfi un caractère stéréotypé. Parfois s'y ajoutent des inscriptions manuscrites telles que « Sainte Unité Santta Maria » ou « St Adolf Rossali de la Forêt de St Adolf ». Les images ne se rapportent les unes aux autres ni par la forme ni par le contenu. Le centre des dessins est constitué en général par un enchevêtrement très dense de figures et d'ornements; il arrive aussi que ce soit un portrait découpé dans un illustré (non visible sur la photographie) sans relation appréciable avec son entourage.
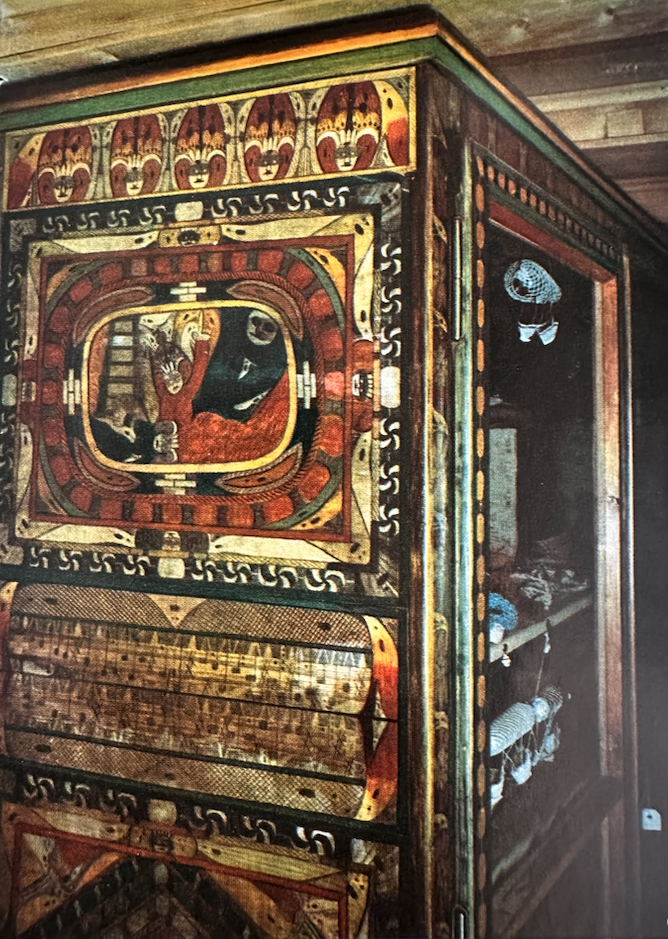
Considérons un des tableaux, celui de la partie supérieure du côté latéral gauche de la deuxième armoire : nous sommes frappés tout d'abord par l'ornement au masque. La comparaison avec des tableaux antérieurs nous montre que le masque aux yeux s'est constitué peu à peu à partir des sourcils, pendant que les cheveux se stylisaient en une sorte de couronne. Les figurations de Wölfli sont, en général, indépendantes de tout modèle; toutefois les têtes masquées rappellent la figure « aux hiboux » de la porcelaine de Heimberg (canton de Berne), connue de Wölfli et dont l'auteur était d'ailleurs, lui aussi, un schizophrène. Vers le bas, le tableau est délimité par un ornement de notes musicales qui présente une composition de Wölfli. (On n'a pas encore tenté de soumettre de telles compositions à une lecture cohérente et de les jouer.) Le tableau ovale s'encadre d'un ruban ornemental d'une symétrie rigoureuse. Sous une échelle un personnage est couché, qui représente Wölfi lui-même. L'inscription porte : « Décès de St Adolf II, 1889 ». Le personnage féminin, figure-mère, du centre est la « Grande-grande-Altesse - princesse royale Rosette - vachère d'Australie ». Outre son orthographe capricieuse, le langage de Wölfi se caracté- rise par un rythme tout particulier. Dans son délire, Wölfi anoblit tous ses parents et fait de la Suissesse (Senn') la détentrice de continents lointains (Australie). Le « décès » nous présente un des thèmes fréquents de l'imagerie de Wölfi; il est en relation biographique avec ses propres délits dans le passé (exhibitionnisme, pédophilie). Pour se punir, Wolfi se fait tuer, scier ou torturer sur ses images. Le doigt levé et menaçant de la figure maternelle symbolise la colère provoquée par ces crimes. En haut et à droite du tableau apparaît, sur fond bleu foncé, un pâle visage sans masque représentant, selon toutes probabilités, le Diable, le Tentateur. Il s'accompagne ici de la rime : « Gefärlich ist und tags darauf ist alles Mist > (C'est dangereux et le lendemain tout est fumier), ce qui est à mettre également en rapport avec ses délits. En considération doivent être pris aussi les « oiselets » (Vögeli) - longs bourrelets munis d'un œil et d'une bouche, avec un bâton sur le côté. Dans les coins des ornements encadrants, on voit ces oiseaux de face. Ces figures, qui surgirent de la forme du soulier (Wölfi était vraisemblablement un fétichiste des chaussures) ont une signification sexuelle. Au lieu de Vögeli (oiselets, oisillons). Wölfli dit aussi « vögeln » (oiseler) qui signihe coïter en langage populaire: plus tard il les désigne également du nom de « limaces ». Ils s'introduisent partout où il y a menace d'espace vide. Sur le corps humain, ils sont le pénis, souvent aussi la main au pénis - allusion aux actes exhibitionnistes. Il est possible que les oiselets situés à droite de la main de Wölfi requièrent cette interprétation : en tant que souliers à talons hauts ils apparaissent à proximité du Diable, qui incite au délit.
Les particularités caractéristiques de la fguration chez Wölfi peuvent être ainsi relevées : remplissage complet de l'espace, tendance à l'ornementation et à la stylisation, contaminations, persévérations, réduction à certains éléments polyvalents (oiselets, masques, etc.). On ne peut que renvoyer le lecteur en quête de démonstration plus détaillée aux études spéciales sur ce cas (Morgenthaler, v. Ries, Spoerri).
Si, passant des détails décrits au tableau considéré comme un tout et, de là, à l'ensemble de l'armoire, nous observons qu'en dépit de l'enchaînement arbitraire et inharmonieux des éléments partiels, la figure totale donne l'impression étrange d'être issue d'un seul jet. Ceci ne provient pas, nous semble-t-il, d'un effet esthétique car les œuvres de Wölfi ne sauraient ressortir à l' « art »; aussi n'est-ce guère un principe formel de valeur esthétique qui peut expliquer l'unité d'ensemble de ses créations. Les tableaux de Wölfi constituent un dédale de couleurs et de formes qui se relient tantôt organiquement tantôt sans liaison, un mélange inextricable de profond, de sublime et de ridicule, d'obscur et de banal. Autrement dit : mesurées selon nos normes, ses peintures nous apparaissent disharmoniques, disproportionnées. Mais, pour peu que nous les considérions en fonction de sa personnalité, de son passé, de sa maladie, elles se montrent à nous, toutes fermées qu'elles soient sur elles-mêmes, intérieurement équilibrées : ce qui, vu de l'extérieur. n'apparaissait que comme figuré et relié arbitrairement est régi par centre intérieur. Les créations plastiques de Wölfi, aussi bien que ses créations sur le plan du langage, sont prises dans un équilibre oblique. D'où l'impression d'unité que nous fait l'œuvre de Wölfli, malgré toute sa disproportion.
On sait que le surréalisme a pris à son compte certaines caractéristiques du style des schizophrènes. Quand ceci était fait avec le secours de l'art, la discussion ne pouvait que dévier, en devenant esthétique. Quand, par contre, c'étaient seulement ces caractéristiques qui étaient appliquées sans que pour cela surgît une œuvre d'art, le résultat était fatal. Une comparaison de telles productions avec celles de Wölfi rend encore plus intense la fascination qu'exercent ces dernières. Pourquoi? A quoi tient cette différence, puisque Wölfi, lui non plus, ne réalisa pas une œuvre de valeur artistique? La cause nous semble en être la suivante : Wölfi ne s'est pas pourvu de ce style en visant à des effets inhabituels et frappants, mais ce style est l'expression de son univers. Quand Wölfli contamine et stylise, lie le profond au banal et parle en symboles sexuels, il y a derrière tout cela un centre, une personne qui ne peut s'exprimer et se donner figure que de la sorte. L'œuvre de Wölfi est authentique, harmonieuse en elle-même et nécessaire; c'est pourquoi elle produit l'impression d'unité et tient en éveil la participation.
Theodor SPOERRI (Traduit de l'allemand par Kostas Axelos et Meret Oppenheim).
(*) Sans entrer pour cela dans les vues de M. Jean Dubuffet qui, naguère, soutint assez plaisamment qu'« il n'y a pas plus d'art des fous que d'art des dyspeptiques ou des malades du genou » (L'Art brut préféré aux arts culturels, 1949), nous voyons mal au nom de quelle conception ultra- rétrograde de l'art Adolf Wölfi ne pourrait être tenu pour un artiste et même pour l'un des trois ou quatre plus grands maîtres contemporains. Tout en remerciant M. Theodor Spoerri de sa précieuse analyse et sans oser lui demander ce qu'il pense du Nerval d'Aurélia ou du Van Gogh d'Arles, nous ne pouvons éviter de faire toutes réserves sur ce point. (La Rédaction.)
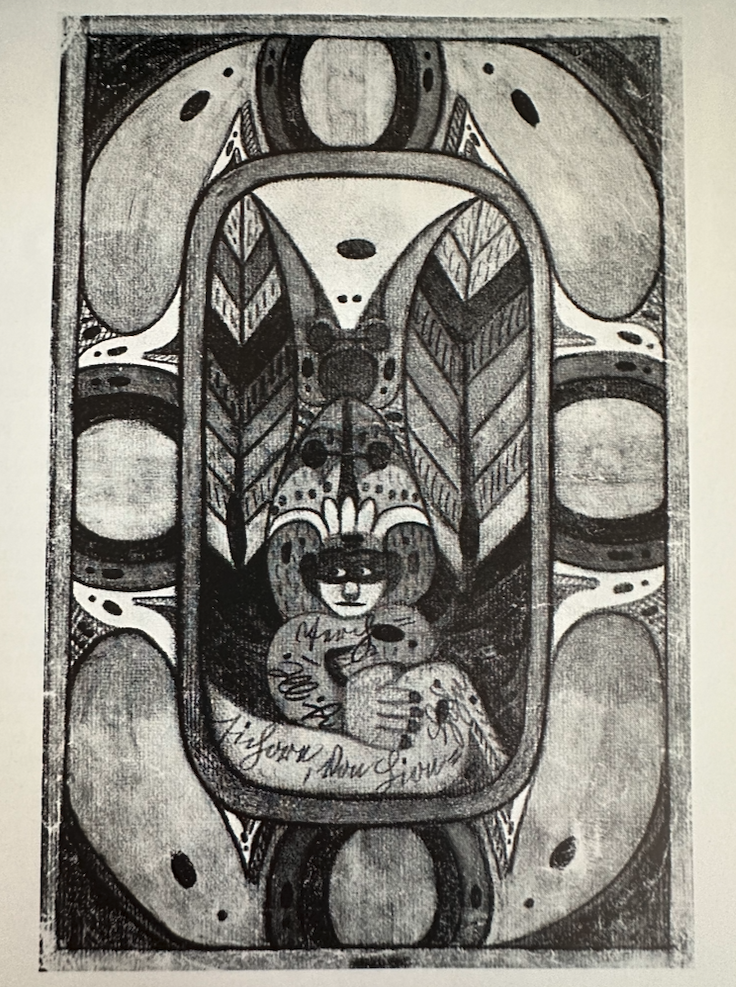
Une enquête sur le strip-tease
♀ I. D'un spectacle de strip-tease, aussi bien que des réactions observées autour de vous pen- dant qu'il se déroulait, avez- vous conscience d'avoir tiré une leçon à votre usage? Laquelle? Cette leçon est-elle de nature influencer votre comportement en amour?
II. Avez-vous été portée à vous identifier à la personne en scène et dans quelle mesure? Au cas contraire, vous êtes-vous plu à détailler ses formes et son jeu d'un œil critique? Hostile?
III. Prendriez-vous intérêt au dévêtement méthodique sur scène (exigeant, bien entendu, un cérémonial d'un tout autre ordre, à déterminer) d'hommes choisis en raison, soit de leur prestance, soit de l'attraction — éprouvée ou supposée - qu'ils exercent?
♂ I. Tenez-vous le strip-tease pour plus ou moins apte que le cinéma à « éveiller l'appétit érotique »? Pourquoi?
II. Sous le rapport de l'effet produit sur les sens et sur l'esprit, le livre érotique, qui vise à enflam- mer l'imagination du lecteur, se situe-t-il pour vous en deçà ou au delà du strip-tease, qui pro- pose à votre possible exaltation une image concrète dont les autres spectateurs bénéficient simultanément avec vous?
III. Le strip-tease vous découvre- t-il une marge de tentation qu'avec la complicité de la femme que vous aimez vous pourriez envisager de donner - ou souhaiteriez donner - à votre vie intime?
★
Dans son ouvrage Mythologies, récemment paru aux éditions du Seuil. Roland Barthes dénonce le côté « mystifiant », selon lui, du strip-tease, qui, sous couleur de provoquer et attiser le désir, tendrait à le conjurer par les moyens de l'exotisme, de la danse, des parures de music-hall (plumes. fourrures, cache-sexe final en clinquant), etc. Pensez-vous comme lui qu'en dépit des protestations « bien pensantes » auxquelles il donne lieu (et qui servent au mieux sa publicité), en fait le strip-tease « désexualise » la femme et freine en ce qu'elle doit avoir de spontané et d'inventif l'imagination amoureuse?
I. Le strip-tease est une nostalgie de l'hétairisme. Il transfère sur le plateau la prostituée symbolique. Réservé à un public restreint, comme il l'était naguère à Sardanapale, il ne peut être un agent de propagation comparable au cinéma. Mais comme il met en mouvement des personnes vivantes et non des personnes d'ombre, il est un meilleur agent provocateur que le cinéma de l'appétit charnel. Tout dépend du public auquel on s'adresse. Les vieux beaux qui ‹ se rincaient > l'œil hier à l'Opéra sont-ils aujourd'hui des fervents du strip-tease? La jeunesse qui bande naturellement ne verra qu'un jeu, une partie de rires, là où les gens d'âge recher- cheront des aiguilles d'or.
II. Le livre érotique se situe au delà du strip-tease. L'agitation que provoque le strip-tease est passagère. Ses sortilèges sont publics, le spectateur n'est pas libre. Il fait partie d'une chaîne de regards, d'une chaîne de rires qui troublent et humilient le mystère intérieur. Le lecteur du livre est baigné de solitude. Il peut maintes rouvrir le livre pour y retrouver le paysage exaltant qu'il a marqué d'un signet, et qui est capable de provoquer en lui l'agitation érotique et le plaisir solitaire. l'en conclus que le livie est un excitant de l'imagination beaucoup plus efficace que le strip-tease.
III. Je ne pense pas que le strip-tease développe une marge de tentation pour la vie amoureuse intime. Ses recherches et ses enjolivures sont certainement en retard sur les permissions que s'accordent les amants. Ils n'y découvrent rien de nouveau, sauf le luxe. Le strip-tease est pour les amants « cochons › ce que serait le déshabillage méthodique d'un cortège de mariage dans le High life, pour les couples bourgeois. Exemple, le mariage de Dreux. Leur imagination pourrait broder là-dessus.
Oui, Roland Barthes a raison quand il dénonce le côté mystifiant du strip-tease qui intellectualise l'acte érotique. Il en émousse l'agressivité et l'animalité. ce propos, ce fait-divers de la veille, pour conclure moralement.
Un Nord-Africain, à bicyclette, dans un chemin creux de la banlieue parisienne, passant sur un petit pont, croise une mère qui pousse un landau. Il saute de vélo, bondit sur la femme et la menace de jeter le poupon à l'eau si elle ne se donne et s'enfuit en pas à lui. Elle obéit. Après l'avoir violentée, il reprend sa machine et senfuit en riant. Madame n'a plus qu'à aller, selon la formule habituelle, ‹ conter sa mesaventure au commissaire ›.
Eh bien, une cure de strip-tease ferait du bien certainement au Nord-Africain en question, Messieurs des Ligues d'Action Morale. Pensez-y pour le détourner de son impulsivité hagarde. Il est vrai que le satyre travaille pour la reproduction l'espèce et qu'il recueillera peut-être de ce fait vos suffrages, alors que la stripteaseuse travaille pour les rêves.
Henri d'AMFREVILLE
* * *
STRIP TEASE Je n'ai pas eu l'occasion d'assister à une présentation de strip-tease. Tel qu'il a l'air de s'exécuter, ses moyens d'exaltation ne peuvent certainement pas, même pas de loin, soutenir la comparaison avec les moyens dont dispose le cinéma. Le pourquoi est évident: il n'y a pas de partenaire ni de décor-réalité coopérants ou contrastants, ni de changements essentiels de prises de vue ou de perspective, ni d'agrandissement subtil, ni d'ouverture sur les zones interanatomiques, qui — tous à la fois — pourraient communiquer au spectacle: l'imprévu, le drame, l'humour, la scandaleux, le charme, la précipitation, le ralenti, le merveilleux, le sentimenta cynique, l'amour et la banalité, dont se compose notre image du Réel. La présence d'un public anonyme, qui participe à une température érotique voulue, me paraît être d'importance. j'ai pu le ressentir à un très haut degré presque chaque fois que j'ai assisté en compagnie amie, féminine, à la projection de films d'inspiration et de réalisation totaiement obscènes. Ils ne peuvent pas ne pas produire un effet explosif à retardement, libérant et de longue portée heureuse sur les variations de la vie intime à deux. Je désirerais même dire qu'un sirocco pathétique, balayant la crasse chrétienne des • pudeurs › mercantiles, se dégage de la mise sous projecteur public de pareilles exaltations et fonctionnements du désir. Queiques-uns de ces films sont à classer parmi les petits chefs-d'œuvre du siècie. Ils entrent dans la catégorie des catalyseurs. Comparée à l'ouvrage imprimé, la traduction cinématographique des images est plus immédiatement concrète et active que leur traduction par le mot écrit. Si lon ajoute qu'en général le livre, et surtout le livre de valeur, n'est pas lu en collectivite, que, rarement lu a deux, il est surtout destiné à la lecture solitaire, sous le manteau, il ne nous reste en attendant une nouvelle conception de l'objet-livre et du langage écrit — qu'à nous incliner devant la supériorité des moyens de la cinématographie. Ainsi que les appareils à sous, le strip-tease m'intéresse à un seul point de vue: Quelle est son utilité publique exacte (la question « arts et métiers rémunératifs, mise à part)? Quant à l'homme seul, sérieux, le strip-tease enrichira sa masturbation paisible ou ses aptitudes devant quelque commission de recrutement d'engagés volontaires, chaque fois que sa jeunesse l'emporte. Quant au couple moyen, rassuré devant la déception d'un spectacle sans amour, ni sperme, tout juste préparatif: supposons en toute loyauté que sa vie conjugale s'en trouve ravivée, au bénéfice de la repopulation de plus en plus urgente. Quant à la femme célibataire, enfin, elle sera positivement encouragée à se reperfectionner. Mais là, du point de vue civique, il est à craindre qu'une effeuilleuse à domicile, qui chauffe intentionnellement son spectateur à blanc pour le plaisir de baisser ensuite poliment son rideau, risque de recevoir. à titre d'honoraires, une offre en mariage ou même une gifle suivie du conseil empresse: strip-tease go home. Hans BELLMER
* * *
Le striptease n'a aucunement pour fonction d'éveiller ce que vous appelez l'appétit érotique mais plutôt de lui procurer une satistaction de remplacement. C'est un spectacle public, qui commande aux spectateurs une attitude strictement contemplative, c'est-à-dire passive, immobile. S'il y a excitation, c'est nécessairement à vide. Une femme se déshabille sur la scène (ou bien, comme au music-hall d'ancien style, y est présentée toute déshabillée): il est entendu que, dans les deux cas, chacun reste tranquillement assis dans son fauteuil. Ceci résume tout: au striptease, le fait pour la femme de se dévêtir n'est pas un prélude, mais le terme même du spectacle offert. Il n'est pas question que le spectateur devienne acteur. Ce qui rend le déshabillage émouvant, c'est d'y participer. spectateur devienne acteur. Ce qui rend le déshabillage émouvant, c'est d'y participer, les gestes rendus maladroits par le trouble qu'ils développent. Autrement il s'agit du leurre qui joue exclusivement sur le tabou de la nudité.
Cette mise au point fait prévoir la réponse suivante: l'efficacité éventuelle du cinéma et surtout du livre érotique est infiniment plus grande que celle du strip-tease dans la mesure exacte où l'on se trouve par la lecture ou les conditions de la projection moins contraint à une pure attitude de spectateur. Il reste que la précision du spectacle demeure l'élément déterminant.
Je n'ai pas bien compris votre troisième question. En quoi consiste la marge de tentation que vous évoquez pour la vie intime du couple? Que la femme se livre à complexe chorégraphie pour se dévêtir? Je le trouverai pour ma part simplement grotesque. Que le couple en question se rende à un spectacle de strip-tease pour y trouver quelque source d'émotion érotique? Je plaindrai ce besoin. Dois-je entendre au contraire que les amants, allant plus loin, s'entendent pour introduire dans leur vie intime une comparse qui se dévêtirait en leur présence? Avec, il faut le dire, les conséquences à peu près inévitables d'une pareille intervention dans les conditions envisagées. Je crois qu'une femme aimée et aimante peut accepter cet élément supplémentaire d'excitation, mais il est en général plus difficile de convaincre la comparse de s'y prêter, non pas à cause du rôle érotique qu'elle y joue, mais pour les raisons d'ordre moral, à cause de la fonction subalterne ou accessoire à laquelle elle se voit réduite et qui normalement lui coûte s'il ne s'agit pas d'une professionnelle. J'en viens enfin à l'opinion de Roland Barthes. Je n'accorde pas trop d'importance à ses arguments, mais pour l'essentiel, il n'a que trop raison : à cette réserve près que ce ne sont pas le décor ou les ornements qui opèrent la mystification, mais la nature même de spectacle qui est celle du strip-tease. Peut-on se trouver à ce point impressionné par une simple nouveauté de présentation? Le strip-tease n'est qu'un numéro de music-hall dont l'audace apparente est seulement celle que supportent et appellent les mœurs concomitantes.
Roger CAILLOIS
* * *
I. Je ne puis répondre à cette question, le strip-tease aussi bien que le cinéma strip-tease aussi bien que le cinéma n'ayant pas (surtout aujourd'hui) la possibilité d' • éveiller l'appétit érotique librement ; donc, seules les (des) femmes par l'érotisme se dégageant d'elles peuvent, dans les limites du permis par la société dans laquelle nous vivons, ‹ éveiller l'appétit › aussi bien au cinéma qu'au strip-tease. Il faut cependant répéter que le cinéma et le strip-tease se complètent de deux façons : a) Le strip-tease filmé peut (pourrait) être plus érotique que celui pratiqué sur scène, car à la découverte première s'ajoute une seconde, celle due à la caméra qui peut non seulement multiplier la première, mais aussi souligner (par les gros-plans, le montage, le raienti, etc.) des gestes et des parties du corps féminin; sans oublier évidemment la magie érotique propre au cinéma (salle, écran, engourdissement magnétique du spectateur, etc.), pouvant s'ajouter à celle projetée sur la toile blanche. b) Le strip-tease peut enrichir la pauvreté des séances cinématographiques, s'il est pratiqué sur scène pendant les entr'actes. Il devrait être approprié au film programmé. qui par ce moyen acquerrait une nouvelle dimension. Ainsi, avant la projection du Journal d'un curé de campagne (par exemple), un jeune curé monterait sur scène et avec beaucoup de grâce se débarrasserait de la ceinture, de l'étole, du chapeau noir, de la soutane et enfin du crucifix pour découvrir à nos yeux émerveilles un admirable corps de femme n'ayant rien de religieux. Le film prendrait par la suite une nouvelle signification, il deviendrait, peut-être, sublime. Avant les films de gangsters je souhaite des strips violents, avant les films psychologiques des strips burlesques, etc. Pensez aussi aux possibilites des strips qui accompagneraient les films de science-fiction. Les rapports entre le strip-tease et le cinéma, très nombreux et insoupçonnés, doivent être sérieusement étudiés. II. L'image concrète est certes plus forte que le flou du livre érotique, mais ceci dans le seul cas où l'image concrète proposée à nos sens et à notre esprit ne reste pas superficielle mais enflamme aussi notre imagination, notre vie. D'autre part, l'érotisme étant merveille intime, il serait à craindre que le partage avec un grand nombre de spectateurs amenuisât sa puissance. III. Certainement oui. Les plumes, les fanfreluches, les aigrettes, les dentelles, les fleurs, les colliers, les peignes, les diamants, les projecteurs, les couleurs, la musique, la danse sont des éléments hautement érotiques; ils attisent donc le désir. Tous les accessoires sont bons pour enrichir le strip-tease qui en est encore à ses balbutiements et qui pourrait notamment se servir d'objets surréalistes pour atteindre à la plus haute tension. La • mystification » du strip-tease réside ailleurs : Il devrait être un engagement à connaître l'amour, à vivre l'amour. Les spectateurs d'un spectacie de strip-tease devraient sortir de la salle les mains pleines de révolte, 'esprit prêt à découvrir la rareté, l'unique. Le strip-tease devrait étre le meilleur moyen pour apprendre à la femme comment être érotique dans le moindre de ses gestes. comment vivre érotiquement et pour engager aussi bien homme que la femme à rencontrer la passion. Malheureusement (et ceci par la faute des « bien pensants › qui malgré leurs fausses protestations ont guide le strip-tease vers son impasse), il n'est qu'un but, il remplace l'amour. La grande majorité de ses spectateurs y vont pour satisfaire leurs besoins érotiques par le seul spectacle. Le strip-tease n'est pas une arme mais un palliatif. Examinez les visages des spectateurs de strip-tease, regardez altentivement les yeux morts des jeunes filles qui se présentent aux concours de strip-tease amateur. Ce sont des visages enflammés peut-être pendant la séance, mais repus ensuite : ce sont des yeux de filles qui s'offrent avec calcul et en ignorant l'amour. En fait le strip-tease peut et doit • sexualiser • la vie; les spectacles de strip-tease. tels qu'ils ont été patiemment forgés par les ennemis de l'amour, « désexualisent , la vie, parce qu'ils tendent à canaliser le desir dans un spectacle et aucun spectacle ne vaudra jamais la vie. Ado KYROU
* * *
I. Seul le premier spectacle de strip-tease auquel j'ai assisté m'a laissé une impression qui compte. Entrée dans un bar, un soir, pour me mettre à l'abri d'un orage, je suis montée dans la salle du haut, celle du bas étant bruyante et enfumée. J'ai été frappée du silence qui régnait dans cette pièce, bien que les consommateurs aient été nombreux. Les deux fenêtres ouvertes, illuminées par les éclairs et que personne ne songeait à fermer, laissaient entrer le vent qui gonflait les rideaux et, par moments, des rafales de pluie. Mais le silence pesant reléguait au loin tous les bruits. La tension créait une atmosphère irrespirable. Au bout d'un peu de temps, les regards ont convergé sur un couple qui occupait l'un des coins de la pièce. Sans parler, l'homme effleurait le bras et l'épaule de sa compagne de lentes caresses. Celle-ci a eu l'air de se réveiller. Elle a commencé à se dévêtir avec une extrême lenteur sans que l'homme intervienne. Cette femme n'était ni très bien faite, ni très sûre d'elle. A part deux ou trois couples, l'assistance était composée d'hommes seuls. Cette vingtaine de regards fixés sur elle affolait et comblait l'exécutante, partagée visiblement entre l'envie et la peur. Elle avait des hésitations non jouées, parfois des arrêts. Je ne sais pas quelle leçon j'ai tirée de cette scène. Elle m'a plu par son caractère de sincérité, d'inattendu, par l'heureuse chance qui lui faisait un accompagnement de vent et d'orage, par l'ambiance de ferveur, de sérieux passionné qui régnait dans la pièce. II. Jamais, ni ce soir-là ni par la suite, il ne m'est arrivé de m'identifier avec la personne en scène. Lors de la première expérience, dont je viens de parler, l'exécutante semblait libérer ses instincts érotiques les plus enfouis et vivre pour son compte à elle. Je trouvais que c'était très sympathique. Au cours des autres séances mon attitude a changé. La vedette du strip-tease m'inspirait le même sentiment d'éloignement que la lecture d'un livre écrit dans le but de plaire. Elle m'agaçait, je la détaillais sans sympathie, contemplant son jeu d'un œil critique. Souvent j'ai éprouvé vis-à-vis d'elle une certaine hostilité. III. Je prendrais plus d'intérêt au strip-tease s'il était pratiqué par des hommes. Une maîtresse de cérémonie déciderait du rythme à adopter suivant l'intérêt présenté par chaque sujet. Le décor pourrait suggérer quelque site boréal, historique. infernal... Le choix des sujets pourrait s'effectuer en fonction du décor. Les reflets rougeoyants d'appareils électriques se poseraient plus agréablement sur des chairs plantureuses. D'autres effets réclament un homme portant la barbe, d'autres, un éphèbe, etc. Je ne pense pas que le strip-tease serve en quelque manière l'imagination amoureuse. Tout au plus peut-il donner le goût (à ceux qui n'y auraient pas pensé d'eux- mêmes) d'entourer les actes amoureux d'un cérémonial qui les rehausse et leur contère plus de prestige. Françoise de LIGNERIS
* * *
TRANSPORTS EN COMMUN I. A peu près une fois tous les cinq ans je vais voir les troupeaux de bovins stupides. tous ces visages congestionnés qui suent et soupirent devant quelques ventres nus, quelques croupes rebondies; bref, le strip-tease. Je n'éprouve aucune émotion, ne regarde même pas, ou presque pas, la personne qui se dévêt; je n'en tire aucune leçon. Je me rends dans ces endroits en général enfumés, mal éclairés et moites des puérils désirs anonymes, mue uniquement par cet implacable instinct de piraterie qui caractérise les kleptomanes. II. Je ne me suis jamais identifiée à la personne en scène: je ne détaille ni ses formes, ni son jeu. Je ne suis nullement hostile; seulement indifférente. III. Je pense qu'aucune manifestation publique ne pourrait m'intéresser. Un homme, qu'il soit un Adonis, un monstre, ou M. Coty, qui se dévêt pour dix mille personnes tous les soirs à la même heure, ne peut me concerner. C'est trop abstrait. Je trouve que la femme devrait se cacher dans les replis imaginaires, indécis, de son propre reflet ; elle ne doit pas se départir de la modestie et du mystère pour que l'homme puisse la créer peu à peu telle qu'il la devine. Oui, je trouve que le strip-tease désexualise la femme et freine l'imagination amoureuse tout en l'alourdissant d'images stéréotypées. Joyce MANSOUR
* * *
I. Il ne saurait s'agir d'une leçon, car la strip-teaseuse adopte le plus souvent des conduites de théâtre qui, dans la mesure où elles incluent des moments sportifs, burlesques, humoristiques destinés à servir de prétextes au dévêtement, s'éloignent du comportement érotique, dédaigneux, lui, de tout genre de • prétextes ». Dans le meilleur des cas, quand une jeune femme comme Dodo d'Hambourg parvient à commu- niquer l'illusion du trouble, quand à la tempête intérieure répond le besoin irrépressible d'être nue, pour s'offrir, comme un défi à l'impossible, à la fois la fraicheur susceptible de la calmer et le surcroît d'excitation destiné au déchaînement, dans le meilleur des cas, donc, nous ne demeurons qu'au seuil, bien connu de toutes. Le spectacle agit alors à la manière d'une invitation, ou d'une provocation, à passer outre. II. L'identification demeure impossible dans la mesure où la demoiselle a besoin des prétextes cités plus haut. Quand ces prétextes s'évanouissent, une manière sympathie tendant vers l'identification pourrait apparaître, mais je dois avouer qu'un certain sentiment esthétique teinté d'érotisme, assez proche peut-être de la réaction masculine, l'emporte. Quand la jeune personne plaît, on aimerait voir au-delà du seuil permis. Que les gestes sur la scène s'exaspèrent, qu'il n'y ait plus de scène et que l'on puisse enfin disposer à son gré. III. Un tel spectacle ne présenterait pour moi aucun intérêt. Le dévêtement méthodique d'un homme, aussi attirant paraisse-t-il, ne sied pas à l'attitude souhaitée chez le partenaire viril. Une dame attendrait plutôt que l'autre la débarrassât de ses propres vêtements. En d'autres termes, la femme amoureuse appelle les gestes qui la saccagent, plutôt qu'un spectacle à elle offert, dont son corps demeure absent. Exhibitionnisme ef narcissisme féminin peuvent éveiller l'appétit érotique de l'homme, mais quand c'est la femme qui les surprend chez l'autre, cela suscite en elle je ne sais quel sentiment de stupeur mêlée d'effroi, ou bien encore l'irrésistible envie de rire (le vaudeville n'est pas très loin). Mais j'imagine que des femmes à dominante sadique ou maternelle prendraient à ce spectacle un certain plaisir. IV. Le strip-tease, comme l'amour, est à réinventer, on le sait bien. Sous la forme pratiquée de nos jours, il ne révèle que trop la désolante pauvreté mentale des hommes, les organisateurs de ce genre de spectacles, soucieux de se maintenir dans la zone commerciale —- sourires et clinquant de music-hall — située en-deçà du vertige. Si la demoiselle est obéissante et proprette, que ses mains glissent sur son corps comme on épluche une botte de poireaux, nous lui conseillons de se présenter plutôt au concours d'art ménager de la « Fée du logis ». Mais il arrive aussi qu'à l'intérieur même de la saynète préparée d'avance, un geste trahisse la fièvre soudaine, le fléchissement ressenti au creux des reins. Alors, le climat change. Nous voici à Barcelone, dans un café de l'ancien Barrio Chino. Dans la salle crépitante, une danseuse, traquée par sa propre frénésie, dévoile soudain intégralement son corps mouillé. Nora MITRANI
* * *
Le • strip-tease ›: dévêtement progressif dont la savante lenteur excite sournoi. sement les sens. Le cinéma joue son rôle propre, mais pour les seuls simples de l'amour, pour sa foule, car en dépit de tous les truquages et décors suggestifs, il n'a pas le piment du strip-tease vivant. Le dilettante de l'amour n'y trouve pas son compte assouvissant. L'image n'est que fiction. Toute autre est cette communion précieuse de la réalité et du rêve, dualité créatrice de cette fusion finale de force inégalée. A la vision du « strip-tease > l'acte amoureux est latent, suscité — ou en puissance par ces moyens magiques : transparence des voiles, éclairs de nudités, attraction toujours mystérieuse de la chair et de ses parfums, gaines caressantes harmonisant les formes... Ces prémices invocatoires prennent toute leur charge, grâce à leur apport spéculatif à l'opératif, le tout créant la divinité, véritable holocauste, viol taboutique. L'écriture érotique, tel le Roman d'O, en ce qu'elle provoque la masturbation métaphysique et le rut, est un aspect de ‹ strip-tease ›, mais un faible en-deçà. L'image érotique concrète quintuple l'exaltation du fait de la communion dans la même jouissance de toute une somme d'êtres, bien que chacun la pare de son rêve personnel et l'interprète selon l'appétit de ses sens. Pour mon ‹ moi › bien intime, mes tentations, avivées par la magie qui adhère à mes sens, ne tendent que vers la réalité, seule susceptible de me conduire au sommet. Ma vie ainsi assouvie n'aspire qu'à atteindre la plate-forme-sagesse de l'immoralité. Prétendre que le « strip-tease ›, se rapportant à la morale des familles, pourrait être un spectacle uniquement attractif, serait une impertinence dissimulant mal des fins mercantiles au seul usage des crétins, ceux-ci à jeter à la poubelle avec le commerçant qui se refuse à être confondu avec le voleur, l'agent des mœurs avec le maquereau, les membres de la IV° avec l'aventure usurière. Le ‹ strip-tease ›, pour ceux qui se veulent en dehors des normes courantes comme le voleur qui se définit voleur (mettant bas le masque d'hypocrisie) - n'est qu'un des plans du chef-d'œuvre d'amour. Pierre MOLINIER
* * *
Je n'arrive pas à comparer cinéma, lecture érotique et strip-tease. En principe, ‹ l'appétit érotique » peut être aussi bien éveillé par l'image (image de cinéma, image mentale née de la lecture) que par l'incitation directe de la chair. L'image et la chair constituent chacune un pôle de l'érotisme, qui n'est autre que leur commerce mutuel: l'érotisme enflamme la chair par l'imagination et enflamme l'imagination par la chair. En fait, on ne peut situer le cinéma et le strip-tease à chacun de ces pôles. L'érotisme du cinéma ne jouit pas de la liberté imaginaire: il est au contraire déterminé par des tabous (censure). L'érotisme de strip-tease (qui tire par ailleurs une part de son attrait du lever de certains de ces tabous) escamote toujours la chair qui semblait offerte. D'autre part, l'érotisme de cinéma s'inscrit au sein d'un complexe cosmique, l'érotisme de strip-tease au sein d'un rite clos. Comment comparer? Il faut aussi distinguer au moins deux types de strip-tease : le strip-tease égrillard. polisson, truculent, badin, spirituel, et d'autre part le strip-tease rituel, extatique, déchirant ou frénétique. C'est évidemment ce dernier qui peut être émouvant. Il contient en germe, sans pouvoir les développer (il les détruit moins totalement quand il s'abîme dans la paillardise) les éléments d'une cérémonie collective sacrée, d'un rite collectif d'amour. Mais le public répugnant, le cadre imbécile de la boite de nuit, le contexte bourgeois en un mot, détériorent le principe même du strip-tease avant qu'il puisse s'accomplir. Enfin, au moment où les forces évoquées et invoquées s'apprêtent à nous posséder, au moment où la danseuse supplie le fantôme qui la tourmente de s'incarner, au moment ou tout devrait ou pourrait devenir panique, on coupe le courant, ferme le rideau. Farce et attrape, et tout se résoud en niais applaudissements. Edgar MORIN
* * *
I. Je n'ai tiré aucune leçon personnelle de la manière dont opèrent les • strip- teaseuses ». L'ordre classique dans lequel se dévêtaient celles que j'ai vues, l'absence d'imprévu, le manque de rouerie personnelle et d'esprit d'invention faisaient souhaiter qu'avant de s'exhiber sur une scène elles aient reçu les leçons de grandes coquettes (sottise des filles dont les dessous style cheval de cirque paraissent faits pour être vus, donc dépourvus de toute charge scandaleuse quand elles les dévoilent, alors qu'une petite culotte de coton... Quant aux gestes, pas une n'essaie de nous faire croire que nous la surprenons sans quelle s'en doute, ou que ses mains sont des mains d'homme dépouillant un corps qui se détend). Leur manque d'imagination aurait fait pleurer au XVIIIe siècle. Elles ne se dévêtissaient pas, elles se déshabillaient. Pas de leçons pour moi sinon celle de ce qu'il ne faut pas faire. Les salles sont aussi primaires que celles qui donnent le spectacle. Pour être beau le strip-tease devrait être accompli par de vraies coquettes ou de vraies naives (c'est- à-dire pudiques). II. Je ne m'identie pas avec la strip-teaseuse. Je suis le public, donc je suis l'homme. La strip-teaseuse est objet, qui me plaît ou ne me plaît pas. Oui, certaines grosses cuisses m'ont déplu, certaines expressions, mais comme elles auraient déplu à un homme - qui aurait été aussi observateur qu'une femme. III. Non. Je ne considère pas l'homme comme une proie détaillable à merci. Et c'est tant mieux pour nous tous! D'autre part, je ne considère pas le strip-tease avilissant pour la femme puisqu'il monte en épingle le seul moment triomphant de la femme, celui où elle exerce à l'état pur son pouvoir sur l'homme, sans aller jusqu'au moment où l'homme sera le maître. Michele PERREIN
* * *
Etant donné mon peu d'expérience du strip-tease, je ne me sens pas autorisé à faire les comparaisons que propose l'enquête. Mais, en tant que possédé par la femme, je crois pouvoir témoigner sur ce qui a trait à la tentation féminine. J'ai le sentiment très net que cette envie, chez la femme, de changer, en tentatrice, de son épiderme de vêtements disparaîtrait si le commerce antiféminin du plaisir se mettait à l'exploiter. Pourtant, le strip-tease doit permettre bien des rencontres mer- veilleuses, à condition que soient réunis ces trois facteurs: l'adoration de la temme, le goût de l'art, la féminité raffinée. Ma Femme est bien celle du strip-tease du désir, et je ne crois pas que le rideau en tombera après ma mort. Au contraire, le strip-tease fantastique persistera par mon art, le strip-tease de la femme à l'épiderme de vêtements merveilleux. de gestes et de parfums comme l'or rose du matin, comme les pierreries du jour, comme les ombres couchées du soir, comme les yeux étonnés de la nuit. Ma Femme qui enlève sa jupe par-dessus sa tête et, déshabillée, se fait rosace sur la joue bleue de mon vertige. Pas de comparaison, je l'ai dit: juste quelques observations dans différentes directions : le French Can-Can, dans le film du même nom, rentre évidemment dans le cadre de l'enquête. Cette présentation du blanc sourire des dessous de dentelles, des longues iambes tentatrices qui, par d'irrésistibles mouvements, montrent le berceau en forme de cœur des hanches vers l'œil avide, pendant que les jupes inondent les sens, avec une houle amoureuse de couleurs, de dentelles, de soif de vivre, pareille au champagne des sourires qui déborde de la coupe des visages et inonde les sens, avec une houle amoureuse de couleurs, de dentelles, de soif de vivre, pareille au champagne des sourires qui déborde de la coupe des visages et inonde les jupes. Le rôle dansé dans Mademoiselle Julie, exécuté par Elsa-Marianne von Rosen, n'était que géante excitation : celle d'un corps pour l'amour, qui dansait avec un ventre qui cherchait et trouvait, comme un cygne-femme, Brigitte Bardot avec son visage comme comme pris aux sensuelles femmes nues de Renoir, est, dans Cette Sacrée Gamine, une invitation aux fêtes amoureuses. La danse merveilleusement érotique dde Yerma, exécutée par deux femmes terriblement agiles, l'une habillée d'un tricot blanc, l'autre rouge avec dans la main l'attribut mâle, est un jeu prodigieusement excitant, pendant que rit le cœur de la nuit, rencontre de feu et de neige. Dans les Illuminations de Rimbaud se trouve cette femme métamorphique, avec sa peau de pierreries et ses yeux gravides, de même que dans l'Union libre de Breton, excitante et merveilleusement belle dans les rencontres étranges. Le rideau, cette jupe de strip-tease du theâtre et du plaisir, se lève sur des hybrides de faisans argentés et de caméléons, pour la faim des soleils jumeaux qui jouent entre les yeux de miel et le ventre de miel du monde. Femme éternellement brodée d'anges qui enjambe les yeux ouverts des lacs et en mange la bleue confiture. Il est temps de remplir les thorax de neige, et les ventres de soleil brillant. Je désire créer, par mon art, un ballet étrange, une parade de rencontres étranges, un strip-tease de désirs étranges. Max-Walter SVANBERG
* * *
I. S'il nous permettait seulement, par l'observation du spectacle qui est dans ia salle, de constater la diversité des réactions masculines aux mêmes stimulations sexuelles, le strip-tease ne nous apprendrait pas grand chose. Mais il me semble d'un grand intérêt, pour une femme, dans un domaine où les pudeurs foisonnent, de pouvoir observer les réactions spécifiques de l'homme qu'elle désire séduire ou conserver par un déploiement de charmes sans cesse renouvelé ou parfait. Pour qui sait voir et comprendre, le strip-tease est une manière de Rapport Kinsey sur le partenaire de son choix. II. Pour ma part, je ne saurais pas plus m'identifier à une effeuilleuse en scène qu'à aucune créature de l'écran, de l'histoire ou de la littérature: la conscience obsédante de différences profondément ressenties m'en empêche. Etant peintre, il est évident que je ne puis rester indifférente devant la beauté d'un être : question, en sorte, de déformation professionnelle. Quant au jeu d'une effeuilleuse, je le suis forcément d'un œil critique, ayant une conception personnelle de ce jeu de la séduction qui doit à mon sens donner l'illusion d'une complicité entre la danseuse et chaque spectateur en particulier (le regard, le sourire et une certaine gentillesse ont ici une importance considérable). Mais jamais un soupçon d'hostilité ne saurait m'effleurer dans un spectacle qui a toutes mes sympathies. III. Le dévêtement méthodique d'un homme en public serait totalement dénué d'intérêt, voire comique. Un homme plus ou moins déshabillé peut éveiller une émotion d'ordre esthétique mais non sexuel. La proposition • l'Homme aime regarder la Femme : n'est pas réversible; la réciproque en est: ‹ La Femme aime à être regardée par l'Homme. • Il est normal en amour que la Femme se donne et que l'Homme prenne, fût-ce avec les yeux. Le spectacle de strip-tease est celui du prélude sexuel. De la part de la Femme, c'est celui d'un être qui déploie toutes les astuces imaginables pour soffrir en toute passivité, c'est-à-dire en toute féminité. L'équivalent pour un homme serait de se préparer en scène à • prendre › de la manière la plus virile, à savoir la plus active : il ne pourrait le faire qu'en étalant sans vergogne son agressivité sexuelle. On n'imagine guère, dans l'état actuel des mœurs, l'exhibition publique de mâles en rut. Ce serait pourtant la seule forme de strip-tease masculin capable d'émouvoir les femmes. Le rituel du strip-tease, avec tous les accessoires quasi traditionnels qu'il comporte, ne saurait inhiber la sexualité. Autant prétendre que le décorum gastronomique vous coupe l'appétit. Les parures, aussi bien des hommes que des femmes, ont toujours été utilisées, dans toutes les formes de civilisation, non pour conjurer le désir mais pour l'attiser. Le strip-tease est une technique de la séduction. Dans tous les arts, la technique une fois maitrisée, son usage devient spontané. Seul un peintre débutant peut voir son imagination créatrice troublée s'il cherche à employer d'emblée la technique d'un Léonard de Vinci. Les • bien-pensants › cherchent par tous les moyens à désexualiser les arts (surtout ceux qui s'adressent au grand public: cinéma, théâtre, etc.). Il était grand temps que, par compensation, on s'efforçât d'introduire un art dans l'érotisme et en l'occurrence dans ses prémices. Cet art a toujours existé d'ailleurs dans les civili- sations raffinées de l'Orient, et il faut que la nôtre soit absurde pour s'enorgueillir d'un art dans le boire et le manger, mais le proscrire en amour! Monique WATTEAU