
Bief n°12, 15 avril 1960
| SOMMAIRE | |
| (interlocuteurs multiples) | Le dialogue de Londres |
| Her de Vries | Du pays des brumes blondes |
| Gérard Legrand | Défense d'interdire |
| André Breton | Loin d'Orly |
| La Rédaction | Mise en garde |
| Gérard Legrand | Je le dirai en enfer, si l'enfer existe |
| Robert Benayoun | Pas de sel dans notre sucre |
| José Pierre | L'épinoche et le trompe-l'œil |
| Jean-Claude Silbermann | Balises |
| Jean Schuster | Première note sur l'objet |
| La Rédaction | Expresses réserves |
| Alain Joubert | Les allées et venues |
| Joyce Mansour | Conseils pratiques en attendant |
| Jean-Claude Barbé | Couple |
| Jean-Claude Silbermann | Lentille pour stéthoscope |
| Radovan Ivsic | Le marché noir |
P.2
LE DIALOGUE DE LONDRES
Le 19 février 1960, notre ami J.-B. BRUNIUS présenta sur les antennes de la B.B.C. une émission intitulée « In Defense of Surrealism » qui, sous la forme d'une entretien presque improvisé, mérita son titre, comme on en jugera par ces quelques extraits, traduits de l'anglais :
OCTAVIO PAZ : C'est un fait bien connu que la poésie a des racines érotiques, mais le surréalisme assume une position particulière : pour lui la poésie et l'érotisme sont identiques, car ils ont la même origine et la même fin. Un poème est une sorte d'univers verbal, où les éléments opposés sont unis par les voies de la métaphore. Dans l'amour, qui est aussi une métaphore, les pôles contraires de la vie, l'actif et le passif, le yin et le yang, s'unissent. Et plus encore, dans la poésie comme dans le plaisir érotique, les contraires disparaissent pour faire place à une nouvelle réalité (...). Aujourd'hui, où la science et toutes les puissances actives de la sociélé se sont efforcées, avec succès je le crains, d'unifier la vie — mais d'une manière toute extérieure, — l'érotisme est encore une façon de vivre secrète et sacrée qui peut opposer à l'enrégimentement quelque chose de personnel et de vraiment créateur. Il n'est pas étonnant que le surréalisme, qui est attaché à la vie, s'efforce d'exalter ce genre de valeurs personnelles et de valeurs d'imagination, devant la vulgarité de notre société contemporaine.
JOYCE MANSOUR : C'est à peine si quoi que ce soit scandalise qui que ce soit à présent, trouble le paradis mort des bonnes consciences épaisses. On peut publier des photos de cadavres sans que personne ne remue. La seule chose qui provoque des poussées de fièvre ou des bouffées de chaleur, ou un mouVement quelconque, c'est le scandale sexuel.
ROBERT BENAYOUN : Le public a toujours été surpris par la part de jeu qu'implique le surréalisme. Nous avons été accusés en même temps d'être trop sérieux et d'être trop frivoles. Nous pratiquons bien des jeux, à la fois pour leur intérêt expérimental et parce qu'ils sont la toute première expression de la liberté humaine (...). De sorte qu'on peut dire que l'activité ludique est pour nous une sorte de soupape de sûreté : elle nous maintient d'une part en contact avec les forces les plus positives de la vie et, d'autre part, elle nous aide à perpétuer quelque chose qui est un besoin élémentaire des poètes : le sens du merveilleux.
OCTAVIO PAZ : L'idée de la science, l'idée de l'homme de science, sont des idées très limitées, car pour l'esprit scientifique, la nature humaine est entièrement rationnelle. La cybernétique s'efforce d'imiter nos conduites, mais seulement celles qui sont rationnelles. Pourtant l'homme est aussi bien imagination et intuition qu'autre chose,
JOYCE MANSOUR : Il n'y a pas une manière de peindre surréaliste. Ce n'est pas la technique de la peinture qui est surréaliste, c'est le peintre — et c'est sa vision de la vie.
J. B. BRUNIUS : Il y a maintenant trente-cinq ans, le surréalisme entra sur la scène comme un mouvement révolutionnaire non seulement en art, mais aussi sur le plan social. A-t-il abandonné l'espoir de promouvoir un changement de la vie sur ce plan ?
NORA MITRANI : L'exploitation de l'homme par l'homme a toujours ses formes traditionnelles, la religion, le respect des parents, le devoir envers l'Etat, mais aussi elle prend des formes nouvelles : le respect de la bureau- cratie, la découverte de nouvelles formes d'énergies, comme l'énergie atomique, applicables aussi bien à la guerre par l'industrie. Ce qui me paraît aussi grave que la manipulation de l'homme par le grand capital, c'est cette manipulation sociologique que les psychologues professionnels appellent « éthique de groupe », ou art des relations humaines. Inventée à la fois aux Etats-Unis et en U.R.S.S., la science des rapports humains, ou « industrie humaine », s'efforce de créer un homme moyen, un homme bien entouré et parfaitement adapté à son groupe, à toutes les espèces de groupes (corporations, armée, administration, clubs) pour qu'il reste soudé aux autres hommes et s'y complaise. (...) A toutes les formes d'exploitation, depuis les plus traditionnelles jusqu'aux plus récentes, le surréalisme oppose un refus inchangé. Il ignore la sagesse rancie de l'homme qui prétend connaitre la bonne manière de vivre. Naturellement, nous voulons que la révolte s'achève en révolution, mais s'il est question de révolution au sens politique et social défini par les marxistes, disons que ce genre de révolution n'est pas assez pour le surréalisme. Ce ne sera jamais assez. Les hauts standards de vie, les loisirs et les congés pour tous, toutes ces conquêtes du prolétariat ont été gagnées ces dernières années par le réformisme, non par la révolution... Cette promotion des masses représente en fait une trahison : la conscience de classe cède le pas à la lutte pour la sécurité et aux types bureaucratiques d'irresponsabilité organisée. Certes, il y a de plus en plus d'hommes aux mains propres. Il y a de plus en plus de travailleurs en col blanc. Mais qu'est-ce que cela change pour nous ? Qu'est-ce que cela change pour l'être humain ?
ROBERT BENAYOUN : La science redoute les envols de la poésie et de l'imagination, elle redoute jusqu'à l'amour, Elle veut modifier l'homme, parce qu'elle combat l'équivoque qui est la matière de l'art. Le surréalisme refuse son influence pour exalter tout ce qui, dans la nature humaine, touche au mystère, à la vision.
JOYCE MANSOUR : La seule chose qui soit pour moi absolument vraie et tangible au sein du monde « scientifique » est la peau de chacun, et la seule chose que chacun peut faire avec elle est ce qu'il imagine, alors que la science n'a rien à en faire.
OCTAVIO PAZ : Le surréalisme a évolué, mais la façon de changer du surréalisme, c'est d'être fidèle à lui-même.
NORA MITRANI: L'homme de la civilisation des masses a fait un misérable marché. Il a échangé son indépendance, la liberté de son esprit, pour un plus haut niveau de vie, pour une consommation de « signes extérieurs ». (..). Même là, d'ailleurs, il y a encore à faire et à gagner. Mais pour le surréalisme, ce marché est misérable, il n'y a aucun marché au monde qui puisse nous satisfaire. Il n'y a pas d'autre issue que de choisir la solitude, ou le compagnonnage des rares êtres humains qui partagent les mêmes valeurs spirituelles.
DU PAYS DES BRUMES BLONDES
Après avoir souligné que la « reconnaissance » du surréalisme constitue pour lui un « danger plus menaçant que les efforts pour l'enterrer », et qu'en France aussi bien qu'à l'étranger « l'esprit surréaliste reste incompris », nos camarades néerlandais nouvellement regroupés écrivent :
« Nous voulons tout d'abord marquer itérativement notre accord unanime sur les buts et moyens formulés et réaffirmés avant, pendant et après la guerre par André Breton... Nous proclamons encore une fois la valeur et la confiance que nous attachons à la Révolution Surréaliste, que nous ne considérons pas du tout comme enterrée, ni comme terminée.
(...) Nous tenons à déclarer que notre réponse à la célèbre question : Dieu existe-il ? ne sera qu'un seul mot : NON. Afin de prévenir toute fausse interprétation de notre attitude à l'égard des religions nous insistons sur le fait qu'il ne faut pas confondre cette négation de dieu avec la révolte contre un dieu supposé existant, avec le satanisme : chez nous il n'est question que d'une absence pure et simple de foi. Qu'on ne suppose pas chez nous la foi quand nous lancerons des injures contre les prêtres, contre l'église. Pous nous la négation de dieu est prééminente : ces injures, nommées blasphèmes, ne pourront avoir aucun rapport avec le dieu dont nous nions l'existence. Nous ne voulons que mettre à la place de ce que nous tenons pour une idée fausse, pour une erreur, l'unique et la seule source des valeurs de l'homme, le plus puissant élément de la liberté : la vérité.
Nous croyons à la valeur de la poésie, de l'amour et de la liberté.
(...) Les membres présents du Groupe Surréaliste en Hollande adoptent les déclarations qui précèdent et saluent tous leurs camarades du Mouvement Surréaliste International. »
(Extraits de L'Etat Actuel des Choses, déclaration du Groupe Surréaliste en Hollande en date du 31 décembre 1959, par Her De Vries, Bureau de Recherches Surréalistes, 1095 Prin- sengracht, Amsterdam).
DÉFENSE D'INTERDIRE
« Nous n'avons nullement cherché à ranimer des colères et des conflits au sujet d'Artaud », affirme Pierre Boujut dans le numéro spécial (63-64) de La Tour de Feu. Si un obscurantisme de type religieux fait rebondir la plus stérile des polémiques, force est de reconnaître qu'en effet le groupe un peu disparate de Jarnac n'y est pour rien. lout n'est pas excel- Jent dans ce cahier, mais l'entreprise, nullement déshonorante, s'est avérée salubre.
Donner la parole à un psychiatre ne signifie pas qu'on endosse tous ses procédés (et le Dr Ferdière n'est pas le maniaque de électro-choc que seul un autre psychiatre serait d'ailleurs qualifié pour contredire). Donner la parole à une famille avec laquelle Artaud restait en correspondance ne signifie pas qu'on s'aligne sur son conformisme social ou religieux. Donner la parole à des témoins ne signifie pas qu'on accepte tout l'arrière-plan de leur témoignage, ou même ce que ce témoignage peut avoir de tendancieux.
Mais ces quelques évidences échappent à ceux qui, en Artaud, ne virent naguère qu'une occasion de provoquer un peu de bruit autour de leur propre obscurité. Lorsque Boujut démonte lumineusement l'opération qui, dès 1948, faisant d'Artaud un dieu, exigeait face à ce dieu un démon destructeur (tantôt le Dr Ferdière, tantôt « la famille »...), il est normal que les convulsionnaires patentés et les fabricants d'amulettes grincent des dents. En prétendant que certains textes de Rodez, par exemple, ou Artaud manifeste un mysticisme chrétien, ont été écrits sous la pression des circonstances (!), ils mettent en doute cette fameuse continuité entre génie et folie que par ailleurs ils s'emploient à défendre avec tant d'acharnement. Quant aux interprétations « coupables » de sa pensée, ce nest pas derrière le rideau d'encens et de crasse d'une nouvelle église (où sans doute Roger Blin et Paule Thévenin se sont fourvoyés), que naîtra la vérité, seule conquérante légitime.
Je ne partage point l'ivresse de destruction du sacré qui semble saisir par instants Pierre Boujut, mais je ne crois pas non plus que le sacré se profile — à supposer qu'il prenne forme humaine - dans une ombre aussi torturée, et pourquoi ne pas dire, aussi multivoque que celle d'Artaud. Je crois donc être en posture parfaitement sereine pour affirmer que La Tour de Feu sert mieux la cause d'Artaud que les signataires de L'Obscène Repas (encore que la bonne foi de nos camarades de Fragile, et celle des animateurs de Structure, ait certainement été surprise). Artaud est mort : en l'absence de toute déclaration concluante de sa part, on ne saurait plus exiger que la constitution objective d'un dossier dont rien n'aurait été retranché (*). Une « Association » qui, après avoir éconduit les envoyés de La Tour de Feu, les accuse de ne pas l'avoir consultée (cf. *Les Lettres Françaises* du 17 décembre 1959) et qui, pour répandre ce mensonge, utilise sans l'en prévenir le nom d'André Breton, a perdu tout droit à l'ouverture d'un tel dossier.
Gérard LEGRAND.
(*) Dans une lettre à Breton datée du 18 janvier, Boujut annonce la publication prochaine de documents prouvant que l'édition actuellement en cours des *Œuvres Complètes* a été censurée, non par Mme Malaussena, mais par une tierce personne, à des fins strictement commerciales.
LOIN D'ORLY
A l'heure où « Monsieur K » - comme ils disent — pose le pied sur le sol de ce pays, irrésistiblement ma main se dirige vers le Journal d'exil de Léon Trotsky, qui vient de paraître. Jamais mieux, jamais en termes plus concrets qu'en ce jour et à cette lumière de premier printemps sur Paris ne s'est posé le problème de l'histoire et de la contradiction dramatique qui réside en elle. Dans la mesure où elle se connaît pour réelle et irréversible, elle tend à s'accorder une valeur absolue et dernière; dans la mesure où elle véhicule des intentions manifestes qui avortent ou dont la réalisation est sans cesse reculée, elle ne peut se saisir que comme contingente. De ce double fait, elle reste penchée sur son propre abîme.
« Les trous de drapeaux méditants » — rouge et or pour quelques jours - n'ont jamais pris, au fronton des édifices, un sens plus ambigu qu'aujourd'hui. Affectivement, pour ma part, il m'est impossible de les abstraire de ce dont ils ont été l'emblème et mon regard participe de celui que Trotsky - malgré tout — eût eu pour eux. Et cependant comment faire pour que n'y grouille pas l'immonde Vichinsky des « procès », pour que s'y lavent les mains d'un « Mornard », que la paix soit sur Budapest qui crie justice ?
Pour Marx comme pour Hegel, comme pour nous, l'histoire tout entière n'est autre que la relation des efforts de la liberté pour venir au jour et y progresser lucidement. Une telle vue est, naturellement, toute panoramique : elle couvre ce que nous pouvons embrasser du développement des sociétés. Bien moins sereine et soutenue d'un éclairage autrement vif est celle, parcellaire, que nous portons sur les événements qui se déroulent dans le cadre de notre vie. A plus forte raison si pour la première fois au cours des siècles l'avenir de l'espèce se trouve menacé et si d'autant les perspectives de réparation s'amenuisent. Pour parvenue qu'elle soit à l'état volatil, comme tout le reste, la liberté est ce dont nous demeurons le plus avides, le plus anxieux. Certes la condition nou- velle, accablante, qui est faite à la pensée (privée de l'assurance de Sa perpétuation) plus que jamais concentre l'attention sur tels individus de premier plan, « hommes pratiques et politiques » que Hegel jugeait en mesure d'influencer le cours de l'histoire. Elle prête aussi un relief sans précédent à leurs luttes. Mais, en dépit des pouvoirs fabuleux dont certains disposent, encore une fois toute l'histoire contredit l'idée que l'avantage reste aux liberticides. Les idéaux de 93 ont survécu à la bourrasque de Thermidor et à l'épaisse foulée napoléonienne. Cest sur cette certitude apaisante que j'ouvre le Journal d'exil à ce passage du testament de Trotsky (27 février 1940) :
« Pendant quarante-trois années de ma vie consciente je suis resté un révolutionnaire ; pendant quarante-deux de ces années j'ai lutté sous la bannière du marxisme. Si j'avais à tout recommencer, j'essaierais certes d'éviter telle ou telle erreur, mais le cours général de ma vie resterait inchangé. Je mourrai révolutionnaire prolétarien, marxiste, matérialiste dialectique, et par conséquent intraitable athéiste... Natacha vient juste de venir à la fenêtre de la cour et de l'ouvrir plus largement pour que l'air puisse entrer plus librement dans ma chambre. Je peux voir la large bande d'herbe verte le long du mur, et le ciel clair au-dessus du mur, et la lumière du soleil sur le tout. La vie est belle. Que les générations futures la nettoient de tout mal, de toute oppression et de toute violence, et en jouissent pleinement. »
En ce 23 mars 1960, salut à Léon et Natalie Trotsky.
André BRETON.
Le 27 ootobre 1938.
Cher camarade Breton
Le but de cette lettre est d'éclaireir un point qui pourrait donner lieu à des malentendus déplorables. Dans une de mes lettres à Partisan Review je donnais le conseil d'avolr envers les différentes tendances artistiques une attitude critique, expectative et... éclectique. Cela pourrait vous paraître étrange, car généralement je ne suis guère le partisan de l'éclectisme. Mais il fait bien discerner le sens de ce conseil. Partisan Review n'est pas la revue d'une école artistique consacrée aux problèmes de l'art. Il doit avoir pour les différentes écoles artistiques une attitude critique et amicale. Mais chaque école artistique doit être fidèle à elle-même. Voilà pourquot il serait absurde d'adresser, par exemple, aux surréallistestos le conseil de devenir éclectiques. Chaque tendence artistique a le droit de disposer d'elle-même. C'est d'allleure le sens de votre manifeate. Mes meilleurs saluts.
Leon Trotsky
MISE EN GARDE
Un personnage turbulent, Jean-Jacques Lebel, qu'aprÈs lut avoir fait credit nous avions dû récemment éloigner en raison de cette agilité particulière qui lui permet de sauter d'une soirée mondaine à une réunion de militants révolutionnaires, en passant par les salles de rédaction de Paris-Presse et de France-Observateur, se pose volontiers comme surréaliste auprès des innombrables directeurs de galeries, journalistes, peintres, littérateurs, editeurs, sociologues et philosophes qu'il rencontre chaque jour au hasard des rues et de sa rumeuse correspondance. Il apparaît de plus en plus que cette activité frénétique, marquée au coin de la plus totale confusion des valeurs, n'en est pas moins soigneusement commandée par arrivisme impressionnant, ce qui est dans l'ordre. Nous informons que les activités de Jean-Jacques Lebel, placier en toutes catégories de tableaux et ragots, ne relèvent nullement du surréalisme et ne sauraient, par conséquent, l'engager en quoi que ce soit.
LA REDACTION.
Je le dirai en enfer, si l'enfer existe
Préoccupations diplomatiques, calculs électoraux, sentimentalité made in Vatican, peu me chaut ce qui a décidé le gouverneur Brown à surseoir de soixante jours à l'exécution. A l'inverse, je ne m'indignerai pas des débats sur la marge de lenteur « admissi- ble » en matière d'assassinat judi- ciaire. Pas même du fait que la défense du condamné ait été aban- donnée par les intellectuels, — si rapides à intervenir en faveur d'une victime de conflits idéologiques, — à ce vieux pantin de docteur Schweitzer.
Parce qu'il est capable de ne pas ciller, un seul regard annule les grandes pièces muettes qui se croisent sur l'échiquier du monde où des hommes enferment et tuent léga- lement d'autres hommes. On comprend que je parle de Carryl Chessmann, et non de la peine de mort, opprobre permanent, question exténuée, Je parle de son courage, et non de « l'indulgence » à laquelle il aurait eu droit, et dont il a refusé l'aspect immédiat, légal mais répugnant : la grâce offerte en échange de l'aveu des seuls forfaits qu'il refuse d'endosser.
Imagine-t-on l'amplitude d'un tel balancier, oscillant pendant douze années, à travers huit sursis, entre l'espoir et le désespoir ? Certes un tel homme a le droit de dire aux journalistes : « J'ai appris à maîtriser mes réflexes, sans quoi je serai réduit à l'état d'épave ». Il ne me déplaît même pas de le voir choisir et exploiter à fond les seules armes qui lui restaient : la procédure et la publicité. Ce que je sais de ses livres, de l'analyse où il s'y livre des bains de misère, de bravade et de haine qui trempèrent sa jeunesse, révèle que cette bataille contre la mort fut aussi, obscurément, une bataille pour l'esprit.
Eût-il été « exécuté » que cette bataille n'était pas vaine. S'il est vrai que « chaque homme introduit dans l'histoire quelque chose qui ne peut plus ne pas en faire partie » (*) la lutte sans rémission de Chessmann marque d'un éclat de conscience, plus fascinant que les mille lumières de la West Coast, l'histoire assez sinistre qui est la nôtre.
A une époque où l'homme ne s'apprécie qu'en fonction de ses composantes sociales et fonctionnelles (c'est-à-dire, en dernier ressort, de ses capacités de soumission), Carryl Chessmann a pris en main et assumé, d'abord seul, une vie littéralement perdue. Il s'est forgé un état mental exceptionnel où le vouloir-vivre, non plus aveugle mais lucide pour une fois, coïncide avec la haute instance morale. Son « auto-critique », ne l'oublions pas, corrobore au lieu de l'infirmer une « auto-défense », déjà rare à l'ère des palinodies, et soutenue ici sans faiblesse dans les conditions les plus abominables. Cette montée au sein des ténèbres, à partir du plus précaire abri, vers la lumière toute naturelle où il s'est accompli, rappelle aux contemporains stupéfiés du « n° 2445 » que les individus ne sont pas interchangeables. Face à leur anonyme résignation devant (par exemple) la mort atomique, osons dire que, dans le visage de Carryl Chessmann, se sont burinés, — au prix de quelle angoisse et de quelle domination ! — quelques-uns des traits les plus sûrs d'un héros de notre temps. Mars 1960.
Gérard LEGRAND.
(*) Jules Lequier.
Pas de sel dans notre sucre
Si l'on considère l'enfance comme une longue brimade, une kyrielle d'angoisses, de complexes et de désirs insatisfaits, une quête incessante d'affection et de sécurité, une lutte perpétuelle contre l'autorité rigide de l'adulte et la tyrannie niaise de la raison, lutte rendue plus cruciale par une notion presque immatérielle du temps, on se demande comment cette période de l'existence peut être le plus heureuse, la plus libre, la plus intacte de toutes. On a tort, ce faisant, de compter sans ces alliées tenaces de l'enfance que sont l'imagination, l'innocence, la superstition. De la première, le panorama englobe maintenant nombre de recensements attendris ou didactiques, anthologies de mots, recueils de méprises, perles poétiques revues et parfois corrigées, accrochages commentés. De la seconde, on se fait une idée de plus en plus complexe où intervient désormais le jeu. Mais de la troisième, nous n'avions qu'une notion très vague, et dans l'essentiel aberrante. Nous l'avons volontiers considérée comme anarchique, individuelle, à base d'interprétations erronées et de broderies diffuses. Nous lui prétions une qualité cosmique, presque abstraite, alors qu'elle échafaude sans autre bruit une babel de traditions immuables.
Selon Peter et Iona Opie (1) deux professeurs d'Oxford, les jeux, rites et langages secrets de l'enfance se transmettent de bouche à oreille, d'une génération à l'autre, sans changement réel depuis des siècles et dans tous les pays du monde. Seule la traduction distingue telle formule cabalistique porto-ricaine de son équivalent néerlandais ou canadien. Peter et lona Opie ont interrogé pendant huit ans 5.000 enfants dans 70 écoles d'Angle- terre, d'Ecosse et d'Irlande, mais leurs conclusions sont corroborées par l'Afrique du Sud, l'Australie, la Grèce, l'Allemagne, la Bolivie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l'Irak ou le Portugal.
Avec le minimum de discrétion, on peut enregistrer la survivance, en 1960, d'un tour de passe-passe fidèlement transcrit en 1665 dans le Journal de Samuel Pepys : c'est celui de la lévitation: les enfants entourent l'un d'entre eux, assis sur une chaise et lui posent chacun un pouce sur la tête. On appuie fortement pendant quelques longues minutes d'intense concentration (défense de rire et de parler). Alors le sujet devient plus léger que l'air et peut se déplacer dans l'air comme une baudruche avec pour seul soutien un doigt sous chaque aisselle.
Si l'on entend le chant du coucou, on doit remuer son argent dans sa poche et on sera riche toute l'année. Si l'on rencontre un cheval blanc, il est recommandé de cracher trois fois. L'envers des objets: camions, ambulances, taxis, est d'aussi mauvais augure que la rencontre d'un aveugle, d'un boiteux ou d'un estropié, qui évoque la mort. Les chiffres relevés sur un ticket de bus, le nombre de lettres identiques contenues dans chaque nom précipitent une procédure divinatoire dont l'efficacité semble établie.
Le fait de prononcer par accident des mêmes mots en même temps déclenche partout un rituel sévère : on compte le nombre de lettres que contiennent les mots prononcés ensemble, on énumère ensuite l'alphabet pour enregistrer l'initiale de la personne dont on va recevoir une lettre. Le chiffre 13 donne la lettre M : on va recevoir une lettre de Madeleine. On dit alors la formule suivante : « Ma lettre est à la poste, Shakespeare ». En Allemagne, on invoque Gœthe ou Schiller, en Suède on ne sait pourquoi, les sœurs Brontë. Il existe des formules tout aussi précises pour guérir les engelures, faire disparaître les verrues, forger une amitié, la briser, provoquer un rival, frapper à la porte, faire la nique, conclure un marché, suivre le rebord d'un trottoir, perdre une dent, précipiter la venue des vacances, faire la preuve de son courage, tirer des cheveux ou repérer un objet perdu. La législation orale des troitoirs et des nurseries adopte la rigidité, mais aussi la grâce des comptines et formulettes, versant le plus souvent dans l'attrape-nigaud : « Quel âge as-tu ? — L'âge d'un veau, tous les ans douze mois. — Comment t'appelles-tu ? - Comme mon père. — Et ton père ? — Il s'appelle comme moi. »
Pour mystifier en retour les grandes personnes, si imbues de leurs prérogatives (« Tu comprendras quand tu seras grand ») on fait usage de nombreux codes. Au « javanais » de nos écoles correspond l'eggypeggy ou l'arague des jeunes britanniques (on ajoute lg ou arag devant chaque voyelle) l'argot rimé (chaque mot est remplacé par un correspondant : apples and pears remplace stairs) ou l'argot à l'envers (le son final est transporté au début de chaque mot, toutes les consonnes sont rejetées à la fin).
Peter et lona Opie ont fait mieux, il me semble, que de décrypter les manuscrits de la Mer Morte ou de déchiffrer la pierre de Rosette, ils ont trouvé fugitivement la clé traditionnelle de l'enfance, cette franc-maçonnerie des jeux, galipettes et coq-à-l'âne, une clé sans doute provisoire, puisque les rites juvéniles se modifient sans cesse, s'enrichissent et se réorganisent dans l'éclat de rire, décourageant toute vraie nomenclature. Comme l'a écrit un certain Douglas Newton, que citent les Opie : « La fraternité mondiale des enfants demeure la plus grande tribu sauvage, la seule qui ne court pas le moindre risque d'extinction ». Devant, pour le moment, renoncer à frayer avec les jivaros, je regarde chaque jour les terrains vagues, les tables de marelle : j'y vois courir, en quête enjouée de son ozone vital, le naturel.
Robert BENAYOUN.
(1) The lore and language of school children (Oxford, Clarendon Press).
L'ÉPINOCHE ET LE TROMPE-L'ŒIL
Les expériences auxquelles se livra, en 1937, le naturaliste hollandais Tinbergen sont encore dans toutes les mémoires. Etudiant les mœurs de l'épinoche de mer, Spinachia vulgaris, il constata chez le mâle de cette espèce une singulière aberration. A l'époque des amours, celui-ci, s'il dédaigne une représentation parfaitement fidèle de l'épinoche femelle, ne résiste pas à un leurre des plus grossiers, ébauche rudimentaire nantie cependant d'une vertu exceptionnelle : tandis que l'exacte imitation emprunte le galbe quotidien de la femelle, sa suggestion caricaturale se signale par le renflement abdominal propre aux périodes de frai.
Succombant au sex-appeal de l'épinoche femelle, le mâle répond ainsi à une localisation très spéciale de cet attrait et non à une vision globale de « l'objet aimé ». Nul n'ignore qu'en cela l'Homo sapiens ne se distingue guère du Spinachia vulgaris. La sélection érotique qui s'opère de la sorte n'a rien à envier à celle qui con-
duit des êtres humains, au long de vingt ans de vie commune, à ignorer tel trait physique de leur partenaire — la couleur de ses yeux, par exemple.
Mais une telle expérience, déjà précieuse biologiquement et psychologiquement, apparaît plus troublante encore si l'on se place sur le terrain de l'esthétique.
Tranchons-en tout d'abord assez rudement, au risque de blesser l'esprit timoré des esthètes jouisseurs : l'art est un leurre, mais - comme dirait M. Malraux - il ne vaut que dans la mesure où il parvient véritablement à «leurrer » le spectateur. Ce qui se produit ici : mis en présence de deux leurres, notre héros choisit le moins « ressemblant ». Ce n'est pas la femelle au museau pointu, aux yeux bien dessinés, aux nageoires frétillantes, à la queue fine qui l'attire - mais une silhouette boudinée et dépourvue de détails « réalistes ».
L'allure même du leurre séducteur n'est pas sans évoquer les « Vénus » aurignaciennes, aux proéminents appas. L'homme du paléolithique, qui dans ces représentations célébrait la fécondité, n'aurait rien compris à une Vénus grecque, même callipyge. Non pas parce qu'il se voyait exclusivement entouré de matrones mafflues — argument qui ne résiste pas au moindre examen - mais parce que l'inventaire scrupuleux d'os et de muscles auquel se livrait le sculpteur grec n'aurait eu à ses yeux aucun intérêt, parce que cela n'eût été pour lui qu'une manière de « noyer le poisson ». de perdre de vue l'essentiel. Ces outres de vie que sont les figurations féminines paléolithiques ne réalisent que pour nous une dégradation de l'idée de féminité.
Dès lors, les leurres trop exacts de Praxitèle peuvent rejoindre le simulacre trop myope de l'épinoche femelle dans le musée de l'inutile. Qu'on ne me dise pas que l'épinoche est un poisson timide ignorant l'existence des trois dimensions ! Comme si le spectacle des villes englouties n'était supérieur à tous les traités de perspective! Et comme si l'admirable danse en zigzag par laquelle le Spinachia vulgaris entraîne sa femelle à venir frayer dans son nid ne manifestait une parfaite « conscience » de l'espace, fût-il marin ! On a assez parlé des « espèces inférieures », il faut convenir que, là où l'épinoche ne se trompe pas — et pas davantage notre lointain ancêtre —, nous trouvons aujourd'hui encore des Claude Roger-Marx, des Florent Fels, des Raymond Charmet, des Guy Dornand, d'une lucidité critique très inférieure à celle d'un poisson, par lesquels l'escroquerie aux fausses apparences prend sa pleine valeur d'attrape-nigauds.
José PIERRE.
BALISES
Sous la direction d'Edouard Jaguer, le dernier numéro (5-6) de Phases dispose quelques trous d'air dans la grisaille céleste des « affaires de goûts ». Deux articles, La face inconnue de la terre, par Edouard Jaguer, et Le dernier carré, par José Pierre, se conjuguent rigoureusement pour renvoyer dos-à-dos les tenants de l'art pour le geste d'une part, et les ectoplasmes de l'abstraction froide, d'autre part.
Mais cédons plutôt la parole à Jaguer: ‹ ...faute de puissance imaginative, toute révolte sur le plan des moyens s'avère inapte à se muer en révolution véritable et dégénère rapidement en système. ...Un moyen révolutionnaire entre tous en tant que tel : l'automatisme, se trouve dévié par son utilisation comme fin en soi, système formel fermé à toute velléité d'interprétation poétique, d'échange avec le spectateur, puisque ces taches, ces plaques ou ces rafales de couleur ne sont à aucun moment mises en situation... ».
Mieux, tout en exigeant de l'artiste qu'il ne s'assujétisse point à ses propres conquêtes dès l'instant que plus rien, en profondeur, ne les sous-tend, Jaguer ne le tient pas pour cela quitte de s'abstenir dans la vie d'un tel souci critique qui est le moteur même de la morale révolutionnaire : « ...sur ce plan, écrit-il, nulle coquetterie avec le « siècle » ne souffre d'être tolérée... L'adhésion aux chances ultimes et précaires de la liberté implique de la part de ceux qui y consentent l'acceptation concordante de certains refus... ». Il nous faut cependant dire que bon nombre de toiles reproduites dans Phases ne nous ont pas donné l'impression que soit encore bien nette cette frontière que tente de tracer Jaguer. Par ailleurs, regrettons la trop large place accordée à Bryen que ses écrits classent au rang de ceux qui -- même au titre de « satellites artifiels » de la science - participent à « cette course grandiose au remplissage du vide », dont parle Jaguer. De la seconde partie de Phases, tout entière consacrée à la poésie avec un rare parti-pris de qualité, citons, de Jean-Pierre Duprey, La rose des cendres; de Farja : Tuberies; de Jean Thiercelin : Miroirs de l'étain, et de Claude Viseux : Voyage à l'intérieur d'une image.
Compte tenu des réserves que nous avons faites, rendons grâce à Edouard Jaguer d'avoir remis en lumière les principes à défaut desquels toute entreprise artistique ne peut manquer de porter en elle-même le germe de sa propre corruption.
J.-C. S.
PREMIÈRE NOTE SUR L'OBJET
Ce qui est scruté des yeux, souvent la main l'ignore. Ce qui est connu du cœur enferme alors, dans le balancement des choses, ce cœur dont on dit qu'il bat. L'esprit investit l'objet, mais l'objet garde son secret et c'est lui qui donne sa couleur à l'esprit et le décrypte. L'esprit a la couleur et la forme d'un nombre limité d'objets, absorbés au fil du temps, par pétition de principe. La connaissance est à rebours. L'objet est en posture ironique à l'égard de l'esprit et lui prête sa dépouille visible pour mieux celer sa substance et son mouvement. Le mouvement est selon une grammaire à quoi l'homme est sourd, car il croit à sa science qui est inventaire de lui-même et des objets, science du reflet, de la circonstance et de la preuve.
Le monde dit réel, celui de l'homme triomphalement paré des dépouilles de l'objet, est un aspect débile du monde imaginaire. Un pacte a sanctionné le simulacre. Le poète, chaque jour, mutile le document d'une clause.
Jean SCHUSTER.
Expresses réserves
Aux éditions Schwarz, de Milan, vont paraître incessamment, sous un même emboîtage, la traduction italienne des Entretiens d'André Breton et celle d'une Histoire du surréalisme depuis 1940, par Jean- Louis Bédouin. A la lecture sur manuscrit de ce dernier ouvrage (déjà à la composition) plusieurs des responsables de notre mouvement avaient jugé que d'importantes modifications s'imposaient. Regrettons qu'Arturo Schwarz, sans préjudice des titres qu'il garde à notre estime, n'ait pas fait tenir d'épreuves à l'auteur, le mettant ainsi dans l'impossibilité d'opérer les suppressions et les changements auxquels il avait consenti. Il est grand dommage que, du fait d'une telle précipitation, cette histoire, la première conçue de l'intérieur de notre mouvement, ne réalise pas, à beaucoup près, l'accord de tous ceux qui y tiennent un rôle essentiel. Attendons impatiemment qu'une édition française, revue sous ce rapport, consacre la version définitive de l'ouvrage, qui n'offre plus de prise à la discussion.
LA REDACTION.
LES ALLÉES ET VENUES
Si le pouvoir ne recule pas c'est parce qu'il a le dos au mur. Né d'une situation fausse et reposant sur une contradiction, le régime actuel ne saurait agir sans risquer de perdre ce qui constitue son atout-maître : l'illusion. Condamné à l'exercice quotidien du home-trainer, il offre l'apparence de la progression là où il n'y a qu'immobilisme rythmique. Reculer stratégiquement lui est même interdit depuis qu'il a donné à la population « une certaine idée de la France ». Reste la somme de cette idée qui exclut toute expression critique d'un système cependant conçu selon les normes du spectacle : la projection de la réalité y tient lieu d'évidence sans qu'elle acquière du tout cette réalité seconde que recèle parfois le théâtre. La moindre initiative quelque peu voyante prise dans un sens précis se voit aussitôt anéantie par l'application rigoureuse des lois de la compensation. Le pis-aller de l'autodétermination est petit a petit vidé de son contenu, l'arrestation des chefs ultras entraîne bien vite celle des Français « coupables d'aide à la rebellion ». Ainsi donc le point zéro fait l'affaire, que personne ne semble vouloir abandonner. C'est Groucho Marx qui déclarait « Parti de rien, j'ai atteint la misère ».
Mais c'est moins de cette inexistence politique dont je veux parler ici, moins de cette lamentable technique du balancier que des méthodes qui sont les siennes et des conséquences qui en résultent. Lorsque l'on frappe, il faut justifier son geste. Si la justesse des coups que l'on porte ne paraît pas très sûre, leur motivation officielle doit être d'autant plus forte. Pour cela, tous les moyens sont bons : salir est le plus efficace. La presse soumise sait se charger de ce genre de besogne. Un bel échantillon du style nous a été offert par Paris-Presse (27 février 1960) à propos, justement, de l'arrestation des « Parisiennes du F.L.N. ». En première page s'étalaient les sept photos policières de ces femmes présentées comme des criminelles détraquées par de petits commentaires où le perfide le disputait à l'ignoble. Toute la gamme des sous-entendus y était utilisée, depuis les allusions au dérèglement des mœurs jusqu'à celles concernant la déficience intellectuelle. L'accent était mis avec insistance sur l'indignité de telles françaises qui préfèrent « les don-juan nord-africains » à nos parachutistes velus. Au lecteur, il s'agissait de prouver que deux raisons seulement poussaient ces « malheureuses » : la chair (et avec qui !) ou une intelligence défaillante. Dans l'un et l'autre cas une certaine forme de perversion : corporelle ou spirituelle. Dès lors, la mise à l'écart de semblables déchets devait s'imposer aux yeux du public. Et la valeur du procédé parait très grande si l'on en juge par l'ampleur de sa mise en scène.
On nous permettra de n'en point apprécier la drôlerie ni le goût. Nous sommes de ceux pour qui le courage physique et moral a d'autres vertus et d'autres forces que la pratique quotidienne du crachat au visage.
Alain JOUBERT.
Conseils pratiques en attendant
La peinture constamment renouvelée du visage, les soins d'un corps toujours prêt, les courses à l'habillement, tout ceci vous confère votre dignité de femme mais, pour être femme, il ne suffit pas d'être belle, il faut aussi savoir attendre.
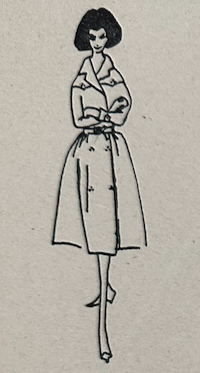
Savoir attendre sous une ombrelle, inquiète, jalouse, nonchalante de fatigue, l'arrivée d'un vieux Turc, messager d'un autre monde, le coup d'épée d'un crédule ou les moqueries d'un passant. Esclave des circonstances, attendre sans vanité, sans calcul et libre, le caprice du bazar : attendre sans plaisir la routine ou la chance.
Sachez attendre tout en restant jolie, détendue, nette... malgré la fuite des heures plus élastique que votre gaine (portez-la à toute heure : elle empêche l'angoisse de s'imposer entre les côtes et le grand sympathique, accélérant ainsi la disparition de votre vrai visage). Il faut savoir tromper son ennui. Attendre sans en avoir l'air et gare aux vieillissements ! L'attente usera d'autant plus vos nerts si la toile laisse passer les rayons du couchant.
Attendez dans une gare si l'étranger vous attire, mais apprenez à prévoir et détecter les pannes; devenez une conductrice expérimentée, une habile tricoteuse, une technicienne de l'aiguillage (tout ceci en six séances grâce à la nouvelle section pratique « Initiation à la loco-émotivité ») avant de croiser le fer avec la chance. Couchez-vous ailleurs que sur les rails si vos bas ne sont pas de la meilleure qualité: tout le monde connaît la force du mimétisme (la statistique le prouve : de beaux traits font naître des points d'exclamation, des ronds-de-cuir, des tomates, etc.). Malgré cela ne vous couchez pas sur les rails : le train s'arrêtera sans votre participation, il a l'habitude, vous non.
Soyez vive, teintée de joie sincère (choisissez vos couleurs avec le même art que vous choisissez votre personnalité hebdomadaire) ayez toujours une tasse de café à portée de la main car, ne l'oubliez pas, pour l'homme l'heure du café est permanente.
Si vous attendez dans un restaurant : Sacrifiez ce rendez-vous. Soyez ailleurs. Un affamé est mieux défendu qu'un blockhaus.
S'il faut attendre à la mairie ? A la maison ? Vous êtes majeure ? Bonne à marier? Bonne à tout faire ? Sinon, attendez de l'être avant de parler mariage.
N'attendez pas dans les rues : de véritables petits voyous vous entraîneront loin d'aujourd'hui et où seront alors les beaux atours de vos tares ?
Attendez-le au cœur du conflit parmi les feuilles roussies et les vapeurs caramel de vos discriminations. Dissimulez votre voracité sous un sourire semi-lunaire (se trouve dans les tailles suivantes : 42, 43, 44) et surtout arborez une poitrine frileuse ; il faut éviter l'insatisfaction chez le partenaire, elle confond les valeurs et aigrit le caractère. Soyez sûre de sa cause. Adoptez une attitude radicalement opposée à celle que vous avez coutume de prendre au lit. Soyez lisse comme une veuve aux moeurs rigides. Isolée et maussade. Et consolez-vous si vous ne savez comment amorcer votre attente : celles qui ne sauraient être fidèles peuvent être pratiques, mais hâtez-vous dans ce cas car les places sont rares et derrière le balai, implacable, la mort se dessine.
Joyce MANSOUR.
Couple
Le menton planté dans ta chair loin de l'étang du plafond
tes hanches amputées de mes mains
béantes vont se gonfler d'air
le lit coule de tes seins le drap pourpre de mon front le rêve glisse sur les pans de mon corps
tu t'allumes dans la glace
la croisée m'écartèle en noir
fouillant l'extase des cheveux
ô la petite mort de l'œil
sous l'étoffe imbibée de sang
t'accorde un sourire dans les replis fidèles de ton vêtement d'accueil que tu ne fermes pas complètement sur le soleil
je fane ta paupière
tu te repens parmi les ongles incertains du temps
tu flânes sur mes lèvres ne te craignant qu'à peine.
Jean-Claude BARBÉ
LENTILLE POUR STÉTHOSCOPE
De la satisfaction à l'exaspération, la rengaine offre un nid à la voix intérieure — tout entière moulée dans l'intonation particulière à celui qui fredonne — et au vacarme du dehors. Ils s'y tiennent en un accord onaniste et c'est de ces noces où la voix intérieure et les bruits de la vie se cajolent sans se griffer, que naît, grandit et meurt ce qu'on nomme le plaisir-de-vivre.
Il n'en va pas de même de ces expressions toutes faites, de ces bribes que l'ouïe se plaît à happer au hasard des lectures et des conversations, ou encore de ces mots idiots, qui investissent de fond en comble l'esprit.
Ces voix lancinantes et coriaces que le penseur de l'oubli ne parvient pas toujours à effacer - comme on dit si mal à propos du rêve — il n'est qu'une coïncidence - et cela s'est produit plusieurs fois pour moi — qui puisse les faire taire et qui permette de rétablir, à un niveau où la vie cherche aveuglément à prendre un sens, le contact avec le monde. Ces phrases, ces expressions, ces mots qui agissent en sésames sont les fragments d'une langue magique, dont nous avons tout au plus saisi au passage un éclat de voix, mais qui n'en a pas moins eu le pouvoir de mettre en équation énigmatique l'esprit et le monde.
Au beau milieu d'une avenue fréquentée, j'entends un traîneau passer sur la neige de la mémoire. Tant qu'il glisse il importe de ne pas se soucier d'où il vient ni où il va.
Des mots qui s'entraînent l'un l'autre à la poursuite d'un sens qui se dérobe, se lève parfois, comme planant au-dessus de leur troupeau qui suit, la voix ailée dont il m'arrive, au sol, de cerner l'ombre.
Jean-Claude SILBERMANN.
LE MARCHÉ NOIR
Un cargo italien, porteur de la sainte dynamite, échoua récemment près du cap Las Palmas. En poussant de hauts cris, quelques centaines de noirs montèrent à son bord, se mirent à courir dans tous les sens, grimpant sur le cordage, plongeant dans les cales inondées et jetant dans les pirogues tout ce qui à leurs yeux était digne d'être approprié. Une ou deux heures plus tard, fatigués, ils s'allongèrent sur le pont et s'endormirent, sans se soucier le moins du monde de l'équipage blanc, qui, lui, veillait dans la cabine du radiotélégraphiste.
Si l'Europe avait son blason, l'objet qui devrait y figurer de plein droit, c'est le réveil-matin. La télévision ou la bombe atomique, tout spectaculaires qu'elles soient, sont loin d'avoir une pareille importance pour la civilisation qui met tout en branle pour chasser le sommeil, son principal ennemi : les sonnettes des écoles, les clochettes de l'élévation, les tambours et les clairons des casernes. Les rares réfractaires à ces machines à sons ne tardent pas à être couverts de ridicule : dormir n'est-il pas une honte puisque les hommes vraiment civillisés, vraiment blancs, passent des nuits blanches ?
En plus, la vigilance est nécessaire, paraît-il. Et pourtant, il y en avait qui vigilaient pendant qu'on les stalinait..
On nous annonce à grands sons de cloches une conférence au sommet. Si les grands qui gouvernent, une fois rassembles dans la salle des délibérations, se mettaient à courir dans tous les sens, a grimper sur les chaises, a décrocher les horloges, a jeter les dossiers par les fenêtres, et puis, fatigués, s'ils s'endormaient tous ensemble sous les tables vertes, ne pourrions-nous pas, nous aussi, en toute tranquillité aller attendre la visite du seul commerçant dont je ne souhaite pas la disparition: je parle, évidemment, du noir marchand de sable ?
Radovan IVSIC.